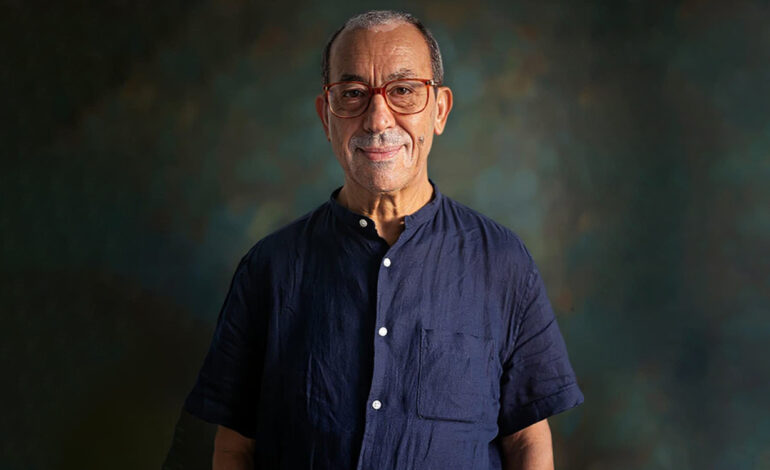
Organisé par le Festival international de Hammamet,en partenariat avec le Syndicat indépendant des producteurs et des réalisateurs, l’événement « Regards Cinématographiques » propose au public, le 5 août, une sélection de courts métrages, et le 6 août, le nouveau long métrage WED de Habib Mestiri qui sera projeté au Jardin des Arts du Centre Culturel, à 20h00, en présence de l’équipe du film.
Après « Vagues brisées » et « Les Semblables », le réalisateur poursuit, dans ce troisième long métrage, son chemin, entre documentaire et fiction, sur la voie de l’engagement,en abordant les thèmes essentiels de l’histoire, l’identité, la mémoire et de la résilience humaine.
WED retrace le combat de Khalil, un journaliste de gauche, face à l’oppression et à l’injustice dans la Tunisie des années 1980 et 1990. Trahi et désillusionné, il s’accroche à ses idéaux dans un monde en perte de valeurs et de repères. Tel un Don Quichotte des temps modernes, Khalil poursuit inlassablement sa quête d’un monde meilleur. La sortie prochaine du film sur nos écrans est prévue pour le 17 septembre. Entretien.
La Presse — Qu’est-ce qui vous a poussé à adapter le roman Le Dernier Rêveur de Mustapha Ben Ahmed ?
J’ai choisi d’adapter ce roman pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’auteur, Mustapha Ben Ahmed, m’a incité à lire le roman, car, en tant que compagnons de route,nous avons partagé des luttes estudiantines et participé ensemble à de nombreux débats à la Fédération tunisienne des ciné-clubs (Ftcc), plus précisément au ciné-club de Carthage.
Au-delà de l’appréciation du livre, je suis convaincu qu’une adaptation cinématographique peut offrir un résultat particulièrement intéressant,notamment pour témoigner d’une époque marquante de l’histoire du pays. Enfin, ce projet m’a offert l’opportunité de renouveler l’expérience de l’adaptation littéraire, puisque mon précédent long-métrage était déjà une adaptation, celle du roman « Les Semblables » de Feu Mohamed Nacer Nefzaoui.
Le film est-il fidèle au roman ou s’agit-il d’une adaptation libre ?
Il s’agit d’une adaptation libre, mais j’ai veillé à rester fidèle à l’esprit et à la profondeur du roman. Cependant,sur le plan formel, j’ai dû simplifier le récit, car l’ouvrage couvre plusieurs décennies,allant des années 1970 à aujourd’hui,et aborde des problématiques idéologiques et politiques complexes.
Dans le film, j’ai choisi de condenser les événements qui ont marqué la période des années 1970 et 1980,tout en me focalisant sur les années 1990, période caractérisée par le despotisme et la répression des militants politiques, des activistes et des intellectuels.
L’auteur, qui redoutait que son texte soit trop simplifié, a été agréablement surpris de constater que l’esprit du roman a été préservé. Il l’a exprimé lors du débat qui a suivi la projection du film,aux dernières Journées Cinématographiques de Carthage. Il était pleinement satisfait de voir les personnages de son roman prendre vie à l’écran.
Ce retour positif a été une source de grande motivation pour lui, l’encourageant à poursuivre l’écriture, surtout compte tenu des difficultés que connaît le secteur de l’édition.
Est-il facile d’adapter un roman en respectant à la fois les particularités du cinéma et celles de la littérature, ainsi que leur relation spécifique ?
Toute adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire nécessite un travail approfondi et une grande rigueur. Plusieurs lectures de l’ouvrage s’imposent, car à chaque relecture, on peut découvrir un élément ou un aspect qui nous avait échappé auparavant. De plus, il est essentiel de reconnaître l’importance des ateliers et des formations spécialisées, comme celui organisé par le Goethe-Institut sur l’adaptation des œuvres littéraires au cinéma, qui m’a beaucoup aidé à mieux comprendre les défis et les subtilités de ce processus.
L’adaptation de Casanova par Federico Fellini est un exemple parfait de réinterprétation d’une œuvre classique, qui parvient à en respecter l’esprit tout en y insufflant une vision propre.
Que pensez-vous du rapport des réalisateurs tunisiens au roman tunisien ?
Je pense que les réalisateurs tunisiens ne mesurent pas pleinement la richesse de la littérature tunisienne contemporaine. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, depuis les années 1930 jusqu’à aujourd’hui,de Béchir Khraeïf à Chokri Mabkhout en passant par Mahmoud Messadi et bien d’autres, le roman tunisien s’est imposé sur les scènes nationale et arabe. Je comprends, en partie, cette distance qui s’est instaurée, notamment à une époque où,sous les anciens régimes, la création littéraire était fortement contrôlée.
Le cinéma, en revanche, bénéficiait d’une certaine liberté d’expression, ce qui lui permettait de traiter des tabous, des non-dits et de franchir des frontières interdites. Les réalisateurs redoutaient, alors, de ne pas trouver cette même liberté dans le roman tunisien. Mais je pense que cette attitude ne se justifie plus aujourd’hui.
Il est, donc, essentiel que les réalisateurs lisent tout ce qui se publie. Cela leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de faire émerger une nouvelle génération de scénaristes, cruellement absente aujourd’hui. Je pense que le ministère des Affaires culturelles, l’Union des écrivains et l’organisme des droits d’auteur doivent œuvrer ensemble pour faire de cette collaboration entre écrivains et réalisateurs une réalité,notamment en créant un fonds dédié à l’adaptation des romans tunisiens au cinéma.
Pourquoi avoir choisi le titre Wed pour cette œuvre ?
Le titre, « WED » (lien/union), est une métaphore forte. Il évoque les liens intellectuels et militants d’une génération, ces mariages de convenance où l’amour et la mort coexistent. Ce lien peut se briser ou résister, et c’est précisément cette question qui se pose.
Le film relate les transformations et les bouleversements politiques des années 1970 à travers le parcours de Khalil, un anti-héros militant et journaliste de gauche engagé. Malgré ses idéaux et ses combats, il se retrouve marginalisé et persécuté par le pouvoir en place.
Par ailleurs, votre film précédent, « Les Semblables »,aborde, également, le thème de la lutte et de l’échec du mouvement de gauche. Qu’est-ce qui motive cette focalisation récurrente sur ce combat et cette défaite ?
Cette récurrence autour de l’échec de la gauche relève d’une forme d’autocritique, dans la mesure où la gauche tunisienne n’a jamais véritablement fait la sienne. On a vu certaines figures passer de l’extrême gauche radicale à la collaboration avec le régime, sans jamais expliquer clairement les raisons de ces revirements.
Par ailleurs, cette période charnière de notre histoire, soit les années 1980 et 1990, marquée à la fois par les luttes menées par la gauche et par les fractures provoquées par les bouleversements géopolitiques mondiaux, demeure largement ignorée.
J’estime que cette histoire mérite d’être racontée, ne serait-ce que pour montrer que la persécution a été l’une des principales causes de la marginalisation de la gauche. En effet, le système du parti unique a privé le pays de nombreuses compétences loyales et intègres, qu’il s’agisse d’artistes, d’intellectuels ou d’autres figures importantes, uniquement en raison de leur affiliation à la gauche et à ses idéaux.
Enfin, il convient, également, de rappeler que ce sont les sacrifices de la gauche et de ses pionniers qui ont permis de semer les graines de la révolution. Et bien que certains membres de la gauche aient, à un moment donné, pris part au pouvoir sous les anciens régimes, la véritable intention de ces régimes était de les utiliser et d’absorber la gauche, de la marginaliser, voire la diviser.
Pourquoi avoir choisi de recourir au symbolisme dans «WED», malgré le risque d’être mal compris par le public ?
Le symbolisme que j’utilise dans le film est effectivement inspiré du roman. Cependant, il a représenté un véritable défi, car tel qu’il est développé dans le livre, ce symbolisme est particulièrement complexe et surtout coûteux à transposer à l’écran,d’autant plus que nos techniciens ne sont pas équipés pour les techniques de trucage nécessaires.
J’ai donc choisi de réorienter cette dimension symbolique vers une forme d’expression artistique, en collaborant avec la plasticienne Leïla Rokbani qui a conçu les décors du film. Ses sculptures et dessins, affranchis des conventions classiques, reflètent les fractures sociales, les oppressions de classe, ainsi que les états psychologiques d’une société indifférente.
Son travail apporte au film une dimension onirique, qui agit comme un contrepoint de la dureté du réel. J’ai voulu instaurer un dialogue entre la sculpture et la littérature, ce qui explique l’omniprésence du symbolisme tout au long du film. Quant à la réception par le public, le film s’adresse volontairement à une catégorie spécifique de spectateurs, plutôt qu’au grand public.
La narration repose avant tout sur le visuel, l’esthétique de l’image, les couleurs, les formes, etc. Ce parti pris privilégie une approche plus sensorielle, qui demande une certaine réceptivité de la part du spectateur.
En quoi la scène symbolique dans laquelle Khalil, l’anti-héros, affronte des spectres devant un rideau taché de sang évoque-t-elle une lutte vaine, comparable à celle de Don Quichotte contre les moulins à vent ?
Khalil incarne un Don Quichotte des temps modernes, combattant des spectres nés de la persécution qu’il a endurée tout au long de sa vie. Ce fardeau l’a profondément marqué, le fragilisant sur le plan psychologique. Pourtant, refusant de se laisser abattre, il brandit son épée et part en guerre contre ces apparitions.
« Hann el Wed » figure à la fois mystérieuse et insaisissable incarne-telle un refuge pour Khalil ?
Oui, elle représente pour lui une lueur d’espoir. Tourmenté par cette figure située entre le rêve et la réalité, Khalil se lance dans une quête obsessionnelle pour la retrouver. Hann el Wed devient son refuge, un idéal insaisissable dans un monde où les valeurs s’effondrent.Mais elle lui échappe sans cesse, disparaissant à chaque fois qu’il croit, enfin, l’avoir atteinte.
Sa quête se transforme, alors, en une lutte intérieure, où il oscille entre la brutalité du réel et la fragilité de ses illusions. Dans une société rongée par la cupidité et l’opportunisme, Khalil se retrouve seul, confronté à la laideur d’un monde où les idéaux semblent définitivement condamnés.
Pourquoi avoir opté pour une esthétique fondée sur le contraste entre ombres et lumières ?
Pour moi, c’était la meilleure manière de refléter l’état d’âme des personnages. J’ai opté pour un style minimaliste, avec très peu de mouvements de caméra, en privilégiant le plan-séquence. Dès le départ, l’équipe et moi avons réfléchi à la façon de réaliser un film en quasi huis clos, en tenant compte d’un budget limité (220.000 dinars) et d’un temps de tournage restreint.
C’est ainsi que nous avons opté pour le plan-séquence et le clair-obscur. Ces choix visuels renforcent la cohérence esthétique du film et traduisent clairement notre parti pris esthétique : le minimalisme. Cela représentait un vrai défi technique : soit nous attendions un financement plus conséquent pour concrétiser le projet, soit nous avancions avec les moyens du bord.
C’est un dilemme auquel sont régulièrement confrontés les réalisateurs, notamment face au manque de ressources, à l’absence de vision à long terme des institutions culturelles concernées et à la fuite des investisseurs et du capital, qui évitent l’investissement dans le cinéma et la culture comme la peste.
Qu’est-ce qui vous a poussé à faire appel à des comédiens de théâtre, notamment Ahmed Amine Ben Saâd pour incarner Khalil?
J’ai choisi des comédiens de théâtre avant tout en raison du budget limité du film (Low-Cost). Leur capacité à se préparer rapidement au jeu, ainsi que la complicité naturelle qu’ils partagent facilitent les interactions à l’écran. Ils se connaissent bien, ce qui crée une belle dynamique.
Outre son entente artistique avec les autres acteurs, Jamel Madani, Jamel Sassi et Najwa Miled, Ahmed Amine Ben Saâd est lui-même metteur en scène de théâtre. Il possède une solide expérience: il a joué dans plusieurs feuilletons et a tenu le premier rôle dans le long métrage Saint Augustin.
Son passé d’ancien militant de l’Uget (Union générale des étudiants tunisiens) et son engagement au sein du mouvement de gauche lui donnent une compréhension intime des enjeux politiques, éthiques et sociaux du personnage. Cela lui a permis d’incarner Khalil avec justesse et profondeur.
La musique du film, rythmée et pétillante, a été composée par un jeune musicien de techno, pourquoi ce choix ?
Il s’agit d’Ali Kraiem, je l’ai choisi dans un esprit de défi, et il a su le relever avec brio. Dans mes films, j’aime donner à de jeunes talents l’occasion de vivre leur première expérience sur un long métrage tunisien. Dans « WED », trois jeunes ont pleinement participé à l’aventure : en plus de ce jeune compositeur,il y a Leïla Rokbani, décoratrice, et Mehdi Bouhlel, directeur de la photo. Les films à petit budget ont aussi cette vocation : soutenir et faire émerger de jeunes talents, en leur donnant la confiance nécessaire pour se lancer dans cette aventure.
A quand est prévue la sortie du film sur nos écrans ?
« WED » sortira en salles le 17 septembre 2025.




