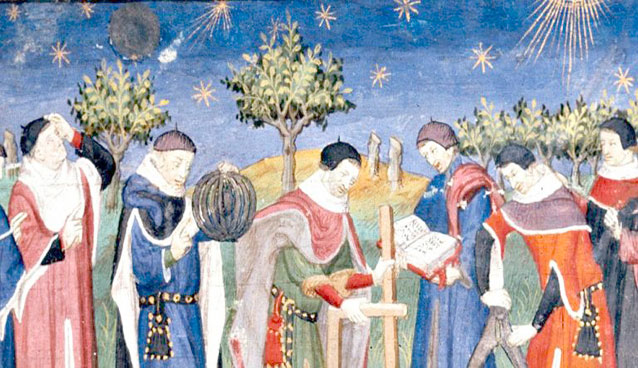
Quand on considère les perspectives futures de notre monde, et le risque pour l’homme d’être entraîné dans une spirale de perte de repères synonyme de décadence, la question est de savoir si la science, qui fut jusqu’à présent une réponse à tant de maux, peut encore être un recours. Ou s’il ne convient pas d’y distinguer les signes de la menace… Mêlant leurs voix, le philosophe, le poète et le médecin tentent d’y voir plus clair.
Md : Si vous permettez que je fasse un peu le point sur nos discussions des dernières semaines, je pense qu’il est utile de rappeler une idée importante, qui est que la conception moderne du beau, à travers la notion d’esthétique, a rompu avec une expérience plus ancienne ; que cette rupture a été une perte et que le beau qui peut nous sauver —formule de Dostoïevski— n’est pas à chercher du côté de l’esthétique, mais bien plutôt dans ce qui précède. Le moment de la césure, c’est ce que l’examen de la conception kantienne du beau et du sublime nous a permis de voir de plus près. Il me semble pourtant qu’à mesure que nous avançons sur cette voie, le besoin se fait sentir de revenir sur le sens de la formule : que veut dire le fait que le beau peut nous sauver, et comment est-ce qu’il peut le faire ?
Po : Oui, il est bon de revenir en arrière et de renouer le fil avec ce qui s’est dit. Je me souviens que la formule de Dostoïevski s’est invitée dans notre débat quand nous avons évoqué la question des réponses à la décadence. Le beau, c’est alors ce qui s’opposait à une autre réponse possible, dont nous avons dit qu’elle était en réalité fallacieuse, parce qu’elle représentait un visage insidieux de la décadence elle-même : je veux parler de l’autoritarisme politique.
Ph : Dostoïevski ne dit pas que le beau nous sauve. Il dit qu’il est seul ce qui peut nous sauver. Rien en dehors de lui ne peut le faire. Et ce qui nous est apparu, mais qui mériterait peut-être plus d’examen, c’est qu’en nous sauvant de la décadence, le beau nous libérerait aussi du conflit millénaire entre Orient et Occident. Voilà ce à quoi nous avaient conduits nos discussions. Mais ce qui me paraît mériter qu’on y revienne, c’est le mot «seul». Ce qui peut nous sauver, ce n’est donc pas l’autoritarisme des nouveaux autocrates, mais ce n’est pas non plus, ni la religion et ses dogmes, ni la science et ses vérités.
Md : Quelqu’un qui t’entendrait parler ainsi se dirait que ce qui reste, c’est donc l’art : l’art est la solution. Mais en parlant d’art, il aurait à l’esprit ce qui se pratique de nos jours sous ce vocable. Or justement, l’art d’aujourd’hui relève davantage de l’esthétique et de ses développements que du beau, dans son sens qui est à la fois plus ancien et plus fort.
Po : Oui, on peut bien reposer la question : pourquoi, ou en quoi, la beauté seule peut encore nous sauver ? D’autant que beaucoup de gens continuent de penser que c’est la science qui va nous sauver. Moyennant un peu de «conscience». Qu’est-ce qui leur donne tort, tout compte fait ? On ne peut se contenter de mener la guerre aux prétentions de la science sous prétexte que Heidegger a dit que «la science ne pense pas», ou que Nietzsche a fait du savant l’une des figures de la décadence du dernier homme. C’est vrai d’autre part qu’un certain positivisme a fait son temps, mais peut-être seulement en raison de ses excès, de son triomphalisme, de son assurance dans le rôle de fossoyeur de la pensée religieuse. Comme vous le savez bien, j’ai mille raisons de me méfier pour ma part de ce parti de la science. Mais je m’interdis de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, comme on dit.
Ph : C’est vrai que cette méfiance peut passer pour de l’ingratitude. Nous bénéficions tous d’une multitude de bienfaits et d’avantages dont l’existence n’aurait pas été possible sans les progrès de la science. Tenez, pour venir ici, j’ai dû prendre ma voiture. Sans la science qui a permis l’invention du moteur à explosion, j’aurais fait le trajet à pied, ou à dos d’âne, en supportant la chaleur de ce soleil qui devient estival… Je serais probablement arrivé harassé et en retard : ce que je n’aime pas du tout. Hier, j’ai eu un méchant mal de tête dont je me suis débarrassé d’un simple cachet d’aspirine. Ce qui m’a permis de me replonger dans certaines réflexions en lien avec nos rencontres. Qui sait ce que j’aurais dû endurer en me préparant d’improbables décoctions, et si j’aurais eu finalement le confort nécessaire pour penser à quoi que ce soit de précis. La liste des avantages peut être allongée de façon indéfinie. Alors, je serais donc de ceux qui crachent dans la soupe parce que, malgré tout ça, je dirais que c’est le beau qui seul peut nous sauver : lui, à l’exclusion de la science ?
Md : Je ne pense pas qu’on ait à se plaindre de la science, tant qu’elle n’a pas la prétention de faire notre salut. Le problème, c’est que cette tentation, chez elle, est constante. C’est de vouloir remplacer la religion —qu’elle pense avoir vaincue— que viennent les ennuis.
Po : Est-ce que ton diagnostic ne serait pas en-deçà de la gravité du mal ? Quand on considère les ravages causés par le progrès sur la nature, tous les bouleversements des écosystèmes dont on méconnaît d’ailleurs les retombées à long terme, quand on voit la volonté arrogante de l’homme de disposer de toutes les créatures de la terre —qu’elles soient animales ou végétales— en en faisant de simples ressources à l’usage de ses actions de transformation et de consommation, est-ce que le tableau n’est pas beaucoup plus sombre que ce que tu suggères ?… La bombe atomique, qui est une illustration éloquente de la capacité de la science à se tourner contre l’homme en menaçant l’existence même de son espèce, ainsi que le caractère habitable de la terre en général, cette bombe n’est-elle pas une sorte de signe avant-coureur de la perversité du progrès… Songez seulement à ce que la mécanisation de l’agriculture a entraîné comme problèmes de stérilité dans certaines de nos régions, en raison de la fragilisation des sols par le labour répété, et en raison également de tous ces produits chimiques qui sont enfouis dans la terre : les rendements d’aujourd’hui sont des promesses de famine pour demain.
Md : Je partage avec toi ces craintes, mais je maintiens que ce qui est en cause, ce n’est pas le savoir scientifique, mais la prétention de ce savoir à répondre à des attentes qui ne sont pas de son ressort.
Po : Qu’est-ce que tu veux dire ?
Md : Je note que, dans mon domaine, à chaque fois que le médecin s’est mis en tête qu’il pouvait redonner à son patient les conditions du bonheur grâce à son savoir supérieur, il s’est mis à agir contre sa vraie vocation : à aggraver le mal au lieu de le calmer. Or il en est de même pour le savoir scientifique en général. Il s’égare quand il se croit bien avisé de se mettre au service d’une transformation du monde qui en évacuerait toute souffrance. Ce qui représente finalement une façon de ramener le paradis sur terre. Le rôle du médecin est d’apaiser, non d’abolir la souffrance.
Ph : L’histoire du rationalisme est en effet celle d’un conflit de légitimité avec la pensée religieuse, et je crois aussi que nous subissons le contrecoup de ce conflit.
Po : Un «conflit de légitimité», dis-tu ? Comment le combat de la raison pour l’affirmation de ses prérogatives face aux dogmes s’est-il transformé en une lutte de conquête du domaine du religieux ? Puisque c’est de ça qu’il s’agit : la pensée moderne, qui est issue du rationalisme, a ruiné les perspectives de l’au-delà en les mettant sur le compte de la croyance naïve et elle se présente désormais comme seule habilitée à répondre aux attentes de l’homme. En insinuant que les attentes qui sont tournées vers l’au-delà sont des survivances plus ou moins pathologiques héritées du temps de la croyance. Or nous sommes tous d’accord pour dire que, en effet, ce temps de la croyance est révolu, mais nous ne sommes pas d’accord pour dire que les attentes liées à un au-delà de la mort sont de simples survivances de quoi que ce soit : elles sont au cœur de l’existence de l’homme. Y compris de l’homme tragique. L’homme qui se contente de son bonheur dans les limites de l’ici-bas est, lui, celui qui a perdu le sens du tragique. C’est un homme qui a rétréci ses horizons : il est celui par qui notre monde d’aujourd’hui dévore les ressources existantes et qui a tendance à réduire tout ce qui existe autour de lui au rang de ressource. C’est un homme qui se fait du mal à lui-même en tant qu’homme et qui fait également du mal à la nature, fût-il d’ailleurs de ces âmes sensibles qui s’évanouiraient à la vue d’une goutte de sang. Pour donner corps à son bonheur désespéré, rien n’est jamais suffisant : il faut sans cesse de nouveaux sacrifices prélevés dans la chair des autres créatures.
Md : L’homme tragique est à l’inverse celui qui élargit ses horizons au-delà de la mort sans jamais faire de sa survie après la mort l’objet d’une croyance : il maintient, pour l’approfondir même, la béance infinie de la mort.
Po : Oui, c’est ce que Nietzsche a bien aperçu en parlant de l’homme nouveau comme de celui qui danse sur le gouffre. Or l’homme nouveau de Nietzsche renoue avec le tragique des anciens Grecs. Pour danser sur le gouffre, il faut avoir en son cœur une flamme qui ouvre du champ à l’infini, par-dessus la béance du gouffre. Il faut avoir une espérance qui soit plus forte que la mort.
Ph : Je reprends la question qui a été posée : qu’est-ce qui a poussé le rationalisme à s’engager dans ce conflit néfaste avec la pensée religieuse ?
Po : Peut-être une logique de la revanche !
Ph : Comment ça ?
Po : Avant que la pensée rationaliste ne s’égare en voulant occuper le terrain du religieux —en restreignant ce faisant ses horizons—, c’est la pensée religieuse elle-même qui s’est égarée en voulant décider pour la raison de ce que celle-ci avait ou non le droit de tenir pour vrai en ce qui concerne les choses de l’ici-bas. Ce rôle de censeur de la théologie n’est pas un privilège de la civilisation islamique, comme chacun sait. Mais l’Europe, contrairement à nos pays orientaux, a rendu possible une insurrection contre l’hégémonie de la théologie. Ce que nous n’avons toujours pas réussi à faire, pour notre part… Sinon en nous contentant d’engranger les fruits de l’insurrection européenne. Avec cet inconvénient que nos tenants de l’autorité théologique peuvent nous accuser d’être de vulgaires plagiaires des révolutions initiées et accomplies par d’autres : en quoi ils n’auraient peut-être pas complètement tort… Mais laissons ça. Nous avons évoqué récemment le nom de Descartes : Descartes a été témoin des mésaventures de Galilée face à l’Eglise. Il a subi à travers des intellectuels de son temps la prétention des ecclésiastiques à imposer le dogme contre ce que la raison se propose comme vérités conformément à ses règles propres en matière de recherche. Il a vécu l’épreuve de l’Eglise quand elle met tout le poids de son autorité pour décider si telle vérité peut être reçue comme telle ou si elle doit être considérée comme une hérésie condamnable, qui vaudrait à son auteur de se retrouver en prison, voire même de connaître le bûcher… Or la pensée rationaliste pouvait se contenter de se dégager de l’emprise du théologique, en ramenant les religieux dans les limites raisonnables de leurs vérités purement spirituelles. C’est parce qu’ils se sont laissé entraîner par la violence du conflit qu’ils en sont venus à affirmer que les vérités spirituelles n’en sont pas, que ce sont de simples illusions dont le but est de manœuvrer les âmes candides pour mieux les dominer… A partir de là, il fallait poursuivre jusqu’au bout de la démarche, et donc répondre à des attentes qui, étant tournées originellement vers l’au-delà, ne pouvaient être remplies par des choses de l’ici-bas… Elles ne pouvaient en être remplies sans que l’ici-bas lui-même ne soit détruit, comme on détruit chaque chose quand on cherche à en tirer à tout prix ce qu’elle ne peut contenir, ce qui excède ses capacités.
Ph : Cette hypothèse de la revanche mérite en tout cas toute notre attention. Elle suggère que, loin d’être une voie de salut, la pensée scientifique, ou «scientiste», est au contraire une voie qui peut mener à la perte de l’humanité. A moins peut-être que, sans renoncer à son territoire, elle accepte de placer ses recherches sous le signe du beau.
Md : Qu’est-ce qu’une science qui, tout en occupant son territoire propre et sans chercher à empiéter sur celui des autres, accepterait de se placer sous le signe du beau ? Ou, dit autrement, qu’est-ce qu’une pensée rationaliste qui serait réconciliée avec la pensée religieuse et qui, ainsi libérée de son esprit de revanche, mettrait son génie au service du beau ?
Ph : Voilà une question essentielle sur laquelle je propose que nous nous donnions le temps de réfléchir. D’autant qu’elle devrait nous apporter des éléments de réponses au sujet de deux questions différentes et non d’une seule : ce qu’est une pensée qui est dédiée à la recherche scientifique mais qui accepte de servir le beau, et ce qu’est le beau pour pouvoir constituer un idéal non seulement pour l’artiste, mais aussi pour l’homme de science.









