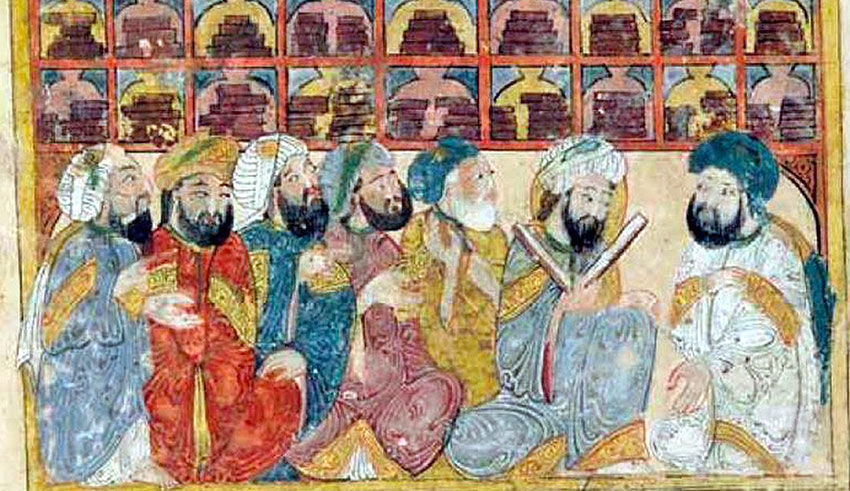
Les religions ont-elles besoin de renouveler leurs récits pour marquer de leur présence la scène tourmentée du monde que nous vivons ? On est tentés de répondre par l’affirmative, surtout quand on voit que les anciens récits polarisent autour d’eux des mouvements dont l’existence penche davantage du côté de ce qui attise les peurs que de ce qui les apaise… Mais nos trois amis préfèrent se pencher pour l’instant sur une question préliminaire, et cependant primordiale.
Ph : Qu’est-ce qu’un récit ? Le mot revient dans nos discussions, laissant deviner en lui un rôle tout à fait essentiel du point de vue de la capacité des religions à se porter au secours du monde quand grandissent les périls. Mais nous avons relevé au préalable quelque chose de très important en lien avec ce même mot, n’est-ce pas, quand nous avons affirmé que c’est seulement par la passion retrouvée du récit que le fou parvenait à se glisser, pour ainsi dire, hors de la cage de sa folie…
Po : Oui, il serait peut-être temps de s’enquérir de ce qui fait sa puissance. Tu viens de rappeler sa fonction de guérison. Le récit redonne du sens à l’expérience de l’existence. Quand il s’agit de l’existence du monde, de celle de l’homme, de la nôtre comme l’homme particulier que nous sommes, ce n’est pas la science qui peut nous donner des réponses. La science peut nous expliquer comment les choses arrivent, mais pas qu’elles arrivent ni pourquoi elles arrivent. Et le fait qu’elle nous propose telle théorie plutôt que telle autre ne nous concerne pas beaucoup…
Md : A vrai dire, ce qu’elle dit nous concerne, mais seulement dans la mesure où ça peut avoir une incidence sur le récit. Dans la mesure où elle s’érige en instance critique capable de soumettre le récit à un procès en crédibilité : «Est-ce vraiment croyable ?», demande-t-elle.
Po : Cette incidence est toujours destructrice. C’est pour ça que la science nous propose un monde sans récit. Or ce monde sans récit est un monde inhabitable. Regardez par exemple dans quelle misère nous vivons en ce pays depuis que les anciens récits nationaux se sont effondrés. Ces grands récits que les partis politiques cherchent aujourd’hui à ressusciter, mais sans grand succès. Il y a l’épopée bourguibienne, censée nous faire accoster sur les rivages de la civilisation moderne telle que l’Occident nous en offre le modèle. Il y a celle des réformistes musulmans qui nous promet aussi une modernité, mais celle-là dans la recherche du sillage qui est celui des heures glorieuses du passé islamique. Il y a celle qui nous vient de la pensée marxiste et libertaire, qui raconte un monde débarrassé de ses servitudes et de ses inégalités… Ces récits sont en conflit les uns avec les autres, mais ils donnaient un sens cohérent au temps. Aujourd’hui, avec notre révolution qui piétine et qui sombre elle-même dans la confusion, nous ne savons plus où nous allons : nous sommes livrés à un temps sans repère. Et nous voyons la jeunesse fuir ce pays au risque de sa vie… Ce que je veux dire par là, c’est que le récit présente aussi cette caractéristique d’être comme l’oxygène de notre esprit. Sans lui, c’est le vide asphyxiant.
Ph : Je pense qu’il y aurait une distinction à faire à ce sujet entre le confortable et l’habitable. En ce sens que, grâce à la science, le monde a pu devenir plus confortable, mais qu’il a cessé d’être habitable. Ce qui peut le rendre plus habitable, c’est en effet le retour du récit. Mais quel récit ?
Md : En effet, quel récit ? Parce qu’on voit par exemple que ces récits nationaux qui veulent chacun s’imposer au détriment des autres ne font eux-mêmes, par leurs conflits, que créer le désert. Ils veulent redonner du sens à l’existence de l’homme sur terre et en sa patrie, mais ne parviennent qu’à élargir la place de l’absurde par le climat de guerre incessante qu’ils suscitent.
Ph : Il n’en serait peut-être pas ainsi dans le cas où, au lieu de s’affronter, ils cherchaient à faire germer de leurs oppositions quelque chose comme un nouveau récit. Mais justement, faire germer le récit relève d’un art, qui a ses règles…
Po : Quelles règles ?
Ph : Oh, je ne saurais les citer de façon exhaustive, à supposer même que je les aie en tête. En fait, il y a des théories du récit, qui nous apprennent par exemple qu’un récit doit avoir un début et une fin, qu’il obéit à des genres —la fable, le conte, la légende, le roman…—, qu’il ordonne des faits réels ou imaginaires selon une représentation séquentielle… Mais ce n’est pas du tout notre propos ici. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le récit quant à sa forme ou sa structure, c’est le récit du point de vue de sa genèse. Et c’est aussi le récit en tant qu’il peut avoir une fonction de guérison. C’est-à-dire qu’il peut nous sortir d’un état de tristesse et d’abattement du fait justement que plus rien n’a de sens, que nous sommes livrés à la «brutalité» des faits bruts…
Po : Une des parades à cette brutalité des faits est de dire que c’est le destin, ou que c’est la volonté de Dieu… Le propre de cette parade est que c’est le même récit qui se répète dans son indigence, quels que soient les événements qui se présentent. Le destin, ou le dieu qui dicte ses volontés à l’Histoire, c’est finalement la répétition indéfinie sur la scène de notre existence de ce même récit racontant qu’une puissance supérieure exercerait son pouvoir à la manière d’un roi capricieux, tandis que nous aurions, nous les humains, à supporter patiemment les humeurs de ce monarque. Au terme de quoi, mais dans une autre vie, nous serions sauvés et récompensés de notre patience…
Ph : Oui, c’est en effet un récit, et un récit indigent. Un récit voué à disparaître, comme tous les récits qui donnent lieu à une croyance. Vous me direz, quelle est la valeur d’un récit auquel on ne croit pas ? Un récit qui n’entraîne pas notre désir d’y croire ? Il appartient en quelque sorte à tout récit digne de ce nom qu’on y croie. C’est par là qu’il manifeste sa puissance propre. Un récit auquel on ne croit pas, c’est sans doute qu’il est mal ficelé, que les personnages qui s’y trouvent manquent de vérité, que les événements narrés sont incohérents, que l’intrigue est cousue de fil blanc… Face à un roman ou un film dont le récit présente ces faiblesses, on «décroche». Parce qu’on n’y croit pas. Mais c’est que le mot «croire» n’a pas toujours le même sens. Quand je lis un livre ou quand, enfant, j’écoute quelqu’un me raconter une histoire, je pénètre le monde du récit, au point que plus rien d’autre n’existe pour moi. Je me suis transporté tout entier dans ce monde. Et je n’ai pas besoin de me retourner vers le monde «réel» en lui déniant sa réalité pour continuer d’accorder mon adhésion au monde du récit. Ma façon d’y croire est de m’y engager, et cette croyance s’accomplit sur le mode du jeu. En ce sens que c’est librement, en vertu d’un désir d’ailleurs, que je me porte vers le récit et que, de son côté, comme en réponse, le récit prend corps et inonde le monde de sa réalité. Au point d’ailleurs que le monde réel se trouve contaminé par celui du récit : il en devient le prolongement, il lui fait écho… L’autre sens du mot «croyance» renvoie, lui, à un récit dont la réalité s’impose à moi en dehors de tout élan ludique. Il s’appuie sur un principe d’autorité voulant que toute autre réalité soit nulle et non avenue. La croyance dans ce cas exige que je reçoive le récit sans rien y toucher, sans y prendre part à travers mon engagement. Comme si le récit était d’autant plus vrai qu’il était indemne de toute ingérence venant de moi, lecteur ou auditeur. C’est de cette croyance que je dis que tout récit qui en fait son soutien est voué à la disparition.
Md : Il y a donc un récit dont la réalité s’impose en exigeant qu’on ne s’en mêle pas, au risque d’en altérer la pureté, et de porter par là même atteinte à sa vérité, et il y a un récit qui se prête à une passion créatrice, en ce sens que s’ouvrir à la réalité de son monde revient à créer en même temps un monde nouveau. Autrement dit, le récit sert ici de matrice à un acte de création narrative. Et c’est d’ailleurs ce qu’on observe quand on lit de grands romans, par exemple : notre imagination se libère. Au point que si le roman est repris dans un film, on est souvent surpris de ne pas y retrouver ce qu’on a reçu à la lecture du livre. Au fond, ce n’est pas la même histoire. La raison, c’est qu’on n’y a pas été un lecteur passif : on a raconté l’histoire en même temps qu’on la découvrait dans le livre, et en la racontant on y a mis son propre souffle, ses propres couleurs, les arômes de ses propres rêves.
Ph : Oui, tu mets le doigt sur ce point d’équilibre où se rencontrent l’acte de recevoir et celui de donner : recevoir le monde du récit, c’est aussi le donner, par la puissance de son imagination. Et c’est ce qui caractérise le jeu en général, et le jeu amoureux en particulier…
Po : C’est vrai ! Dire à l’aimée qu’on l’aime, c’est une parole qui fait l’aveu de l’accueil en soi de quelque chose —un sentiment, un état affectif— qui est déjà là, mais c’est en même temps une parole qui inaugure chaque fois un ordre nouveau. Le constatif côtoie le performatif. Les deux sont interchangeables. Ça ne résume pas tout le jeu amoureux, bien sûr, mais ça suffit pour montrer comment la réceptivité se mue en action, et l’action en réceptivité.
Ph : Oui, le jeu amoureux illustre bien un certain rapport au récit en lequel le destinataire devient émetteur, et où dans cette inversion des rôles le récit gagne en vérité, précisément parce que sa vérité se joue dans l’inversion, dans le renouvellement perpétuel de ce passage de témoin entre l’émetteur et le destinataire, autant au moins que dans le contenu du récit.
Md : Il y aurait ainsi une dynamique du récit à la faveur de ce jeu d’inversion des rôles, dont le corollaire, me semble-t-il, est que le récit serait sans cesse recréé, jamais figé dans une forme définitive. Peut-être convient-il d’ailleurs de compter cette dynamique parmi les règles fondamentales de la genèse du récit. Tandis qu’une autre règle serait peut-être la suivante, à savoir que ce qu’il aurait à raconter, ce serait toujours aussi ce qui l’a empêché d’advenir. Vous gardez à l’esprit la vocation thérapeutique du récit, n’est-ce pas ! Ce que je veux dire en disant que le récit est toujours en même temps récit de ce qui l’a empêché d’advenir, c’est que le récit raconte d’un côté une naissance du monde, ou une naissance de l’humanité —fût-ce dans un homme singulier— et, d’un autre côté, un triomphe du monde sur le néant, de l’homme sur son errance, mais de telle sorte que c’est la parole qui se trouve en même temps libérée… Bien sûr, je parle ici des récits fondamentaux que sont les mythes dans la littérature antique, qu’elle soit écrite ou orale, mais ça concerne aussi les récits sous le signe desquels le fou parvient à redonner du ressort à son existence, d’une part parce qu’il a renoué avec la passion du récit, avec la passion du récit par quoi on se raconte et par quoi on raconte et, d’autre part, parce que le drame de sa perte de sens a lui-même trouvé une place centrale dans le récit. Ainsi le récit se raconte lui-même : le jaillissement de la parole affranchie de ce qui la retenait dans son mutisme.
Po : Cette manière de se raconter soi-même ne concerne pas tous les récits, en effet. Tu as parlé du mythe, et là encore la chose ne paraît pas toujours évidente. Mais c’est sans doute parce que le récit parle de son propre empêchement de façon allégorique, en prenant pour ainsi dire le déguisement des personnages qu’il met en scène. Pour le reste, pour les autres formes de récit, je ne pense pas qu’on puisse reconnaître la même règle… Le mythe a cette particularité que, comme la philosophie, il est tourné vers ce qu’Aristote appelle les premiers principes et les premières causes. Ce qui signifie bien qu’il a cette capacité à dire le pourquoi, aussi bien d’une naissance que d’un drame. L’auteur du mythe, qui est poète avant tout, ne se donne pas d’autre mission que de répondre à l’être-là du monde. Or cet être-là du monde, c’est aussi le surgissement de sa réponse, qui l’a précédé, lui le poète. Les deux vont de pair dans ce qui s’offre à lui dans l’instant de la rencontre. Ainsi, la recherche du pourquoi va porter dans le même mouvement sur le monde et sur cette parole sienne qui dit le monde : sur leur présence, et par conséquent sur leur absence aussi dont ils proviennent. Mais qu’est-ce qui obstruait jusque-là la venue de cette parole qui aspire de tout son être à dire le monde ? Voilà une question qui est en effet au centre de tout récit, dès lors en tout cas qu’il ne s’est pas donné une fonction spéciale, comme quand il devient fable ou légende. Parce que, dans ce cas, son propos n’est plus de dire l’être-là du monde, ni l’homme en tant qu’il est tourné de tout son être vers cet événement qu’est le monde : il est de dire quelque chose dans le monde, à propos du monde, en ayant certes recours au merveilleux… Répondre à la question de ce qui obstruait, c’est raconter la venue de la parole : cette parole qui elle-même raconte le monde.
Ph : Si je comprends bien ce que vous dites, le drame que met en scène le mythe dans la littérature tragique, par exemple, est toujours une manière pour le récit de se raconter lui-même sur un mode oblique, à travers un détour par l’intrigue qu’il met en scène. L’idée ne manque pas d’audace.
Md : C’est vrai qu’elle est audacieuse, mais elle m’est venue de façon assez naturelle, du fait que le point de vue que j’adopte est celui de la guérison de l’homme dont le mal réside justement dans le fait que sa parole n’est plus libérée. La passion retrouvée du récit, chez lui, est toujours en même temps retrouvailles avec sa parole, avec la puissance de dire de sa parole, et la pente naturelle de cette passion du récit est donc de se retourner vers la raison qui a fait que la parole a été empêchée, afin de l’envelopper dans la trame du récit… C’est tourner le dos à cette raison qui relèverait de mon point de vue d’un comportement artificiel et contre-nature. La parole de la guérison n’a pas le souci d’expliquer, au sens où le discours scientifique cherche à expliquer des phénomènes, mais elle veut quand même s’expliquer avec ce qui s’est passé. Le propos de son récit est à la fois d’accomplir jusqu’au bout l’acte de libération de sa parole et de se réconcilier avec le monde. Car il y a bien eu conflit. Or il n’y a pas de réconciliation sans retour au moment de la rupture, sans que le conflit ne se dévoile dans son étendue.
Ph : Je comprends que cette règle puisse s’imposer avec une certaine évidence dans le cas du récit dont l’homme guéri renoue avec la passion. Nous parlons de guérison par rapport à une maladie mentale, et ce type de maladie survient toujours, par-delà sa diversité, sous la forme d’une rupture avec le monde. Or la rupture se traduit à son tour par cet empêchement de la parole dont tu as parlé. Mais quand il s’agit du récit en général, en dehors de ce cas de pathologie mentale, pourquoi supposer que sa genèse doive passer par le détour d’un empêchement de la parole dont il aurait à comprendre l’origine, pour conclure en fin de compte que le récit est toujours récit de sa propre genèse ?
Po : La genèse du récit a très certainement sa spécificité dans le cas de la guérison du fou, mais je suis pourtant d’avis que tout récit fondateur, tout mythe, tout poème qui joue authentiquement le jeu de l’aventure poétique, ne peut être autre chose qu’une célébration de la parole, et que dans cette célébration il y a l’affirmation implicite qu’avant d’être célébrée, la parole était interdite. Dire que la parole était interdite, ce n’est pas laisser entendre qu’elle était soumise à une quelconque censure. C’est dire que, au moment où elle est pleinement elle-même, à célébrer le monde, la parole se déploie comme parole affranchie. C’est dire encore que l’essence de la parole s’accomplit dans le mouvement même par lequel elle se libère. De quoi, dirions-nous ? Hé bien, de ce moment où ce qui se donne à elle la laisse interdite : incapable de proférer le moindre mot. Il y a donc bien empêchement de la parole, même si cet empêchement ne vient pas de la violence d’un tiers, mais de l’irruption de la chose dans sa nouveauté. Face à cette irruption, la parole demeure interdite. Et ce n’est pas un moment de stupeur qui aurait à passer dès qu’on s’en serait remis. L’interdiction est sans limite de temps. Et pourtant, miracle, l’inespéré s’accomplit : la parole surgit. Voilà pourquoi, tout en célébrant le monde, c’est toujours en même temps le miracle de sa venue qu’elle célèbre. Et c’est en ce sens, me semble-t-il, que nous pouvons dire que le récit se raconte lui-même quand il nous raconte ce qu’il nous raconte…
Ph : Je note cette explication, sur laquelle je souhaiterais qu’on revienne. Mais je voudrais évoquer une troisième règle, même si c’est de façon brève. Nous avons relevé au début de cet échange que le récit se prête à une passion créatrice et que, en conséquence, il était sans cesse recréé. Nous avons ajouté que pareille recréation n’était pas synonyme de déperdition de sa vérité, qu’au contraire elle allait dans le sens d’un approfondissement. Cette précision, néanmoins, n’a pas supprimé la crainte que de création en recréation le récit perde son identité. Or il me semble qu’il y a quelque chose d’important qui entre en jeu et qui fait que cette identité est préservée. Cette chose, c’est qu’autour du récit se constitue une communauté d’écoutants. Et que la passion du récit fait donc de chacun le représentant d’une communauté élargie, dont les autres membres ne sont pour la plus grande part plus de ce monde depuis longtemps. Mais la façon de lire ou d’écouter le récit, si marquée qu’elle puisse être par la passion créatrice, n’empêche pas que s’exprime le souci de restituer le récit aux autres membres, de manière à ce qu’ils n’en soient jamais privés. Il faut que le récit puisse nourrir leur propre passion pour qu’ait lieu l’acte de partage par lequel la communauté continue de vivre, à travers la frontière des morts et des vivants. Voilà pourquoi les grands récits ont traversé les siècles sans subir d’érosion sous l’effet des reprises dont ils faisaient l’objet : à la passion du récit s’ajoute la passion du partage du récit, qui ouvre en profondeur l’espace communautaire en lequel ce partage est célébré.









