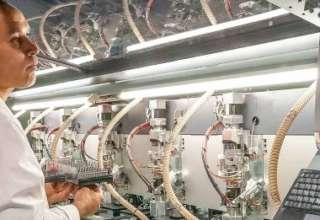Skander Baklouti a eu la chance de jouer aux côtés de Graja, Akid, Dhouib, les frères Trabelsi et l’inégalable Agrebi… Les fans du Club Sportif Sfaxien, ceux qui ont plus de 50 ans, se rappellent de cet attaquant vif et rapide qui aurait pu disputer en 1977 la première coupe du monde juniors de la Fifa organisée par notre pays.
Freinée par une méchante blessure, sa carrière ne sera relancée qu’au prix de mille et un sacrifices consentis par cet apôtre du panache et des envolées lyriques, soit la marque de fabrique du club sudiste.
Skander Baklouti, avez-vous conscience d’avoir évolué dans un club qui a un cachet particulier?
Oui, notre objectif consistait toujours à faire plaisir au public. Comme au théâtre, le spectacle prime. La devise consiste à bien jouer afin de parvenir à gagner. L’un est indissociable de l’autre. Au-delà du cachet, j’avais dès le départ l’impression d’intégrer une grande école du sport et de la vie. Nos dirigeants, qui étaient d’abord des éducateurs, nous ont appris à jouer pour le maillot.
Avez-vous été tenté d’aller jouer ailleurs qu’au CSS ?
En 1975, j’ai participé avec la sélection juniors au tournoi de Bastia, en France. Nous avions dans l’équipe Mohsen Rajhi «Zarga», un grand ami pour moi, Ferid Belhoula, Faouzi Marzouki qui était mon compagnon de chambre, Hassen Dakhli, Abderrazak Zarrouk, Lejmi, Samir Aloulou, Mohamed Ben Dhiab, Khemaies Ben Fattoum… soit le noyau de la sélection cadets dont j’avais également fait partie. Le club corse voulait m’engager, mais mon père a refusé. Je garde de ce voyage un autographe du phénoménal ailier gauche yougoslave Dragan Dzajic qui évoluait alors avec le SEC Bastia.
Dites-nous: comment êtes-vous venu
au football ?
Par le biais du quartier et du lycée. J’ai joué dans mon quartier El Ksar où naquirent Abdelwahab et Habib Trabelsi (CSS), Samir Haddar (SSS)… C’est mon prof de sport au Lycée des garçons de Sfax, Hmida Sallem, qui m’a piloté vers le CSS où j’ai été encouragé par toutes les grandes stars de l’époque : de Hamadi Agrebi à Abdelwaheb Trabelsi en passant par Mohamed Ali Akid, un vrai pote aux qualités humaines remarquables. Une fois, Slah Ayadi a raté une grosse occasion contre l’EST. De colère, Akid était venu en courant vers lui pour le gronder. Le soir même, il l’invitait chez lui pour le dîner. Il avait déjà tout oublié…
Avez-vous toujours évolué en attaque ?
Oui, j’ai occupé tous les postes en attaque : ailier, meneur de jeu, avant-centre, mais pas dans le genre classique, celui du colosse qui conclut les actions de la tête… J’ai appris le sens de la créativité en regardant Agrebi jouer et en tentant de répéter ses gestes, en voyant Ali Graja courir une bonne dizaine de mètres avec le ballon collé à la poitrine tel un aimant… Savez-vous que feu Akid a développé son jeu de tête phénoménal en allant préparer la saison avec l’équipe de volley-ball du CSS. Il était alors en désaccord avec le bureau directeur. Au contact de tels phénomènes, vous ne pouvez évidemment que progresser.
Vos parents vous ont-ils encouragé
à pratiquer le foot ?
Durant mes deux premières années avec les jeunes «noir et blanc», mon père Hamda, grand tailleur, n’a pas eu vent de ce que je faisais. Il n’a découvert le pot aux roses qu’une fois convoqué en sélection cadets. Le Yougoslave Jivko Popadic, qui entraînait alors les seniors, a fini par convaincre mon père de me laisser jouer. Quant à ma mère Fattouma, elle craignait pour moi de contracter une grave blessure. Car mon accident de moto l’a profondément marqué.
Quelle était votre idole ?
Le maître à jouer de l’Ajax et de la sélection des Pays-Bas, Johan Cruijff, un artiste à l’efficacité redoutable et un leader charismatique.
Et en Tunisie ?
Hamadi Agrebi, un talent hors du commun, un joueur pas comme les autres. Il invente des trucs extraordinaires auxquels personne ne s’attend vraiment. Par comparaison, ceux qui jouent en face paraissent fades et stéréotypés. La télévision n’a malheureusement pas rendu compte de toute la dimension de ce génie, car il a livré ses meilleures prestations sur la terre battue du «Mhiri» avant que notre stade ne soit gazonné. Au début des années 1970, dans un match amical contre l’OGC Nice, il a marqué en 23 minutes trois buts dans les filets de Dominique Baratelli avant de sortir sur blessure. Répondant à une question d’un journaliste de France-Football qui lui demandait quels joueurs conseillerait-il à son club de prendre, le keeper azuréen a répondu : «Un joueur tunisien du nom d’Agrebi !». Bref, Hamadi est tout simplement le meilleur footballeur tunisien de tous les temps.
En 1983, à seulement 25 ans, vous mettez un terme à votre bail avec le CSS pour partir au SSS où vous jouez durant trois autres saisons. N’était-ce pas prématuré ?
Oui. Pour plusieurs raisons, j’ai fini par craquer. Notre entraîneur au CSS, le Yougoslave Milor Popov, m’a fait fuir. Il y eut aussi ma nomination à Zaghouan, car je venais d’obtenir ma licence de Professeur d’éducation physique et sportive à l’Ineps de Ksar Saïd, et je devais entamer ma carrière professionnelle là-bas. Si loin de Sfax, je ne pouvais plus poursuivre ma carrière de joueur au plus haut niveau avec un club comme le CSS avec la régularité, l’implication et le sérieux requis.
Quel genre de différend avez-vous eu avec Popov ?
D’une certaine façon, le technicien yougoslave m’a fait dégoûter du football. Notre président de club lui disait qu’il devait me ménager, car je revenais d’une blessure sérieuse (fracture de la rotule). Eh bien, il n’en faisait qu’à sa tête, insistant afin que je rejoue vite sans tenir compte des délais de rétablissement prescrits. Je lui répétais que le médecin m’a concocté un programme de rééducation que je devais scrupuleusement respecter, mais il ne voulait rien entendre ! Notre différend a commencé ainsi. Il allait se développer quelques saisons plus tard. Popov ayant émigré au Stade Sportif Sfaxien, en plein derby CSS-SSS, je lui ai adressé du bord de touche des remarques déplaisantes. Eh bien, en 1982, dès son retour au CSS, il a sorti les griffes comme on dit en m’écartant de l’effectif et en me marginalisant. Je n’ai pas attendu longtemps pour aller conclure ma carrière aux «3S».C’est sûr: le bonhomme est rancunier. Certes, mon geste était condamnable; je le mets sur le compte d’un péché de jeunesse. Mais m’attendre au tournant tout ce temps-là afin de régler ses comptes, eh bien !… Une fois, Popov a donné la liste des joueurs convoqués un vendredi avant la séance d’entraînement. Agrebi ne figurait pas sur cette liste. Eh bien, ce dernier a pris sa voiture et s’en est allé sans s’entraîner en disant : «Pourquoi le ferais-je puisque je ne vais pas jouer dimanche !». Devant la grogne du public, le président a été amené à imposer Agrebi dans le onze rentrant. A la barbe et au nez du Yougoslave.
Vous avez dû, à chaque fois, livrer une rude concurrence pour arracher une place dans l’effectif rentrant…
Henchiri, Derbal, Laâdhar et moi-même étions pratiquement d’un même niveau. Malheureusement, je ne me suis jamais exprimé à cent pour cent de mes moyens. Les séquelles de la blessure contractée tout jeune, je les ai traînées comme un boulet durant tout mon parcours. Je n’étais jamais revenu à mon meilleur niveau.
Comment cela vous était-il arrivé ?
Dans un accident de moto, en compagnie de Chokri Cheikhrouhou qui n’avait pas encore signé au Club Sportif Sfaxien. Je rentrais d’un cours chez feu Moncef Melliti, notre prof d’arabe et grand latéral gauche international du CSS. J’étais alors membre de la sélection juniors qui allait participer à la première coupe du monde de la catégorie organisée en 1977 à Tunis. Après cet accident, tout le monde pensait que j’étais définitivement perdu pour le foot. J’ai dû faire preuve d’énormément de volonté et d’obstination pour revenir sur les terrains. Mohamed Ali Akid, qui était infirmier, était venu chez moi me raconter ce que lui a dit Dr Dhiab, c’est-à-dire que mes chances de rejouer étaient infimes. Sans cette blessure, j’aurais, à coup sûr, fait une bien meilleure carrière. Notre entraîneur Radojica Radojicic m’appelait Cruijff, la vedette hollandaise alors en vogue. Bref, cet accident de moto reste mon plus mauvais souvenir.
Et le meilleur ?
Les deux titres de champion de Tunisie remportés, le premier en 1977-1978 sous la conduite du Yougoslave Milor Popov, le deuxième en 1980-1981 sous la férule de l’Allemand Michel Pfeifer. Certes, je n’ai pas été un titulaire à part entière en raison de la qualité de la concurrence dans la ligne d’attaque, mais je crois avoir pris une part dans ces conquêtes.
Une telle concurrence, comment
l’avez-vous vécue ?
De façon sereine, je crois. Je m’entraînais normalement, et mes rivaux pour un poste de titulaire restaient toujours mes amis. Je jouais le foot pour le foot, sans calculs. Tant que les gens m’aiment et apprécient mon engagement, que je joue ou non, il n’ y a pas vraiment de soucis à se faire.
Quel est votre meilleur match ?
Le premier match officiel de ma carrière, en 1975 face au Stade Tunisien. Il y eut aussi celui de la saison 1979-1980 contre l’ESS à Sfax (1-1), et celui de 1982-1983 où j’ai marqué un but à Sousse.
Quels furent vos entraîneurs ?
Chez les jeunes, Hmida Sallem, Rachid Daoud, Mongi Dalhoum et Mohamed Matmati El Gaied. Avec les seniors, Rado, Habib Jerbi, Mongi Dalhoum, Michel Pfeifer, Manfred Stevens et Milor Popov. En sélection cadets, Slah Guiza et Mohamed Salah Jedidi. En sélection juniors, Mokhtar Tlili, Abdelmajid Chetali juste le temps du tournoi de Genève, Larbi Zouaoui et Moncef Melliti.
Et les meilleurs ?
Dalhoum et Rado. Ce dernier m’a lancé dans le grand bain des seniors alors que j’étais deuxième année cadets. J’ai commencé en même temps que le gardien Abdelwahed Ben Abdallah. Nous avons trouvé dans l’effectif les cadres mythiques que tout le monde connaît : Akid, Agrebi, Dhouib, Habib et Abdelwahab Trabelsi, Graja, Melliti, Abderrazak Soudani, Benghazi, Ben Barka… Moncef Grich et Ameur Lejmi étaient, en ce temps-là, les gardiens. De leur côté, Medhioub, Abdelmoula, Ayadi, Hafedh et Elyès Ben Salah… allaient débarquer par la suite.
Le foot de quartier a disparu. C’est grave ?
Et comment ! Jadis, à Sfax, du côté de la Poudrière, appelée champ de course, chaque dimanche de 8h00 à 18h00, au moins une vingtaine de rencontres inter-quartiers étaient organisés. Les jeunes d’aujourd’hui ne bénéficient plus de ce passage obligé que les académies privées ne pourront jamais remplacer. Je ne crois pas qu’elles peuvent produire des talents. Elles ne sont d’ailleurs accessibles qu’aux plus riches, c’est-à-dire les jeunes dont les parents, par la force de l’argent, imposent à l’entraîneur de titulariser leurs enfants.
Souvent au détriment de jeunes plus doués mais qui viennent de familles démunies. Pourtant, dans un sport de contact comme le foot, les jeunes pauvres ont normalement plus de chances de s’imposer, car ils connaissent mieux ce qu’est «se frotter», souffrir, aller au charbon, suer sang et eau… Le sport-roi doit leur servir de moyen de promotion sociale. Nous allions dans le club pour bénéficier d’un casse-croûte ou d’un paquet de lait. Par ailleurs, il est temps de réviser les temps scolaires de façon à réserver tout l’après-midi aux activités sportives et culturelles, comme cela se fait en Arabie Saoudite, par exemple.
Justement, vous avez longtemps entraîné en Arabie saoudite. Quelle différence y a-t-il avec l’exercice de ce métier dans notre pays ?
Une grande différence, en fait. Là-bas, vous n’avez aucun souci, sauf celui de vous concentrer sur votre boulot sur le terrain.
Chacun sait, qu’en Tunisie, un entraîneur s’occupe de tout sauf des affaires du terrain, et qu’il est couramment insulté, voire menacé.
Dans les divisions inférieures, il y a pire. Vraiment, de quoi vous dégoûter !. D’autant que le cadre général est déprimant. La violence sociale est transposée dans les stades où les groupes de supporters d’un même club se font la guerre.
Qu’est-ce qui a changé entre le foot
d’hier et celui d’aujourd’hui ?
Il ne faut pas comparer l’incomparable. Certes, point de vue physique, tactique, de l’infrastructure, du suivi médical…, le football a énormément évolué. Seulement, les joueurs actuels paraissent se livrer à du pousse-ballon quand on les compare aux génies d’hier. Celui qui n’a pas eu la chance de voir à l’œuvre les Agrebi, Tarek, Temime, Akid, Attouga, Chetali, Hbacha… ne connaît rien au vrai football.
Si vous n’étiez pas dans le foot,
qu’auriez-vous fait ?
J’aurais suivi un métier dans l’aviation civile. Malheureusement, l’année de notre orientation universitaire, l’école de pilotage de Borj El Amri était fermée. J’ai décroché un bac Maths-sciences. Lors de l’entretien d’accès à l’Ineps, notre prof, Abbès Kassar, me demandait ce que je venais faire là-bas. Eh bien, j’ai terminé mon cursus universitaire major de promotion, en 1985. Mon mémoire de fin d’études intitulé «La Coupe du monde, baromètre de l’évolution du football» m’a valu un 18 sur 20. Dans la pratique du FB, le niveau intellectuel est très important. Jadis, il était possible, moyennant de gros sacrifices, de concilier sport et études. La preuve: Raouf Najjar, Hachemi Ouahchy, Hamed Kamoun, Moncef Melliti, Ayadi, Habib Jerbi, Hmida Sallem… ont tous suivi avec bonheur des études universitaires. Maintenant, ce n’est plus vraiment possible.
Parlez-nous de votre famille…
J’ai épousé en 1987 Thouraya Abid, prof de sport, issue d’une famille sportive. Ses frères ne sont autres que Najah Abid, l’ancien basketteur et entraîneur du Stade Nabeulien, et Jawhar Abid, l’ancien rugbymen du SN et de l’équipe nationale. Nous avons deux enfants : Sami, ingénieur informaticien, et Sana, étudiante à Limoges, en France.
Quels sont vos hobbies ?
Je fais de la marche un jour sur deux. J’aime aussi le jardinage et élever les oiseaux. Devant le petit écran, je regarde le foot européen, surtout les matches du CSS et du Barça.
Des regrets ?
Peut-être pour ma carrière d’entraîneur, là où j’aurais pu faire mieux. Un jour, Naoufel Zahaf m’a proposé de faire l’assistant du Brésilien Paulo Rubim, mais j’ai refusé. Car, pour le reste, si c’était à refaire, je le referai dans les moindres détails. Je n’ai rien à regretter, le foot m’a tout donné. Mon statut, je le dois au sport. Un peu à l’unisson avec Albert Camus qui avoue : «Tout ce que je sais sur la morale et les obligations des hommes, c’est au football que je le dois !».
Enfin, êtes-vous optimiste pour l’avenir
de la Tunisie ?
Personne ne peut nier que notre pays a énormément régressé. Depuis la révolution, nous avons certes gagné la liberté d’expression, et pouvons compter aujourd’hui sur douze millions de politiciens. Mais il n’ y a plus ni loi ni morale respectées. Ni mon entraîneur Mongi Dalhoum ni mon père n’ont jamais su que je fumais. Je ne le faisais jamais en leur présence… Autres temps, autres mœurs !