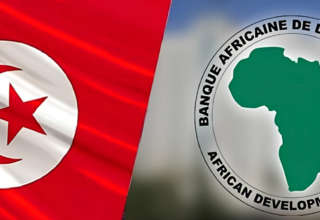Neuf ans, presque une décennie. Neuf années, traversées de soubresauts, de grondements sourds, de revendications, incessamment reconduites, vouées, pour la plupart, à une fin de non-recevoir. Neuf ans et la société tunisienne est plus malade qu’elle ne l’a jamais été.
Il faut se méfier des anniversaires, célébrations et autres « dates-butoir. » Elles ne servent qu’à donner l’illusion d’un virage, alors que la route, au prix d’un minuscule détour, continue, toute droite. Comment étions-nous, le 10 janvier 2011 ? Que sommes-nous devenus,le 14 janvier ? Le soulèvement populaire de 2011, «a priori » non commandité, scandait des désirs,aussi précis que difficiles à exaucer : travail, liberté, dignité. A eux seuls, ces mots, venus de bien avant ce fameux 14 janvier,exprimaient une frustration, générée par des décennies de choix politiques inadéquats. A eux seuls, ils résument les plaies ancestrales de notre société.
S’il fallait fixer un début à cette société difforme, tout en creux et bosses, il faudrait remonter avant l’Indépendance, voire avant l’ère coloniale, à l’époque où les beys, calfeutrés dans leurs palais et leurs privilèges,prélevaient des dîmes éhontées auprès de paysans n’ayant d’autre choix qu’obéir. Donc, l’histoire est ancienne.
De 1956 à 2011, trois constantes ont perduré, façonnant notre paysage social, notre sensibilité collective, et engendrant les slogans, clamés au matin du 14 janvier 2011. Première constante : le clivage est-ouest de la Tunisie, schisme très ancien, plus lié à la géographie qu’aux hommes : les côtes, lieu de navigation et de commerce, ont toujours connu une activité débordante, accumulant investissements et infrastructures. A cela, s’est ajoutée une pirouette de l’histoire, ayant recruté, à partir des régions côtières, la presque totalité de la classe politique,entre 1956 et 2011. En revanche, les zones de l’ouest ont longtemps souffert (et continuent de souffrir) d’un abandon de la part des politiques et d’une misère persistante au fil des ans.
Une seconde constante a été l’absence d’implication de la jeunesse dans la conduite des affaires de l’Etat. Une jeunesse que Bourguiba avait, pourtant, eu à cœur d’éduquer, promulguant l’enseignement pour tous, dès l’Indépendance. Malheureusement, de 1956 à 2011, pouvoir et décisions ont été détenus par les mêmes personnes, selon une perpétuelle redistribution des cartes. Au fil du temps, nos dirigeants ont vieilli, de sorte qu’au soir du 14 janvier 2011, la Tunisie, avec ses 30% de citoyens, âgés de moins de 20 ans, était, depuis des lustres, gouvernée par des vieillards…
Une troisième constante, remontant aussi loin dans le temps, réside dans la corruption qui a, peu à peu, investi toutes les franges de la société : avant tout, l’administration publique, cette infrastructure vermoulue, devenue complètement obsolète, en porte-à-faux avec les méthodes de gestion moderne. Administration paralysée par une corruption sévissant à tous les échelons, depuis le chaouch jusqu’au directeur, sans compter les pots-de-vin distribués par le citoyen, en échange de chaque menu service… Mais la corruption a aussi pris ses quartiers chez les politiques : avec le temps et l’usure, les régimes de Bourguiba puis de Ben Ali ont basculé dans les passe-droits et le népotisme, installant la corruption au sommet de l’Etat. Tout comme eux, les gouvernants d’après-2011 ont poursuivi la pratique, éprouvée, de leurs prédécesseurs…
En somme, la disparité est-ouest, l’oubli de la jeunesse et la corruption généralisée minaient notre société, bien avant 2011. Malgré l’immense élan nationaliste, suscité par l’Indépendance, ces tares sociales ont maintenu l’esprit de clan, et conforté une appartenance tribale, toujours vive au cœur des êtres, appartenance qui se dressait tel un plan B, une solution de rechange à une conscience nationale que les tares sociales ancestrales empêchaient de prendre racine. A chaque turbulence, voici l’obédience tribale ou régionale qui reprend ses droits et oppose les individus.
Ainsi, l’histoire a grevé notre société d’un déséquilibre immémorial, et de plaies, toujours vives. Mais ces plaies étaient soigneusement colmatées par la peur et le silence régnant au sein des dictatures successives. Après le 14 janvier 2011, la libération de la parole a ravivé les plaies. La Tunisie s’est remise à parler : dans la rue, sur les médias, dans les rassemblements populaires ou politiques. Très vite, une confusion a surgi dans les esprits, assimilant « liberté de parole » et « liberté tout court ». Cette confusion a été soigneusement entretenue par nos « nouveaux maîtres », ces islamistes, accourus de l’étranger, ou sortis de leurs geôles, pour ne pas « rater le début du spectacle ! » Tous réjouis de voir la parole rendue au peuple… Quoi de plus simple que de faire croire au Tunisien qu’à partir du moment où il pouvait dire tout et n’importe quoi, il devenait libre ! Entre-temps, les ficelles étaient tirées dans l’ombre, remplaçant l’ancien régime par un autre, plus pernicieux : néolibéral, désireux d’imprimer à la société une mouture islamiste, et, si possible, une Constitution émanant de la Chariaa, un régime pressé de rattraper le temps perdu,de jouir du pouvoir, et d’amasser des fortunes considérables…
Mais la liberté de parole n’est que le premier pas, en direction de la liberté. Une parole sans actes se cantonne dans l’enclos stérile du bavardage. La liberté ne vaut que si la parole se mue en action,changeant les êtres et leurs conditions de vie, action qui, pour Hannah Arendt, représente l’essence de l’exercice politique.
Malheureusement, le 14 janvier 2011 n’a libéré que la parole. Pas d’actes, pas d’implication de la jeunesse dans la conduite de l’Etat, ni de réformes dans les structures d’un pays dont les fondements remontent à l’Indépendance. Pour le reste, rien n’a changé ou presque et la grande erreur des nouveaux dirigeants a été de ne pas tenir compte des demandes, formulées lors des manifestations ayant secoué le pays. Cela pouvait être justifié par le manque de moyens de l’Etat, mais rien ne justifiait un autre manque, flagrant : celui de la communication des hommes politiques avec leurs concitoyens. Ainsi, durant les neuf années écoulées, les Tunisiens, isolés de leur classe politique, étaient, tout entiers, pris par une parole, devenue leur seule manière d’exercer leur citoyenneté.
Cette parole libérée a brisé la gangue de silence qui emmurait les êtres, dévoilant une société malade de frustration, d’injustice tue, de misère, alors que, sur les autoroutes, des berlines à cent cinquante millions pièce fonçaient au grand jour. Contemplant ces berlines et les bienheureux nantis, assis au volant, les citoyens accumulaient rancœur et aversion. Dès lors, la porte s’est ouverte, toute grande, à la violence.
Il est établi que les bouleversements sociaux attisent la violence, et nous n’avons pas failli à la règle. Mais notre violence a eu la couleur du désespoir : pour preuve, la vague de suicides qui s’est abattue sur le pays (et continue de sévir), affectant essentiellement les jeunes. Sacrifier sa vie indique un dénuement et une souffrance, à nul autres pareils. Ceux d’une jeunesse n’ayant plus d’horizons, et qui a perdu le cap de l’espoir. Oh, un espoir tout simple : trouver du travail, disposer d’un accès aux soins, fonder une famille, être heureux… En vérité, ces demandes sont des droits et tout gouvernement se doit d’offrir à sa population ces pré-requis de l’existence,ce « Smig » de dignité, redevable à tout être.
Autre violence, mâtinée de désespoir : les départs sauvages pour l’Italie. Départs en fraude, à bord de rafiots presqu’inéluctablement condamnés au naufrage. Départs financés à coups de millions par la famille, désireuse d’offrir à un fils les conditions d’une vie meilleure. « Ailleurs » est toujours plus beau qu’ici, n’est-ce pas ? Hélas, les « ailleurs » capotent souvent au fond d’une Méditerranée, devenue un tombeau à ciel ouvert…
Puis, très vite, la violence s’est alliée à la colère et les êtres, ne comprenant pas pourquoi leurs demandes n’étaient pas prises en compte, immédiatement et en totalité, ont entrepris de fermer des routes, de paralyser le bassin minier ; ils ont observé des sit-in, devant les sièges des ministères ou des gouvernorats. Violence, désespoir, colère, autant d’ingrédients qui débouchent sur le crime et les agressions de toutes sortes. Oui, nous vivons cela et c’est sans doute un passage obligé.
A la colère de ne pas voir leurs revendications prises en compte, s’est ajoutée une profonde déception qui, désormais, habite les Tunisiens : déception à l’égard des dirigeants successifs lesquels, par naïveté et surtout par roublardise politique, leur ont fait miroiter monts et merveilles et n’ont tenu aucune de leurs promesses. Une déception qui rend compte du résultat des dernières élections présidentielles : vote-sanction contre une classe politique, championne des rendez-vous manqués…
Mais les périodes de trouble et de marasme social, passage obligé, n’ont d’autre choix que de passer. On peut aussi les lire comme des phases préliminaires à un changement social qui s’effectue déjà sous nos yeux mais dont l’ampleur demeure difficile à déchiffrer. Tout au moins, pouvons-nous en déceler les traits les plus saillants. L’un d’eux est, sans conteste, la conscience politique acquise par la société tunisienne. Désormais, la politique,devenue l’affaire de tous, est largement disséquée dans les cafés, aux coins des rues, et sur les réseaux sociaux, même si sondages et interviews nous montrent un citoyen amer, se détournant des politiciens et de leurs combines, ce désenchantement n’est pas synonyme de démission politique. Il constitue, au contraire, une prise de position, claire et nette, contre les agissements des partis, contre des gouvernements aux prestations médiocres et à l’indifférence affichée. Jamais la prise de conscience citoyenne n’a été aussi forte. Cette prise de conscience représente le prélude à une action qui a déjà commencé, mais demeure encore« juvénile » : agressive, emportée, hésitante, en proie à des revirements, incapable de changer les choses…
On ne se baigne jamais dans le même fleuve, c’est bien connu. La société de ce 14 janvier 2020 est à mille lieues de ce qu’elle était en 2011. Loin de constituer une masse amorphe et silencieuse,elle représente un pays en devenir.
L’apprentissage de la liberté et de l’action politique est long et douloureux. A l’image des femmes, condamnées depuis la nuit des temps à enfanter dans la douleur, c’est aussi dans la douleur que les sociétés accouchent de nouvelles façons d’être et d’agir. Or, nous assistons aujourd’hui à l’enfantement d’une nation, à la naissance d’une société nouvelle. Le temps sera long, le chemin difficile, et nul ne peut prévoir ce qui attend encore les Tunisiens. Mais notre société offrira d’autres visages, apaisés, confiants en l’avenir. Des visages qui façonneront la vie et regarderont vers demain. D’ailleurs, que valent neuf années dans la vie d’une nation ? A peine quelques gouttes dans un verre qui se remplit patiemment. Un jour, pourtant, on découvre que le verre est plein et voici qu’une «goutte de trop» métamorphose les êtres et leur destin…
-
14 milliards de dinars investis en 30 ans : bilan du Programme de mise à niveau industrielle en Tunisie
Depuis le lancement du Programme de mise à niveau industrielle (PMN) en 1995, environ 14 m… -
Rapport BAD : où en est la Tunisie sur la fourniture des services publics ?
La Tunisie se classe au 8e rang des pays les plus performants en Afrique selon l’indice de… -
Quand les algorithmes cannibalisent le trafic des médias
Google fait face à une transformation majeure dans le domaine de la recherche en ligne. Ce…
Charger plus d'articles
-
L’huile d’olive tunisienne rafle 64 médailles au concours scandinave 2025
La Tunisie a remporté la première place à la quatrième édition du Scandinavian Internation… -
Baignades : La protection civile met en garde contre les chocs thermiques
Le porte-parole de la Protection Civile a mis en garde contre les chocs thermiques lors de… -
Retour en images sur la conférence de presse de Tunisie Telecom et de l’ESS : Deux partenaires historiques unis à nouveau
La société nationale des télécommunications, Tunisie Telecom, et le club omnisports Étoile…
Charger plus par La Presse
-
Quand les algorithmes cannibalisent le trafic des médias
Google fait face à une transformation majeure dans le domaine de la recherche en ligne. Ce… -
249e anniversaire de l’indépendance américaine : l’ambassade des États-Unis réaffirme son engagement envers la Tunisie
À l’occasion de la célébration du 249e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, l’am… -
Fin de collaboration entre le MC Alger et Khaled Ben Yahia après une saison victorieuse
Le MC Alger, sacré champion d’Algérie de Ligue 1 pour la saison 2024-2025, a annoncé ce ve…
Charger plus dans Actualités
Cliquez pour commenter