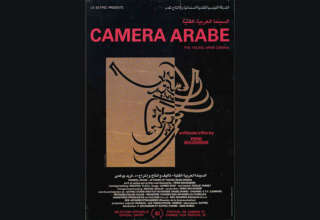Journaliste, chroniqueur et romancier, Sofiane Ben Farhat a obtenu le Prix Comar d’Or 2021 pour son roman «Le chat et le scalpel». Il nous a accordé cet entretien.
Que peut rajouter un Comar d’or à un auteur de votre trempe?
En fait, toute reconnaissance est la bienvenue, surtout s’il s’agit d’une aussi prestigieuse distinction littéraire, plus particulièrement romanesque. Cela témoigne que, malgré tout, il y a encore une petite place à l’art dans notre société désespérément livrée à la laideur et aux entourloupes de pseudo-politiciens obscurs et douteux. Malheureusement, chez nous, l’art est relégué aux oubliettes et les vrais artistes sont très peu estimés ou du moins méconnus par la population. Celle-ci est aux prises avec les instincts primaires des foules, avec leurs frustrations, leur tyrannie grotesque, leurs obsessions et leurs penchants pour la vulgarité savamment entretenue par les réseaux sociaux et leurs atours clinquants mais, somme toute, nocifs. La cuisante faillite du système éducatif concourt à ce constat amer. Jusqu’ici, j’ai publié douze livres. Chacun d’entre eux, les romans particulièrement, est une espèce de bouteille jetée à la mer. Si d’aventure elle trouve preneur cela fait mon bonheur.
De quelle manière votre expérience de journaliste a-t-elle enrichi votre expérience de romancier ?
Un journaliste, à mon avis, est une espèce de romancier du réel, aussi bien qu’un historien de l’instant par moments. Cela dépend des tempéraments, des situations et du style. Toutefois, pour parler de l’art romanesque, j’estime que l’écriture est le plus difficile des arts et le roman est la plus pénible des formes d’écriture. Quand on a la chance de travailler des décennies durant comme journaliste — c’est un métier envié, vous savez— on a l’insigne chance surtout de participer à l’intensité du vécu, sous toutes ses formes et dans toutes ses déclinaisons. Dans notre métier, il n’y a point de journalisme s’il n’y a pas des gens. L’homme est au cœur de tout. Les gens, ce sont les espoirs, les illusions, les souffrances, les douleurs, les joies, les exaltations, un perpétuel carrefour de sentiments et d’états d’âme. Le journalisme est un excellent promontoire pour l’observation des caractères, des passions et des psychologies individuelles, segmentaires ou collectives. C’est une mine pour le romancier. Toutefois, l’écriture romanesque obéit à des impératifs esthétiques et des factures discursives spécifiques. Le journalisme offre bien souvent le matériau de base. Pour le reste c’est un travail de joailler et de sertisseur. Parce que le mot romanesque est précisément un carrefour de sens. Le travail journalistique, qui est loin d’être une écriture mineure, est plus fonctionnel dans les différents genres journalistiques. Et Dieu sait qu’il y en a une bonne trentaine. Moi, j’ai deux demeures pour ainsi dire, le journalisme et la littérature. Quand l’une m’ennuie, je loge dans l’autre. Cependant, mon humble travail romanesque se fait en quelque sorte en contreplongée et à la verticale de mon perpétuel travail journalistique.
Dans «Le chat et le scalpel», vous décrivez la Tunisie de l’«ici et maintenant», la Tunisie de 2018 avec moult personnages et un récit parfois dans la démesure. Pourquoi le choix de ce style ?
Justement, j’ai un penchant particulier pour le genre picaresque et le réalisme magique. Dans l’Antiquité, le Carthaginois Apulée avait écrit le premier roman dans l’histoire de l’humanité, «Les Métamorphoses», que Saint Augustin, un autre illustre berbère carthaginois, avait baptisé «L’Ane d’or». Il y a tous les ingrédients premièrement du roman et deuxièmement du réalisme magique ou même fantastique. Gabriel Garcia Marquez avant la lettre en somme. Puis il y a eu le plus grand roman de tous les temps, «Les Mille et Une Nuits», écrites par les Arabes sur plusieurs siècles, sans qu’on sache qui les a écrites. C’est l’ancêtre du roman moderne, du «Don Quichotte» de Cervantès à «Le tambour» de Günter Grass en passant par «Ulysse» de James Joyce et bien d’autres chefs-d’œuvre. Les «Mille et Une Nuits» demeurent inégalées et inépuisables, je les ai lues et relues cent fois. Il y a justement la démesure, les digressions, et toutes ces belles choses que, selon André Gide, souffle la folie et qu’écrit la raison. Il disait qu’il faut demeurer entre les deux, tout près de la folie quand on rêve, tout près de la raison quand on écrit. C’est pour cela que j’aime et que je cultive la démesure dans mes écrits romanesques. Y a-t-il plus belle histoire que celle de Shahrazade et Chahrayar et des sept voyages de Sindbad le marin ou plus belle invention dans la fiction que le tapis volant ? La démesure, c’est cela précisément. Je suis un Oriental vous savez.
Le roman décrit également les conséquences atroces de la révolution avec une manière très particulière. Quelles leçons, vous personnellement, avez-vous tiré de cette tranche de notre histoire ?
Vous savez, là où il y a révolution, il y a confusion. Dans les dimensions cosmiques autant que dans les sphères politiques et sociales, les révolutions sont des libérations, quoiqu’inévitablement violentes au début. Mais le standard de base demeure la liberté. Et la liberté finit toujours par triompher. C’est l’unique vérité de l’histoire. Il nous appartient de rectifier le tir afin que tout cet élan ne soit guère synonyme d’asservissement et de misère comme ce fut le cas jusqu’ici. Chez nous, en 2011, ce fut plutôt une révolte qui a été sitôt instrumentalisée par des arrivistes de tout poil. Comme le dit l’un des protagonistes de mon roman : «Chez nous aussi ce fut spontané. Sans chef, sans programme, ni idéologie.
Avant que ne surgissent les rapaces. Des vautours de haut vol venus, Dieu sait d’où. Qui, des cercles parigots et londoniens dorés ou des officines des chancelleries grises et douteuses. Qui, des déserts ambrés des satrapes d’Orient. Qui, des tanières à rats. C’est la curée, la mêlée pour le pouvoir vacant. Et vous voyez bien où nous en sommes. Une transition bloquée qui ne cesse de se réitérer. Un degré zéro qui se réinvente hystériquement, en boucle.» Mais c’est une tranche de notre histoire comme vous le dites si bien. Il faut l’assumer. Redresser la barre et renverser la vapeur au besoin. J’ai vécu et je vis cela en m’investissant à fond dans le journalisme et en écrivant des romans de temps en temps. Rassurez-vous, cher ami, si j’avais à choisir, je ne serais derechef, encore et toujours que journaliste (rires) .