
La guerre en Ukraine a braqué les projecteurs et révélé l’importance cruciale que revêt le secteur stratégique de l’agriculture en Tunisie pour garantir sa sécurité alimentaire. La volatilité des prix des denrées alimentaires, qui s’est accentuée avec le conflit russo-ukrainien soulève, en effet, le problème de la dépendance alimentaire des pays intermédiaires, à l’instar de la Tunisie qui importe une grande partie de ses besoins en céréales ce qui place la politique agricole de notre pays face à de nouveaux défis et enjeux. Elle a surtout mis à nu les limites et le manque de performance d’un système agricole peu résilient, responsable de la surexploitation et de l’appauvrissement des ressources naturelles et qui est inapte à s’adapter aux facteurs endogènes et exogènes liés aux aléas climatiques. Face à l’exacerbation de ces nombreuses menaces et à l’urgence climatique, la non durabilité de l’agriculture et l’absence de vision et de stratégie à moyen et à long terme pèsent comme une épée de Damoclès sur la sécurité alimentaire et rendent, plus que jamais, impérieux le passage à un système agricole évolutif, innovant, moins dépendant des ressources naturelles conventionnelles et doté d’une capacité d’adaptation aux changements climatiques. Ancien professeur à l’Inat et auteur du livre «L’agriculture tunisienne à la croisée des chemins, quelle vision pour une agriculture durable?», Pr Ali Mhiri apporte un éclairage intéressant sur l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Entretien
Professeur, mes questions émanent de ma lecture de votre livre «L’agriculture tunisienne à la croisée des chemins, quelle vision pour une agriculture durable en Tunisie ?», publié en 2018, dans lequel vous exposez votre vision de l’avenir de ce secteur. Votre ouvrage m’a éclairée sur l’importance du secteur agricole pour le développement du pays. Pouvez-vous nous rappeler votre diagnostic de l’état des lieux de l’agriculture en Tunisie que vous qualifiez de non durable ?
Vous avez raison, c’est probablement l’un des secteurs les plus difficiles à analyser et à comprendre, étant donné la multiplicité des objectifs, des acteurs et des centres de décision aux niveaux local (l’exploitant), régional (des segments des filières, le marché…) et central (politique agricole et structures d’encadrement), n’ayant pas forcément les mêmes stratégies, ni les mêmes intérêts. Et pour répondre à votre question, il me paraît nécessaire, pour gagner en efficacité, de commencer par présenter, très brièvement, les concepts élémentaires qui définissent le champ d’investigation et de réflexion sur l’agriculture, à savoir : les fonctions de ce secteur, ses facteurs de production et son organisation en systèmes de production. Le système agricole assure trois fonctions fondamentales, à savoir une fonction économique, une fonction sociale et une autre environnementale, donc pas seulement celle de la production des denrées agricoles comme le croient de nombreux citoyens. A travers ses fonctions, le secteur agricole assure les sécurités alimentaire, hydrique, environnementale et sociale. C’est sur la base des performances de ces fonctions, érigées en fondements du développement agricole durable, qu’on évalue la durabilité de cette agriculture. Jadis, ces trois fonctions étaient assumées par les agriculteurs eux-mêmes au niveau de leurs exploitations, ou au niveau communautaire dans certains systèmes comme les oasis, ou les parcours. Aujourd’hui, l’exploitant agricole est acculé, pour survivre, à reléguer la fonction environnementale au dernier plan de ses soucis. Concernant les facteurs de production, il s’agit de toutes les ressources engagées directement ou indirectement dans le processus de production, dont principalement les ressources naturelles exploitées, le savoir-faire local au niveau de l’exploitation, auxquels s’ajoutent les facteurs d’encadrement (capacités humaines dans les structures de recherche et de vulgarisation) et de facilitation (institutionnelle, juridique, financière), organisations professionnelles… Tous ces facteurs de production se déclinent sur le terrain, soit en “atouts” ou en “contraintes”, qui déterminent des potentiels de performances réalisables plus ou moins élevés. S’ajoutent à ces facteurs endogènes des atouts ou des contraintes exogènes liées aux grands changements globaux, comme le changement climatique ou le marché international. Quant aux systèmes de production agricoles, ils englobent les systèmes de productions pluviaux (céréaliers et oléicoles), les systèmes de production irrigués, très diversifiés, Les écosystèmes forestiers et steppiques et l’élevage, dans sa diversité.
Maintenant, pour revenir à votre question et à mon livre auquel vous vous référez, l’analyse globale de l’état des lieux de notre agriculture, à travers les performances globales desdites fonctions dans les divers systèmes de production débouchent effectivement sur un diagnostic généralisé de non durabilité (à l’exception des rares cas de success stories couvrant moins de 5% des terres cultivées). En effet, globalement, les productivités des facteurs directs de production sont très faibles et comptent parmi les derniers dans le bassin méditerranéen : très faibles rendements/ha, très faibles marges brutes/ha, très faibles valeurs ajoutées avec en plus des coûts sociaux et environnementaux très élevés. Ce sombre tableau doit nous conduire à tirer la sonnette d’alarme sur le fait que le secteur agricole est en train de se dégrader progressivement, y compris pour des cultures considérées dans l’opinion publique comme étant très performantes à l’instar de l’oléiculture pluviale, dont plus de 80% des plantations oléicoles se situent dans l’étage bioclimatique aride, au sud de la Dorsale.
Cette non durabilité signifie que les petits producteurs (exploitations inférieures à 20 ha en pluvial qui représentent plus de 85% des producteurs) sont en train de s’appauvrir, sans le savoir, car, souvent, ils ne comptabilisent pas leurs salaires et celui des membres de leurs ménages, ni les coûts des dégâts occasionnés par la surexploitation de leurs terres… Quant aux grands exploitants, leur marge brute à l’hectare découle, en grande partie, de trois gisements : l’exploitation des bas salaires de la main-d’œuvre (surtout les femmes), de la surexploitation insidieuse des ressources naturelles (sol, eau, et biodiversité) et évidemment des soutiens financiers accordés par l’Etat au secteur. C’est dire que ce n’est pas avec cette agriculture qu’on va affronter, à l’avenir, la concurrence de pays aux agricultures autrement plus performantes, comme les pays de la Rive Nord de la Méditerranée, ni les risques liés aux incertitudes du marché international, ni les graves impacts du dérèglement climatique établis par les nombreuses projections climatiques et auxquels notre agriculture est très exposée, très sensible et très vulnérable. D’ores et déjà, notre agriculture n’est plus en mesure, dans son état actuel, de garantir notre sécurité alimentaire et il importe de le dire à haute voix afin que les décideurs en prennent conscience.
Pourquoi l’agriculture tunisienne est-elle confrontée aujourd’hui à de multiples problèmes ?
C’est évidemment la question centrale qu’il faut se poser si l’on veut réfléchir sur l’avenir de ce secteur. En fait, l’état de l’agriculture tunisienne est le résultat de l’accumulation des impacts des politiques agricoles successives liées aux projets de société auxquelles elles étaient intégrées, depuis la colonisation romaine. C’est cette dernière qui avait développé le système agraire latifundiaire au profit de très grandes exploitations agricoles de monoculture minière, le plus souvent extensive…, à côté du système microfundiaire autochtone (petites exploitations familiales diversifiées). La colonisation française est venue plus tard pour reproduire le même dualisme agraire structuré sur la même carte agricole et l’Etat national n’a fait que perpétuer cet héritage en favorisant son extension sur des terres et zones bioclimatiques inaptes à la mise en culture.
Aujourd’hui, la majorité des exploitations (85% du total avec moins de 20 ha), qui occupent 30% des terres agricoles, sont pour la plupart non viables. D’où le rabattement des exploitants sur la pluriactivité, reléguant ainsi l’agriculture à une activité intermittente, très préjudiciable à sa durabilité et en discordance totale avec les demandes sociales liées aux mutations sociétales que nous vivons, particulièrement depuis 2011.
En effet, l’agriculture d’aujourd’hui, peu performante, pour des raisons objectives, ne peut plus satisfaire les nouvelles demandes légitimes de la plupart des exploitants et de leurs salariés, d’un côté, ni celles des consommateurs, de l’autre. Cette incapacité à assumer ses trois fonctions définies plus haut est liée aux multitudes contraintes endogènes et exogènes qui handicapent son évolution progressive.
Est-il possible de rompre avec une agriculture qui a entretenu la misère rurale, surexploité les ressources naturelles et asservi les petits agriculteurs en les enfermant dans le cercle vicieux de l’appauvrissement pendant de nombreuses années ?
Je pense que rompre avec cette agriculture ne devrait plus être un choix, mais une nécessité pour tout décideur visant la mise à l’abri du pays d’une dépendance alimentaire qui se traduira à terme par l’hypothèque de sa souveraineté nationale. Ce sera donc une affaire de politique agricole, bien intégrée à une politique générale visant et œuvrant à la réalisation d’un projet de société juste et équitable, en mesure d’assurer une grande part de sa sécurité alimentaire.
Nous avons montré dans notre livre qu’il faut d’abord développer la prise de conscience, chez les décideurs, et même chez certains technocrates et journalistes, des risques encourus sur les moyens et longs termes quand on se contente de solutions conjoncturelles, comme, par exemple, les accords épisodiques avec les producteurs de lait, les aviculteurs… sur les prix à la production de leurs denrées. Il faut, en fait, rompre avec cette approche de recherche de solutions de court terme. Seule une politique agricole intégrée, visant l’objectif de réalisation des trois fonctions économiques, sociales et environnementales de tous les systèmes de production, sera en mesure de nous libérer de l’impasse dans laquelle se trouve le secteur agricole, et par là-même d’atteindre les objectifs de durabilité du développement économique et social des professionnels de l’agriculture et de l’ensemble des populations rurales. Cette orientation politique salvatrice aura certainement un coût élevé que la communauté nationale devra s’engager à payer. En effet, il n’est plus admissible de faire supporter aux agriculteurs et leurs salariés tous les risques liés aux incertitudes du marché et aux aléas climatiques (aridification, sécheresse, raréfaction des bonnes années agricoles, détérioration des termes d’échange entre les prix des produits agricoles et ceux des intrants industriels…). C’est que ce secteur a toujours été acculé à payer, seul, le prix au profit des consommateurs et des autres secteurs économiques, à travers l’entorse des règles du marché imposée par les politiques agricoles précédentes. Cela veut dire que le coût de la sécurité alimentaire future devrait être assumée, dorénavant, entièrement par la communauté nationale (budget de l’Etat) en faveur des couches sociales vulnérables.
Pour rompre avec cette agriculture qui nourrit et entretient la misère de la plupart des exploitants et de l’ensemble du milieu rural, il est indispensable de hiérarchiser les contraintes qui limitent ses performances, et elles sont nombreuses. Mais la plus déterminante, parmi elles, est incontestablement le déficit hydrique climatique. Ce dernier est appelé à s’accentuer au fil des années, ce qui veut dire que le pays va s’aridifier davantage et les aires des bioclimats vont migrer vers le Nord (remontée de la dynamique de désertification, donc disparition progressive des plantations oléicoles). En conséquence, la situation agricole va s’aggraver davantage, et toute nouvelle politique devrait s’atteler en premier lieu à cette menace climatique. Malgré cette évidence, d’aucuns évoquent encore, et crient par-dessus les toits, qu’il y a d’autres contraintes de diverses natures qui seraient plus importantes comme le morcellement des terres ou le manque de financement et d’investissements. Il est vrai que ces facteurs contribuent au découragement des investisseurs ou des exploitants à s’occuper de leurs terres et constituent des facteurs aggravants qui handicapent le secteur agricole. Toutefois, venir à bout de ces contraintes ne pourrait être considéré comme une condition sine qua none pour débloquer la situation et ouvrir de nouvelles perspectives à notre agriculture. La preuve en est donnée par la grande variabilité des performances, aussi bien physiques qu’économiques de tous les systèmes, en fonction de la pluviométrie. En effet, durant les années pluvieuses, les productions céréalières et oléicoles passent du simple au décuple, avec 3 millions de qx de céréales en période de sécheresse à 30 millions de qx au cours d’une année pluvieuse et de 35.000 tonnes d’huile d’olive en année peu pluvieuse à 350.000 tonnes d’huile en année très favorable, et cela malgré toutes les autres contraintes, pour tous les types d’exploitation, abstraction faite de leurs tailles ou leurs degrés d’intensification, avec les différences dues aux potentialités de leurs contextes éco-géographiques.
Qu’est-ce qui doit changer dans la politique agricole actuelle ?
Il n’est pas possible de répondre directement à cette question, avant de définir au préalable le profil de l’agriculture tunisienne sur le long terme, de tracer l’itinéraire à suivre pour y arriver à terme, à travers des étapes successives. Nous connaissons notre point de départ (agriculture actuelle) qui est arrivée à ses limites de durabilité et qui est incapable de nourrir correctement sa population, ni de conserver ses ressources naturelles, ni de rétribuer équitablement et retenir la population rurale sur ses terres. Il nous faut, ensuite, fixer un objectif à atteindre, à savoir le type d’agriculture qu’il faut développer d’ici un horizon temporel à long terme. En ce qui nous concerne et au vu des exigences à satisfaire à l’horizon 2050, l’agriculture de demain devrait être en adéquation avec les demandes sociales de la société de 2050, autrement plus performante aux plans quantitatif et qualitatif, donc plus productive (non pas avec une amélioration des rendements de 5 ou même de 20%, mais de plus 100%), tout en étant respectueuse des ressources naturelles et propre, et contribuant au mieux possible à la sécurité alimentaire et à l’économie rurale. Cela revient à doubler, au moins, les rendements des principales cultures pluviales, céréaliculture et oléiculture, et même ceux de la plupart des cultures irriguées. Nous considérons que cette ambition est réalisable à une condition fondamentale, celle de lever la contrainte du déficit hydrique, par diverses approches d’une meilleure valorisation des ressources en eau déjà mobilisées (eaux conventionnelles) et celles qui restent à mobiliser nécessairement (eaux non conventionnelles).Viennent ensuite les nombreuses réformes nécessaires à sa mise en œuvre.
Si cette vision est partagée et appropriée par toutes les parties prenantes, la démarche de l’établissement d’un itinéraire de changement devient claire : une politique agricole qui place l’exploitation et l’exploitant agricole au centre du développement agricole et rural, un rôle affirmé de l’Etat en tant que facilitateur, régulateur et amortisseur par rapport aux divers risques et menaces qui handicapent la transformation de ce secteur. L’agriculteur restera libre d’adopter les systèmes de production qu’il veut, à la condition de ne pas abuser des ressources naturelles dont il dispose, et l’Etat, de son côté, sera, également, libre de soutenir seulement les systèmes de production stratégiques, dans un cadre de cohérence et d’optimisation générale d’allocation des ressources naturelles et financières.
Les périodes de sécheresse intense, qui se sont accentuées ces dernières années, ont affecté lourdement les grandes cultures. Comment adapter l’agriculture tunisienne aux changements climatiques ? Faut-il diversifier les cultures ? Réviser le système d’irrigation?…
Il est toujours important de rappeler, à ce propos, que notre pays se situe dans une région aride aux potentialités agricoles limitées à cause du grand déficit hydrique actuel, menacé de surcroît, de se creuser davantage sous l’effet du changement climatique. Il faut dire en conséquence, qu’en la matière, il n’y a pas de solution miracle. Il y a, par contre, des règles générales d’ordres biologique, physiologique et agronomique qu’il faut respecter et adapter aux contextes régionaux et locaux sur la base d’objectifs fixés d’avance. Par exemple, pour produire un kg de blé, il faut 2 m3 d’eau, pour produire 1kg de viande bovine il faut environ 14-15 m3 d’eau et pour 1 kg d’olive à huile il faut environ 5-6 m3 d’eau. L’argument de ceux, qui prétendent que les systèmes de production actuels sont en mesure de produire beaucoup plus qu’aujourd’hui et d’exporter d’importantes quantités, n’est pas recevable, même avec les réformes programmées sur les plans institutionnel, juridique et le soutien irrationnel de l’Etat à ce secteur.
Ces réformes nécessaires seraient, par contre, plus efficaces après la levée de la contrainte hydrique, principal facteur limitant des rendements. C’est dire que la question de l’eau sera au centre de toute vision porteuse de l’avenir de notre agriculture.
La satisfaction, à des degrés divers, des besoins des cultures sera, à notre avis, la clé qui ouvrira la porte du changement vers une autre agriculture basée sur nos systèmes de culture actuels mais transformés et remis sur une orbite de durabilité. C’est une banalité, diraient certains, eh, oui, c’en est une, mais qui échappe malheureusement à de nombreux analystes, experts et mêmes certains journalistes qui s’empressent d’étaler, sur les plateaux télé ou radio, leurs solutions avec des répliques irréfléchies du genre “il n’y a qu’à étendre les superficies cultivées…” ou, “il suffit de réaliser de nouveaux barrages, etc.”
Au vu des risques encourus liés à la non durabilité de ce secteur et des grands risques du changement climatique, il y a lieu de déclarer pour la Tunisie, l’urgence climatique, qui est cruciale. Car, en l’absence d’une nouvelle vision de ce secteur, les Tunisiens seraient plus nombreux à avoir soif, à avoir faim et à ne point jouir d’une vie digne tant clamée et réclamée, particulièrement depuis 2011.
Devant ces risques, les organismes onusiens (FAO, COPs, BM et autres bailleurs de fonds) lancent et dictent, par l’intermédiaire de leurs experts et forums, l’adoption des concepts de résilience et d’adaptation au changement climatique. Ces concepts sont définis comme deux réactions des populations ou Etats concernés aux divers effets négatifs du dérèglement climatique. A ce propos, il importe d’en saisir le sens pour comprendre que ces concepts sont taillés sur mesure en fonction des situations climatiques des pays peu ou pas menacés par ce changement ( pays aux climats tempérés…) pour lesquels il suffit de fournir un petit effort d’adaptation pour garder leurs modes de vie et privilèges de disposer de quota per capita en eau> 1.000 m3/an/ha. Il faut rappeler que l’adaptation réside dans la capacité des individus ou des Etats à modifier leurs pratiques, leurs comportements pour maintenir leurs modes et niveau de vie, malgré le réchauffement climatique planétaire et que la résilience correspond la dimension et au degré des impacts auxquels un secteur peut résister avant de subir une transformation négative complète. Or, pour les régions arides, ces deux réactions sont d’abord très difficiles à réaliser étant donné la faible marge de manœuvre. Elles permettraient au mieux la stabilisation des modes et des niveaux de vie actuels déjà considérés inacceptables par la société d’aujourd’hui et encore pire pour les générations futures, sans aucune ouverture sur de meilleures perspectives.
Il nous faut, dans le cas de notre pays, situé dans des «Conditions climatiques limites», ne pas se contenter des objectifs de ces concepts onusiens et emprunter des pistes innovantes de sortie de la non durabilité actuelle avec la conception de nouveaux systèmes de production agricole compatibles avec le réchauffement climatique, tout autant qu’avec les exigences et les objectifs de développement durable. Alors, dans cette perspective, deux approches différentes mais pouvant être intégrées sont proposées pour maîtriser au mieux l’aggravation de la pénurie d’eau et ses effets sur les productions agricoles.
Pour les zones bioclimatiques du Nord de la Dorsale, il existe encore des gisements de productivité exploitables par une meilleure valorisation des eaux pluviales (l’eau verte) et leur stabilisation à une production annuelle en céréales de 25 millions de quintaux. Pour les zones arides s’étalant au centre et au sud du pays où trône la monoculture oléicole sur plus 1,5 million ha, l’approche consiste en une rupture avec l’aléa pluviométrique et la transformation du système. Oui, je dis bien une soustraction des productions agricoles de l’aridité régnante, pour sauvegarder 1,5 million ha de monoculture d’olivier et les transformer en un nouveau système oléicole diversifié, moyennant des irrigations complémentaires déficitaires (ICD) avec des eaux dessalées. L’itinéraire de transformation de ce système, mis à l’abri des aléas pluviométrique, sera balisé par une rupture avec la monoculture d’olivier et sa conversion en système de polyculture, avec diverses cultures intercalaires à haute valeur ajoutée, intégré aux cultures fourragères et un élevage ovin/caprin à multiples objectifs. Cela permettra de valoriser les sols.
Il faut également convertir le système conventionnel en un système biologique grâce au recyclage du fumier produit in situ et rallonger les chaînes de valeurs des filières de toutes les productions au niveau de l’exploitation agricole.
Pour réaliser cette transformation profonde d’un million ha des meilleures plantations en zones arides, il faut mobiliser un volume d’eau de qualité de l’ordre de un (1) milliard m3/an d’eau de qualité, soit 1.000 m3/ha/an. Cette nouvelle ressource pourrait être obtenue par l’adoption du nexus ‘’Energie renouvelable-eau agriculture’’ pour assurer le dessalement et le traitement des eaux usées traitées. Bien que le coût de production de cette eau soit encore relativement élevé, il importe de comparer le coût des impacts positifs (économiques, sociaux et environnementaux) de la production de cette eau au coût de l’inaction (perte à terme de toutes les plantations et de la filière oléicoles…), pour décider en connaissance de cause. Cette approche ne relève pas du rêve, elle a été testée avec succès, et déjà adoptée par 2 Crda (Mahdia et Médenine) dans des projets de développement, ainsi que par de nombreuses initiatives privées…
Le manque de main-d’œuvre et la désaffection des diplômés de l’enseignement supérieur pour le métier d’agriculteur ou d’ingénieur agronome représentent une sérieuse menace pour le secteur. Découragés par les aléas qui entourent ce métier, de moins en moins de jeunes veulent se lancer dans une carrière agricole. Qu’en pensez-vous ?
Cette situation résulte évidemment de l’incapacité de ce secteur à rétribuer équitablement les exploitants et leurs salariés et à créer des conditions de vie dignes aux populations rurales. Il est évident qu’un agriculteur, qui réalise de faibles performances (et il s’agit de plus de 85% des exploitants agricoles) et qui n’arrive pas à s’assurer lui-même un revenu correct pour faire vivre son ménage, ne pourrait en aucun cas offrir à ses ouvrier(e)s un salaire juste, ni leur garantir une sécurité sociale. Nous avons tous vu les images des accidents de la route commis par des camionnettes transportant des ouvrières agricoles dans des conditions inhumaines. D’où la tendance générale des jeunes ruraux à opter pour l’émigration définitive, ainsi que des chefs d’exploitation qui préfèrent se rabattre sur la pluriactivité au niveau local ou opter pour l’émigration temporaire, en préférant passer d’une agriculture permanente à une agriculture intermittente fort préjudiciable au secteur. Il y a là donc un cercle vicieux de dégradation de toutes les composantes des systèmes (social, technique, économique et environnemental).
A quoi ressemblera, selon vous, l’agriculture de demain ?
Elle devra être professionnelle, autrement dit plus performante et plus efficace que celle d’aujourd’hui, convertie en systèmes biologiques, intégrant l’élevage et les cultures fourragères, rompant avec toutes les contraintes (déficit hydrique, monoculture, dépendance technologique, pluriactivité des exploitants…), donc très diversifiée et générant des chaînes de hautes valeurs ajoutées, au profit des exploitants et aux autres opérateurs de nouvelles filières, solidaire et sécurisée par la communauté, faisant ainsi des petites et moyennes exploitations viabilisées la colonne vertébrale du secteur. Elle sera exigeante en innovation technologique, donc encadrée par diverses structures de vulgarisation de proximité et une recherche agronomique revisitée. Finalement, elle devra être en mesure d’accomplir ses multiples fonctions et contribuer à assurer la sécurité alimentaire. De leur côté, les systèmes pluviaux, de plus en plus menacés dans leur intégrité physique, devraient bénéficier d’irrigations complémentaires leur assurant un avenir durable. Cela nécessitera l’adoption du nexus “Energies renouvelables- eau-agriculture” pour mobiliser de nouvelles ressources en eau non conventionnelles. Dans cette perspective, l’avenir de cette agriculture sera exprimé en termes de “maîtrise des énergies renouvelables”. La souveraineté alimentaire en dépendra.


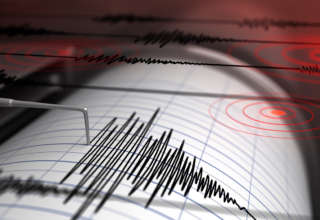







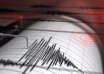


Ben Mabrouk
6 avril 2022 à 16:19
En effet la souveraineté de l’agriculture dependra de la maîtrise des énergies renouvelables.