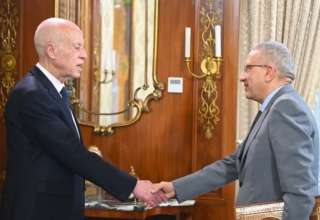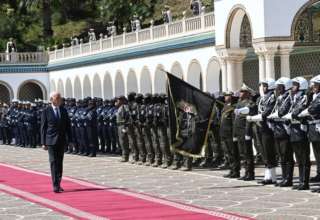Rares sont les réalisateurs comoriens ! Mohamed Said Ouma en est un. Il était parmi nous durant la manifestation «Point Doc», organisée la semaine dernière par Doc House. Mohamed Said Ouma est un cinéaste exceptionnel, opérateur culturel et directeur exécutif de «Documentary Africa» et il est également impliqué dans «The African Heritage Project», un programme qui vise à restaurer cinquante films africains d’importance historique, culturelle et artistique. Son dernier film «Carton rouge» a fait sa première mondiale à l’International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 2020. Il nous a accordé cet entretien.
Les cinéastes comoriens se comptent sur les doigts d’une seule main. Pourquoi selon vous?
C’est pour des raisons culturelles, politiques et économiques. Culturelles, dans le sens où, comme la Tunisie, les Comores sont des îles musulmanes. Dans le monde on oublie qu’on a été islamisés très tôt ! Soit, cinquante ans après la mort du prophète. Et il y a quelque chose dans la culture musulmane avec un rapport à l’image très complexe. Paradoxalement, pendant la saison des mariages, tout le monde aime se faire filmer mais si vous ramenez une caméra, les gens ne se laisseront pas filmer facilement. Sur le plan politique, nous avons un territoire qui a été colonisé par les Français et mis sous pression. D’ailleurs, la France a gardé l’une des îles sur les quatre qui est Mayotte. Après l’indépendance en 1975 nous avons eu un président révolutionnaire Ali Soilih qui s’inspirait des mouvements coloniaux de l’époque et qui a inspiré Thomas Sankara. A l’époque, la France a envoyé Bob Denard pour l’assassiner. Ensuite nous avons eu une succession de dictateurs. Cela a aussi créé une sorte d’exode puisque la moitié de la population vit à l’étranger entre Marseille, Paris et l’Afrique de l’Ouest entre autres. A cela s’ajoute le fait que notre rapport à l’art tient plus à l’oralité et au conte et beaucoup à la musique. La musique et la poésie sont les arts majeurs aux Comores, le cinéma est venu tardivement avec des jeunes comme moi qui ont vécu à l’étranger ou qui ont été formés dans des écoles de cinéma en Europe. En ce qui me concerne j’étais en Angleterre. Il y a tous ces éléments qui font que le cinéma est quelque chose de nouveau aux Comores. Et puis il y a un côté qu’on sous-estime aussi, c’est qu’en Afrique noire l’image est venue par les gens du Nord qui sont venus filmer dans un objectif d’exploitation et il a fallu attendre des gens comme Sembène Ousmane, par exemple, pour nous dire que nous aussi on peut se filmer.
En somme, vous faites partie de la première génération de cinéastes… Ça a des avantages on imagine ?
En effet ! C’est un avantage parce qu’il n’y a pas d’anciens pour nous dire la fameuse phrase «ça, ce n’est pas du cinéma ! Mais ça, c’est du cinéma !». Nous n’avons pas de bataille entre anciens et modernes. Mais nous sommes en train de trouver des voies et de former des jeunes.
Pensez-vous que notre imaginaire africain a besoin d’être expliqué au monde pour que nos films puissent circuler dans le monde ?
Je pense que le cinéma africain est jeune même si en Tunisie il existe depuis longtemps. Notre cinéma est jeune en termes d’existence sur la scène internationale. Il faut prendre cela en compte et avoir de l’humilité en se disant que de notre vivant ces choses-là ne vont pas arriver et qu’il reste un long chemin à faire. Il nous manque encore beaucoup de maillons dans la chaîne de valeurs du cinéma.
Quels sont ces maillons qui manquent ?
Faire un film c’est bien ! On arrive à en faire avec des financements nationaux ou pas. Il y a des festivals qui aiment nos films mais je pense que nous manquons le maillon essentiel qui est celui de la distribution et de la promotion. Le cinéma est un produit culturel comme la musique. Et il y a très peu de distributeurs africains qui sont reconnus dans les marchés internationaux. Il y a très peu de «Sales agents» africains de promoteurs et d’«impact producers». Tous ces spécialistes sont occidentaux avec un faible pourcentage d’entre eux qui ont un intérêt réel pour l’Afrique.
C’est le moment pour l’Afrique de former ses propres «sales agents» et ses distributeurs internationaux…
Nous devons faire cela au moins pour les jeunes qui sont à l’école de cinéma. Aujourd’hui il y a le «short-cut» avec des gens qui peuvent aller sur les plateformes. Mais sur les plateformes il y a très peu d’élus. Ainsi nos perspectives restent tributaires des coups de dés. Ainsi des fois ça marche dans des festivals des fois ça ne marche pas… Nous devons sortir de cette logique. Je prends toujours l’exemple de la musique. Les musiciens africains sont beaucoup plus «smart» que nous parce qu’ils arrivent à exporter leur musique dans le monde entier comme l’Afrobeat Nigérien.
Le documentaire africain est nouveau dans le paysage ; quelles sont les perspectives pour son financement vous qui dirigez un fonds pour le documentaire en Afrique ?
Doc A «Documentary Africa» a été monté en 2018 avec à l’origine de cette initiative plusieurs producteurs : Steven Markovitz (Afrique du Sud) Judy Kibinge (Kenya), Salem Brahimi (Algérie) Ali Essafi (Maroc) Joslyn Barnes (Etats-Unis) Femi Odugbemi (Nigeria) Alexandro Jedlowski (Universitaire).
Ce sont des amoureux du documentaire qui, en 2008, ont contractualisé neufs chercheurs et critiques de cinéma qui ont parcouru toutes les régions. De ce travail scientifique est sorti un rapport en 2013-2014 présenté à l’IDFA sur l’état des lieux. A partir de là il a fallu trouver de l’argent pour monter ce fonds. Dans ce rapport il y a les réponses à vos questions. Il y a donc un manque flagrant de reconnaissance internationale pour tous ces documentaristes, un manque de financement durable. Les réalisateurs africains n’arrivent pas à toucher le public de leur pays avec leurs documentaires alors que leurs films voyagent à l’étranger. Selon ce rapport également il y a un manque dans la formation même si les écoles de cinéma existent. Lorsqu’on a monté ce fond on est conscients de tous ces blocages et on donne des aides au développement, à la production ou à la postproduction. On développe des partenariats et on soutient des organisations documentaires. Nous sommes partenaires de «Fidadoc» au Maroc, de «docubox» en Nairobi, de «Encouters» en Afrique du sud et nous soutenons Doc House en Tunisie.
Etes-vous optimiste pour l’avenir du documentaire africain ?
Je vois toujours le verre à moitié plein, sinon je ne serai pas dans le cinéma… Après quatre ans d’activité notre fond reçoit plus de mille projets après l’appel à films. On ne peut soutenir qu’une vingtaine mais ça me permet d’affirmer que le genre documentaire explose en Afrique. 54% de ces projets sont portés par des hommes et 46% portés par des femmes et c’est en train de s’équilibrer. Aujourd’hui tout le monde a une approche du réel grâce aux nouvelles technologies. Sur le continent il y a beaucoup d’écoles de cinéma ainsi que des plateformes et de festivals. Il y a vingt ans, il n’y avait pas autant de festivals en Afrique. Il y a un écosystème qui est en train de s’installer insidieusement… C’est une vraie lame de fond… Ce n’est pas un hasard si toutes les plateformes internationales s’intéressent aujourd’hui à l’Afrique. Il y a quelque chose de nouveau sur ce continent. Il y a ce désir de se raconter en se disant «on n’a plus besoin de la validation du Nord pour dire nos histoires». Je rencontre de plus en plus de cinéastes africains qui ont envie d’être universels à partir de Sousse ou de Dakar et non plus à partir de Paris ou de New York. C’est une époque vraiment excitante pour le cinéma africain.
C’est un temps où nous sommes en train de décoloniser notre cinéma parce qu’il a été sous l’emprise du «softpower» avec des films qui sont réalisés avec de l’argent européen essentiellement, avec les regards des cinéastes qui suivent les financements. Maintenant nous sommes en train de nous en sortir. C’est douloureux mais on est en train d’y arriver. C’est un temps très positif pour le cinéma en Afrique comme on n’en a pas connu avant…