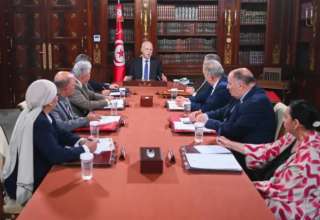Par Ines ZARGAYOUNA
«El Bakhara, Toxic Paradise» de Sadak Trabelsi va bien au-delà de l’art : c’est un puissant outil de sensibilisation qui met en lumière des réalités souvent dissimulées. Elle mérite l’attention de tous, car elle nous rappelle que derrière chaque statistique de pollution se cachent des vies humaines, des histoires de souffrance et de courage. La pièce sera présentée au Festival international de Hammamet lors de sa 58e édition, le 24 juillet.
Quelle est la fonction du théâtre au sein d’une société ? Ou, plutôt, quelles sont ses fonctions principales, car elles sont multiples. Commençons par la plus évidente : divertir. Nous menons une vie de plus en plus stressante, et il est crucial de ne pas ajouter un drame de plus à nos soucis quotidiens. C’est pourquoi nous nous tournons vers le théâtre pour passer un bon moment et oublier, ne serait-ce qu’un instant, nos problèmes personnels.
Au théâtre, nous n’attendons rien de plus : acteurs et comédiens, divertissez-nous ! Faites-nous oublier nos tracas sans en ajouter de nouveaux, s’il vous plaît ! Et le théâtre s’y prête : les pièces divertissantes abondent et les représentations se jouent à guichets fermés. Tout le monde y trouve son compte : les artistes vivent de leur art et les spectateurs sont satisfaits. Que demander de plus ?
Cependant, le théâtre a aussi pour mission d’instruire et de faire évoluer les mentalités. Si l’on doit absolument ajouter une autre fonction à celle de divertir, que ce soit celle d’instruire. Que le théâtre aborde alors ses sujets de prédilection : problèmes de couple, de famille, d’individus tourmentés… Les thèmes ne manquent pas, et il pourra alors jouer le rôle de miroir de la société, lui renvoyant ses propres travers.
J’ai assisté, en mars dernier, à la première d’une pièce de théâtre qui s’intitule «El Bakhara, Toxic Paradise», mise en scène par Sadak Trabelsi, coproduction du Théâtre de l’Opéra et du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique, texte de Sadak Trabelsi et codéveloppement avec Elyès Rebhi, codramaturgie par Sadak Trabelsi et Toumadher Zrelli et jeu par Ramzi Azaiez, Mariem Ben Hassan, Ali Ben Said, Beligh Mekki et Bilel Slatnia. Une œuvre théâtrale récente qui expose les effets dévastateurs des usines et des déchets chimiques sur l’environnement et sur la vie quotidienne des habitants.
La pollution, l’environnement, les déchets chimiques ?
Ce sont des sujets qui requièrent l’expertise de spécialistes, pas des gens de théâtre dont la compétence principale est d’imiter la réalité.
Platon voulait chasser les poètes imitateurs de la réalité de sa cité idéale, car ils ont tendance à exagérer les faits réels. Je ne suis qu’une simple citoyenne non experte en environnement et écologie, je ne peux donc pas juger seule de la véracité de l’état des lieux rendu dans la pièce. Je demande donc l’avis des experts en la matière pour vérifier si l’équipe de la pièce n’exagère pas dans sa description des effets dévastateurs de la pollution industrielle. Leurs avis sont essentiels pour confirmer ou infirmer ce qui est montré sur scène.
Je vais rendre compte dans ce qui suit de ce que j’ai vu et entendu et si mon témoignage ne suffira pas, il sera possible de vérifier en assistant à leur prochaine représentation.
Un témoignage poignant de la réalité
Cette pièce est un véritable cri d’alarme. À travers une narration poignante et des personnages profondément humains, elle réussit à rendre compte de la détresse et de la résilience des communautés vivant à proximité des zones industrielles. Les spectateurs sont plongés dans une réalité souvent ignorée ou minimisée, où l’air est pollué, où la mer est empoisonnée et où les maladies chroniques deviennent la norme.
Elle raconte l’histoire d’une famille composée d’un père âgé et malade, de deux frères et de l’épouse de l’un d’eux. La mère vient de décéder d’un cancer. Dans la pièce, on observe leur quotidien : une routine banale d’une famille tunisienne. La femme s’occupe de la maison et du vieux père, tout en trouvant du temps pour suivre ses feuilletons. L’un des frères travaille à l’usine, tandis que l’autre refuse de s’intégrer et choisit de vivre en révolté. Le père, vieux et malade, complique la vie de tout le monde par son besoin constant d’attention. Le couple rêve d’avoir des enfants, le frère rêve de destruction, et le père hallucine, avec un pied dans une réalité, qu’il s’efforce de rendre plus difficile qu’elle ne l’est déjà, et l’autre dans ses souvenirs d’un passé lointain. La maison où vit cette famille se trouve à proximité d’une usine qui, il y a plus de cinquante ans, a choisi cette terre pour s’y installer. Depuis, elle embauche les hommes, leur permettant ainsi de nourrir leurs familles et de vivre avec dignité.
C’est une famille, comme tant d’autres, enfermée dans une boucle infernale : un quotidien de plus en plus difficile à gérer, dont il semble impossible de s’échapper. Mouldi, le vieil homme malade, vient de perdre sa femme. Avec un prénom qui signifie «naissance», il est accusé d’avoir causé sa mort en choisissant de travailler à l’usine et d’habiter à proximité. Yahiya, «celui qui vit», ne fait que survivre. Il est pris dans le tourbillon incessant du travail, des obligations familiales, et du maintien des apparences d’un couple épanoui, sans jamais trouver le temps de s’interroger sur sa vie. Dalel, quant à elle, tente de rester coquette malgré un quotidien chaotique, entourée d’hommes qui attendent d’elle qu’elle continue de les soigner et de les nourrir. Nidhal, le révolté, refuse de travailler à l’usine mais reste accusateur, profitant des efforts des autres sans assumer de responsabilités. L’usine, symbole de cette oppression, est représentée par Imed, le directeur. Français et fils de colons, il incarne et résume toute l’histoire et les séquelles d’une colonisation en apparence révolue, mais qui continue de saigner les habitants.

Des scènes frappantes et un message clair
La pièce de théâtre s’ouvre avec des personnages, perdus et désorientés, cherchant désespérément le soleil.
Les deux premiers actes nous font immerger dans le quotidien de la famille, régler la parabole, nourrir la chienne, rappel de devoir fermer les fenêtres et les portes, préparer le dîner, s’occuper du père malade… Chaque scène est interrompue brutalement par des marques des effets du soufre inhalé : corps désarticulés, gestes ralentis et des souffles coupés. La chienne meurt pour cause de suffocation.
Après une projection au troisième acte qui représente une mer déchaînée avec ses vagues houleuses, des animaux en détresse et, un cosmos brumeux qui annonce des catastrophes, on revient à la famille dans une scène de conflit entre les deux frères. Une confrontation entre deux positions où chaque personnage a représenté son nom : d’un côté Yahiya qui ne veut que continuer à travailler pour vivre et faire vivre sa famille et, d’un autre, Nidhal qui veut détruire l’usine qui a rendu leur paradis toxique.
On prend une pause dans l’acte cinq, pour recenser avec le couple ce qu’ils ont perdu et ce qu’ils vont encore perdre : la mère de Yahiya, leur chienne et leur rêve de vivre sainement et de remplir la maison d’enfants. Mouldi, le vieux père, a le cancer et risque de périr faute de moyens de le soigner.
A l’acte six, Imed, le directeur de l’usine, fait son apparition, dans une scène grotesque dans laquelle on réanime Mouldi pour lui faire un hommage et fêter son anniversaire. Dalel, la représentante unique de la femme dans la pièce, est de plus en plus lasse et triste à l’acte sept. Elle s’inquiète pour le vieux qui hallucine et la confond avec sa défunte épouse. Ramzi Azaiez, l’acteur qui joue le rôle de Mouldi, arrête le jeu et exprime son propre désarroi et désespoir face à la catastrophe qui, d’année en année, change la face de son pays natal qu’il a quitté.
L’acte huit est une projection d’un direct animé par Nidhal qui dénonce la catastrophe écologique sous le regard amusé de Imed, qui visionne le Live bien installé sur un canapé.
À l’acte neuf, nous apprenons que Dalel est atteinte d’un cancer, et à l’acte dix nous assistons à la confrontation ultime entre Imed et Nidhal, dévoilant les dessous des mouvements de contestation et de dénonciation de la catastrophe. Imed, tel un chef d’orchestre, mène la danse tandis que Nidhal ne fait que suivre les consignes. Finalement, on propose à Nidhal d’intégrer l’usine en tant qu’expert en chimie verte et écologie industrielle, afin de développer une stratégie de valorisation des déchets chimiques. Sous son grand air de révolté, Nidhal apparaît finalement comme un homme perdant pied, fragilisé par des compromis. Le cercle se referme sur lui. Il suffoque et s’enfuit. Avec le geste d’une main fermée Imed arrête la musique en signe de mission accomplie.
L’acte dernier nous montre les personnages qui alternent des mouvements d’automates énergiques qui traversent l’arrière de la scène représentant les ouvriers de l’usine avec des mouvements au ralenti des gens qui habitent aux alentours.
De la fumée qui s’intensifie. Les personnages portent des masques. Dans la salle on suffoque tout en applaudissant les acteurs au salut.
Au-delà du registre
Au théâtre, les acteurs imitent et les spectateurs s’identifient. C’est le contrat scène-salle, le jeu annoncé. Cette pièce immersive demande au spectateur de sortir de sa zone de confort et de s’engager avec des problèmes qui, bien que ne le touchant pas directement, devraient le concerner. La pollution est un enjeu universel, même si nos responsabilités individuelles semblent souvent floues. Pourtant, ce sujet met souvent l’individu mal à l’aise, le poussant à nier sa part de responsabilité dans telle ou telle forme de pollution. Devant les images de tortues de mer mortes sur les plages, qui défilent sur nos réseaux sociaux, combien d’entre nous s’arrêtent pour questionner leur propre rôle dans cette tragédie ? Personnellement, je ne fais qu’un rapide inventaire : je ne possède ni bateau ni usine, et je passe à une autre actualité. Rarement prenons-nous le temps d’examiner en profondeur nos responsabilités personnelles et de changer nos comportements. La complexité de ce cheminement, combinée à l’imperceptibilité de l’impact individuel de nos actions, nous en dissuade souvent. Les campagnes de sensibilisation mettent en avant l’importance de chaque petit geste pour améliorer une situation catastrophique à long terme. Pourtant, nous oublions rapidement lorsqu’un problème de pollution ne nous touche pas directement. La devise «ce qui ne me touche pas ne me concerne pas» l’emporte trop souvent sur les initiatives de sensibilisation. Que pourra ajouter le théâtre dans ce contexte de mentalités d’irresponsabilité commune et généralisée ? Et quelles puissances d’outils et quel impact il a pour prétendre à cette tâche ardue de faire bouger les mentalités qui résistent à tout changement avec comme adage dominant : celui qui est à tout le monde n’est la responsabilité de personne (Rizk el Bilik). Au-delà du registre dans lequel s’inscrit la pièce, elle aborde divers sujets universels touchant chacun de nous, peu importe notre quotidien. Les personnages, bien malgré nous, nous émeuvent.
Confinés chez eux pour minimiser les effets de l’inhalation de soufre, ils nous rappellent le confinement dû au Covid, un souvenir encore frais.
Le thème de la vieillesse, incarné par Mouldi, résonne avec toutes les familles tunisiennes. Face à la garde d’un parent âgé et malade, on réalise souvent être livré à soi-même, sans aucune aide de l’État. Cette galère silencieuse continue de hanter nos foyers.
Quitter ou rester ? Tout au long de la pièce, une question persiste : pourquoi ne quittent-ils pas ce lieu qui les tue ? La réponse vient de Ramzi Azaiez, qui interrompt le jeu pour parler en son nom : quitter n’est pas une solution, car la souffrance de la terre saccagée nous suivra partout.
La mort rôde dans la maison, s’infiltrant par chaque fissure et ouverture, plaçant tout le monde en état d’urgence vitale. On s’aime et se hait, on se dispute et se réconcilie, on se désire et on s’enfuit, tout se fait dans la précipitation car la mort menace à tout instant. La pièce, en zoomant sur cette situation, nous rappelle que vivre englobe aussi les chagrins et les tracas. La vie reste précieuse même dans les pires moments, car la mort est toujours là, en embuscade. Lorsque la mort met un point final, plus rien n’a de sens et la vie, même dans ses meilleurs aspects, perd tout son éclat.
Un appel aux experts
«El Bakhara, Toxic Paradise» n’est pas seulement une pièce de théâtre, c’est un appel à l’action. Elle interpelle directement les experts de l’environnement et de l’écologie, ainsi que le grand public.
Cette œuvre va bien au-delà de l’art : c’est un puissant outil de sensibilisation qui met en lumière des réalités souvent dissimulées. Elle mérite l’attention de tous, car elle nous rappelle que derrière chaque statistique de pollution se cachent des vies humaines, des histoires de souffrance et de courage.
Nous appelons donc tous les experts de l’environnement et de l’écologie à prêter attention à cette pièce, ne serait-ce que pour vérifier l’exactitude de l’état des lieux qu’elle présente.
Mais même s’il y a une part d’exagération, n’est-ce pas justement cette hyperbole artistique qui réussit à percer le voile de l’ignorance face à l’indifférence générale et à la surdité des autorités ?
Cette pièce est un cri du cœur, nous exhortant à agir avant qu’il ne soit trop tard. Elle nous invite à regarder au-delà de nos frontières pour compatir avec nos familles touchées et dénoncer la catastrophe écologique que la pièce nous décrit.
Pour ma part, j’atteste que l’équipe de «El Bakhara, Toxic Paradise» a brillamment relevé le défi audacieux de mettre en lumière un problème peu médiatisé.
La pièce sera présentée au Festival international de Hammamet lors de sa 58e édition, le 24 juillet.
Soyez nombreux à y assister, que vous soyez experts ou simples citoyens concernés par les maux de notre pays.
I.Z.