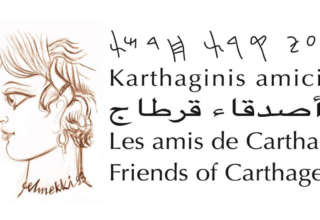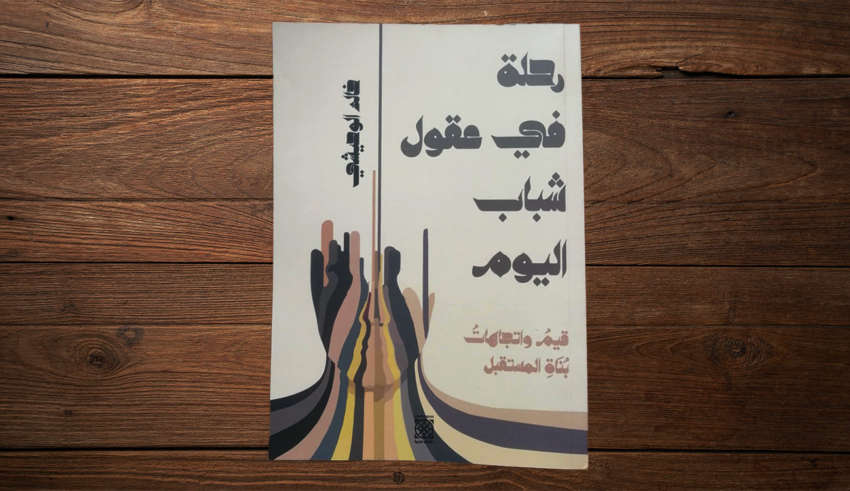
Au départ de la présente investigation, un constat et une interrogation : la désaffection de la grande majorité des jeunes Tunisiens à l’égard de la chose publique en général et de la politique en particulier, et pourquoi ?
La Presse — Dans un ouvrage publié récemment aux éditions Arabesques, intitulé « Voyage dans l’esprit des jeunes d’aujourd’hui – Valeurs et tendances des bâtisseurs de l’avenir », Khaled Louhichi nous convie à une exploration systématique de l’état d’esprit de notre jeunesse depuis le tournant du 14 janvier 2011, de ses aspirations profondes et de ses comportements dans la société actuelle qui interpellent à plus d’un titre.
Mais d’abord qui est Khaled Louhichi ? Il est présenté en quatrième page de couverture comme étant « un ancien diplomate, sociologue et démographe, comme ayant de nombreuses contributions en matière de politique relative à la jeunesse et à la population au niveau régional arabe. ». Il est vrai que ses responsabilités dans ces domaines au sein de la Ligue arabe durant plus de trois décennies et ses expériences sur le terrain dans cette partie du monde et au-delà en ont fait un observateur privilégié des dynamiques qui ont travaillé ce corps central de la société, en particulier depuis la fin de la prépondérance des grands courants idéologiques du siècle dernier. Au départ de la présente investigation, un constat et une interrogation : la désaffection de la grande majorité des jeunes Tunisiens à l’égard de la chose publique en général et de la politique en particulier, et pourquoi ?
Après une marginalisation qui s’était prolongée plus d’un demi-siècle après l’indépendance, cette jeunesse a fait sur la scène politique et sociale une irruption tonitruante qu’on a dénommée diversement : Révolution, Printemps arabe, soulèvement, complot, etc. Quels qu’en soient la nature et le développement ultérieur, cet événement a été un moment de vérité qui a permis la mise à nu des ressorts intimes de la société tunisienne, en particulier ceux qui régissent la jeunesse, y compris dans leur apparente incohérence.
Ce sont ces ressorts que le chercheur s’est appliqué à identifier à travers une lecture attentive des résultats des très nombreux travaux menés en Tunisie dans ce domaine par des instances nationales et internationales depuis 2011. Cette approche a permis à l’auteur de jeter un éclairage à cru sur une réalité qui va à contre-courant du sens des lectures hâtives et nécessairement superficielles qui ont inspiré bien des errements méthodologiques, aussi bien dans les sphères de la recherche que dans celles de l’action politique.
Leurs conclusions et les plans qu’ils en ont tirés les ont fourvoyés, les privant de l’accès à un potentiel humain de première qualité. Celui-ci est-il pour autant perdu ? Pas du tout, répond l’auteur ; il est toujours disponible pourvu qu’il soit tenu compte de ses spécificités et de ses aspirations, clairement identifiées dans ce volume. Au demeurant, il est légitime de considérer que ce travail devrait servir de « manuel » à l’usage des planificateurs des politiques à mener à l’avenir en matière de jeunesse. Notons enfin la qualité rédactionnelle de cet ouvrage qui le met à la portée du public le plus vaste, spécialistes et profanes confondus. Un « résumé exécutif » permet aux non-arabisants de prendre connaissance du contenu de l’œuvre en langue française.