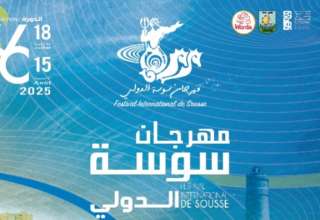En juillet 1960, et quelques jours seulement après la proclamation de l’indépendance du Congo-Belge (ex-Zaire et aujourd’hui République Démocratique du Congo), le Secrétaire général des Nations unies, Dag Hammarskjöld, devait faire face à la grave situation occasionnée par les émeutes, la rébellion et les actes de violence et de sévices contre les Européens affolés et surpris par le cours de certains évènements tragiques.
Et c’était dans le but de sauvegarder la paix et la sécurité internationales, et à la demande du gouvernement congolais, qu’il accepta l’envoi d’une force de maintien de la Paix dans ce pays. La Tunisie, sollicitée autant que de nombreux autres pays parmi les non-alignés, se prêta volontiers à cette noble mission humanitaire malgré les difficultés suivantes :
1- la jeune armée tunisienne n’avait que quatre ans d’existence,
2- notre armée était, étant donné la guerre d’indépendance de l’Algérie, déployée presque en totalité sur la frontière tuniso-algérienne,
3- nos jeunes officiers, formés à St Cyr, appartenant à la 1°promotion, n’avaient que très peu d’expérience (4 ans de service seulement).
Le Congo-ex Belge est situé au centre de l’Afrique. C’est l’un des pays africains les plus vastes. Traversé d’est en ouest par l’immense fleuve qui lui a donné son nom, et étant l’un des cinq plus grands pays africains en superficie, le Congo est extraordinairement riche par son sol, ses terres, ses forêts, et surtout par ses ressources minières : en effet, cuivre, cobalt, uranium et diamant entre autres ont fait que ce pays intéresse toutes les grandes puissances tant occidentales que celles de l’ex bloc de l’Est.
Celles-ci et celles-là se sont tellement impliquées dans les affaires de ce pays que les luttes intestines pour le pouvoir ont duré très longtemps et ce, depuis le premier mois de son indépendance (juin 1960).
Propriété du roi des Belges Léopold II depuis 1876, c’est suite aux pressions extérieures, en particulier celles de la Grande-Bretagne, que la Belgique assuma la responsabilité formelle de cette colonie depuis 1908. Mais rien n’a été fait pour l’émancipation des habitants de ce pays dont la population, du fait du manque de recensement fiable et sérieux, était estimée à près de 15 millions en 1960 et près de 110 millions aujourd’hui.
D’ailleurs, le sentiment de la nationalité était absent, ce qui n’avait rien de surprenant, car la population appartient à plus de deux cents tribus différentes.
Le colonisateur n’a rien fait pour développer le pays et naturellement le niveau de la population a été à l’image de son élite qui était, en fait, inexistante.
Très peu de Congolais ont donné à leurs enfants une instruction, généralement en dehors de leurs frontières et la majorité de la population était illettrée. Non seulement l’éducation ou la formation culturelle n’a jamais été le souci du colonisateur, mais encore celui-ci a encouragé le tribalisme, ce fléau et ce clivage destructeurs.
Ceux-ci ont fait perdre à ce merveilleux peuple congolais une bonne partie de sa jeunesse sacrifiée, bêtement et inutilement, dans les guerres tribales entre les différentes ethnies qui composent ce pays et qui duraient parfois des années, avant de reprendre, du fait de l’esprit de vengeance, une décennie plus tard.
Cependant, vers les années 1920, et dans les grandes villes du pays, quelques groupes parmi les alphabétisés commençaient à s’unir. Cette élite naissante ne défiait pas ouvertement le système colonial et ses doléances étaient essentiellement centrées sur le traitement inégal dont les Congolais éduqués étaient victimes.
Le pays connut des crises sérieuses suite à une mutinerie de la force publique (les forces de sécurité intérieure) à Luluabourg en 1944, à des émeutes à Matadi en 1945 et rien n’a été fait par le colonisateur belge pour préparer et roder une classe dirigeante congolaise à l’exercice d’un pouvoir effectif, ne serait-ce que local.
La population urbaine doubla en quelques années, et en 1956, 22% des habitants vivaient dans les centres urbains. Cette situation bouleversera toutes les données. La scolarisation connut également une expansion très rapide à partir de 1949 et le taux de scolarité qui était de 12% en 1940 atteignit 37% en 1954. L’enseignement supérieur était inexistant et le secondaire, pour les Congolais, commençait à s’organiser en 1956 mais le déchet scolaire était énorme : un élève sur douze terminait le cycle primaire et parmi eux, un sur six seulement accédait au secondaire.
Alors qu’en Belgique, un débat public sur l’évolution politique proposait un plan d’émancipation du Congo en trente ans, ce plan fit au Congo et surtout dans le milieu urbain de la capitale Léopoldville (Kinshasa), office de détonateur ou de catalyseur. D’ailleurs, un manifeste fut aussitôt publié à Léopoldville.
Il prônait l’indépendance du Congo tout en rejetant comme abusif le terme de trente ans. Cette idée s’accélérera, en 1959, après les émeutes sanglantes de Léopoldville où il y a eu 49 morts et 290 blessés.
Le 13 janvier 1959, un message du Roi des Belges reconnut le droit des Congolais à l’indépendance. Il demanda que cela soit fait sans précipitation inconsidérée. Le gouvernement belge appela, en novembre 1959, les leaders politiques congolais à une table ronde belgo-congolaise. Celle-ci eut lieu à Bruxelles en janvier 1960.
C’est d’ailleurs à cette conférence que fut décidée la date d’indépendance, soit le 30 juin 1960.
Le Congo, malheureusement, ne devait jamais connaître de transition graduelle et pacifique au cours de laquelle un programme de formation accéléré eut pu préparer une élite d’administrateurs civils, capables de prendre en main les destinées de leur pays.
Les élections donnèrent une position forte aux partis dits «extrémistes» et spécialement au M.N.C. de Patrice Lumumba et à ses alliés directs.
Les partisans des candidats à la présidentielle de toutes les tendances et de la plupart des partis politiques qui ont proliféré très rapidement ont perturbé l’ordre public ; des formes de violence et des sévices contre les Européens ont justifié l’intervention militaire belge au Katanga et au Kassaï et tout cela déclencha une catastrophique escalade des événements:
1- proclamation de la sécession de la province du Katanga par Moïse Tshombé,
2- rupture des relations entre la Belgique et les autorités centrales congolaises,
3- et menaces sérieuses d’intervention étrangère et risques pour la paix internationale.
La nouvelle République avec Joseph Kasavubu comme président et Patrice Lumumba comme premier ministre, connut très vite des troubles. En moins de quarante- huit heures, des émeutes tribales se produisirent dans la capitale et en divers endroits du pays. La «Force publique», comptant vingt- cinq mille hommes, se mutina en de nombreux points, chassa ses officiers blancs, se mit à piller et à détruire les propriétés européennes.
Elle maltraita et tua certains parmi les cent mille Belges qui étaient restés pour assurer l’administration ou s’occuper de leurs affaires. Devant cette situation catastrophique, la Belgique envoya, malgré l’opposition du gouvernement congolais, des parachutistes et d’autres unités d’élite qui rétablirent la situation en certains des points les plus chauds et protégèrent l’exode d’une masse de civils terrifiés.
En peu de temps, il y eut dix mille soldats belges dans le pays, la Force Publique cessa virtuellement d’exister et Moïse Tshombé, président de la riche province du Katanga, proclama l’indépendance de celle-ci.
Le Katanga fournissant la moitié des revenus du Congo, cette sécession constituait une véritable catastrophe. Le gouvernement central ne pouvait faire grand- chose pour forcer Tshombé à revenir dans le giron national.
D’ailleurs, le 11 juillet 1960, Lumumba demanda à M. Ralph Bunche, représentant de M. Dag Hammarskjöld , Secrétaire général des Nations unies, l’aide des Nations unies pour rétablir l’ordre dans l’Armée nationale congolaise (ANC), nouveau nom donné à la Force publique, soulignant l’incapacité de l’ANC, commandée par l’ex-adjudant Landula, promu général, à ramener l’ordre à Léopoldville et encore moins dans le reste du pays.
C’est ainsi que le secrétaire général des Nations unies, en accord avec le Conseil de sécurité, répondit favorablement et décida une action de grande envergure des Casques bleus. Une demande urgente a été faite à plusieurs pays, neutres et non-alignés, pour l’envoi de troupes au Congo, dont la Tunisie.
Le représentant de la Tunisie aux Nations unies feu M. Mongi Slim, compagnon de lutte du président Bourguiba et très fin politique, candidat à la présidence de la 16° session de l’Assemblée générale des Nations unies et qui la présidera deux mois plus tard, se fit un point d’honneur pour que le contingent tunisien soit le premier à fouler le sol congolais.
Le gouvernement tunisien donna son feu vert à la participation de l’armée tunisienne dans cette mission de maintien de la Paix au Congo. C’est alors qu’une course contre la montre s’engagea pour l’état-major tunisien. Celui-ci doit, en quelques jours seulement, former en agissant par prélèvement sur les unités existantes et par voie de volontariat, deux bataillons d’infanterie qui prirent l’appellation de 9° et 10e bataillon.
L’état-major tunisien fonctionna sans discontinuer, jour et nuit : il fallait, en très peu de temps, créer, organiser, équiper, armer, et préparer deux mille cinq cents hommes à partir sur «un théâtre d’opérations» se trouvant à plusieurs milliers de kilomètres de notre pays.
Les volontaires affluèrent de partout. Les Unités implantées sur la frontière ont été très peu mises à contribution et pour cause.
En effet, le 14 juillet 1960, les premiers soldats du fameux contingent tunisien commandé par feu le Colonel Lasmar Bouzaiane partaient pour Léopoldville pour vivre une épopée qui durera trois ans. La Brigade était composée de deux bataillons d’infanterie et de quelques services de soutien dont une compagnie de clique et de musique qui aura beaucoup de succès.
Notre pari, celui d’être les premiers Casques bleus à fouler la terre congolaise a été tenu et un gigantesque pont aérien, composé essentiellement de *Globemaster * américains a permis le transport de tout le contingent en quelques jours.
Les forces des Nations unies qui se rassemblaient à Léopoldville avaient quatre missions principales :
1- remplacer rapidement les unités belges qui maintenaient l’ordre,
2- prendre la place des troupes incertaines de l’ANC, réprimer leurs activités indésirables et, par la suite, essayer d’en faire une force sûre,
3- établir la liberté de mouvement des forces de l’ONUC dans tout le pays, et
4- se tenir prêts à empêcher toute intervention unilatérale de l’extérieur.
La Brigade tunisienne, après avoir perçu les équipements spécifiques, a été chargée de la province du Kassai dont le premier ministre, Albert Kalonji, était sur le point de proclamer l’indépendance.
En effet, la situation dans cette province n’était pas brillante : d’un côté, des massacres entre les tribus Balubas et Luluas, les deux plus importantes des quatre tribus qui composent cette province, étaient signalés et les pertes humaines, de part et d’autre, se comptaient par dizaines ; de l’autre, l’ANC, l’Armée nationale congolaise, très mal ou pas du tout commandée et dont l’instruction laissait beaucoup à désirer, semait la terreur en effectuant des actes de banditisme et de règlement de compte.
Même les troupes organisées, ne possédant pas d’intendance, vivaient du pillage ; elles incendiaient les villages dont les habitants fuyaient dans la brousse.
La Brigade tunisienne, arrivée à Luluabourg, capitale du Kassai, a aussitôt commencé son déploiement dans la province. Chacun de ses bataillons a reçu son secteur de responsabilité. Leurs unités ont été implantées dans les principales villes de la région, essentiellement dans les zones où les animosités entre les deux plus importantes tribus (Luluas et Balubas) étaient à fleur de peau et risquaient de mettre en danger la vie de la population.
Le poste de commandement de la Brigade et les unités de commandement, de soutien et d’appui ont été installés à Luluabourg avec une compagnie à l’aéroport. Cet aérodrome était pour nous le point le plus sensible puisqu’il représentait pour la Force de l’Onuc le seul moyen de liaison avec Léopoldville d’où nous arrive notre soutien logistique ainsi que pour les liaisons et communications aériennes avec le Congo ou avec l’extérieur.
Les villes tenues par nos unités étaient les suivantes : Luluabourg, Port Franqui, Mweka, Lac Makamba, Tsikapa, Bakwanga, Gandajika, Luputa et Mwene Ditu.
La mission reçue par la Brigade tunisienne était «d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre public dans la province » tout en neutralisant l’ANC et en la désarmant parce que, non commandée, elle agissait en bandes incontrôlées et terrorisait la population. Cette dernière mission a été accomplie en très peu de temps.
Nous passions des heures et des heures à «palabrer» avec les chefs de tribus, à leur expliquer qu’il n’y a aucune différence entre un Lulua, un Baluba, un Batshok ou un Botendé. Nous leur rappelions que les quatre tribus sont des congolais à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs et que leurs tribus forment ensemble cette belle province du Kassai avec un même peuple condamné à vivre ensemble en toute sécurité et en bonne intelligence.
Il n’était pas facile de convaincre des chefs de tribus qui, ayant eu des dizaines d’hommes tués dans ces combats fratricides et inutiles, ne pensaient qu’à prendre leur revanche et rendre coup pour coup.
Nous avions trouvé, au début de notre mission, beaucoup de difficultés à obtenir des résultats positifs. Il nous est même arrivé d’intervenir, en faisant démonstration de notre force, pour séparer les belligérants et nous profitions, à chaque fois, de pareilles opérations pour confisquer et récupérer l’armement utilisé dont certaines armes modernes qui étaient volées ainsi que des explosifs subtilisés des mines avec lesquels ils essayaient de fabriquer des bombes artisanales. Pareils incidents entre les tribus laissaient parfois des dizaines de morts qu’il fallait tout de suite enterrer dans des fosses communes pour éviter les épidémies.
Nos officiers et nos sous-officiers ont brillé par leur intelligence et leur savoir-faire : ils ont pu, en très peu de temps, nouer d’excellentes relations avec la population.
Notre appartenance à l’Afrique était pour nous un facteur positif et un argument déterminant qui nous ont beaucoup rapprochés de la population locale. Celle-ci, sensible à notre discours sincère et à notre franche volonté de l’aider, nous a écoutés et nous a appréciés. Ceci a beaucoup facilité notre tâche.
Certains officiers se sont fort bien investis dans cette mission de pacification, et l’exemple de feu le Colonel Hamida Ferchichi, Lt à ce moment-là, en est la meilleure illustration : il a réussi très vite à apprendre la langue la plus parlée de la province, le tshiluba, lui permettant ainsi de se passer des services d’un interprète dans le but d’être en communion directe avec la population. Il a été très efficace et a obtenu, en très peu de temps, des résultats dignes d’éloges.
Trois mois ont suffi à la Brigade pour ramener la paix et la sécurité à la province et «le Prince du Kassai», surnom donné au Colonel Lasmar commandant la Brigade tunisienne par le Commandant en Chef des Forces de l’Onuc au Congo, le Général suédois Carl Von Horn, en reconnaissance aux brillants résultats qu’il a obtenus en si peu de temps, déclara Luluabourg, ville ouverte, c’est-à-dire, ville pacifiée. Les Congolais (autorité et population) ont compris que nous n’étions là qu’uniquement pour les aider à s’administrer, à gérer leurs propres affaires et à se gouverner eux-mêmes.
La population a recommencé, aussitôt, à s’adonner à ses occupations normales; la police et la gendarmerie à reprendre du service et les bourgmestres (maires) à s’occuper de la gestion de leur ville.
Nous avons déploré la perte de quelques hommes dont le sergent-chef Belkhairia qui a été porté disparu.
Le commandement des Forces de l’Onuc a été surpris par la rapidité avec laquelle nous avions accompli la mission qui nous a été confiée avec des résultats aussi flatteurs et surtout en pacifiant, très rapidement, cette province, beaucoup plus vaste que notre pays. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles, devant les problèmes de sécurité qui commençaient à devenir sérieux dans la capitale du Congo, Léopoldville, il décida en octobre 1960, de permuter la Brigade tunisienne avec la Brigade ghanéenne pour lui confier la mission de maintien de l’ordre et de la sécurité dans cette capitale de plusieurs millions d’habitants.
Il voulait en même temps éloigner la Brigade ghanéenne de Léopoldville pour l’empêcher de s’impliquer davantage dans les affaires congolo-congolaises, le Ghana ayant, dès le départ, pris fait et cause pour le premier Ministre Patrice Lumumba.
Le commandement militaire de l’Onuc de la place de Léopoldville est passé sous l’autorité effective de la Brigade tunisienne à compter du 11 novembre 1960 à 12 heures.
Quant à la nouvelle mission de notre Brigade, elle s’annonçait complexe car la situation dans la capitale congolaise était assez particulière. En effet, une atmosphère changeante et équivoque régnait dans la ville de Léo.
La Brigade assurait son installation, à Léopoldville, en même temps qu’elle remplissait sa mission, délicate, de maintien de l’ordre et de la sécurité dans cette grande métropole ceinturée par des cités autochtones où vivent des centaines de milliers de Congolais dont une grande majorité avait fui la brousse pour s’installer auprès de la civilisation!!! auprès de la richesse!!! et auprès de l’indépendance°!!!
Bien que la ville européenne soit relativement calme, les cités indigènes, surchauffées par les leaders politiques qui pullulaient, étaient en ébullition permanente : cette situation était souvent provoquée par les rumeurs de toutes sortes qui circulaient bien et par l’excès d’alcool, rendant l’ambiance explosive à tout moment.
Les hommes politiques au Congo où se manifestaient, ouvertement, des dizaines de partis politiques plus ou moins représentatifs ne facilitaient pas notre mission. Leur alliance d’aujourd’hui sera défaite le lendemain pour se reconstituer le surlendemain. L’ANC (l’Armée nationale congolaise), voulant aussi imposer ses points de vue, s’impliquer dans la vie politique du pays en vue de se positionner comme arbitre, versait de l’huile sur le feu.
Cette situation atteignit son paroxysme lorsqu’en novembre 1960, un groupe de militaires de l’ANC encercla, avec des troupes appuyées par deux automitrailleuses, la résidence de l’ambassadeur du Ghana, celui-ci venant d’être déclaré persona non grata. Les militaires congolais s’étaient présentés chez lui pour l’arrêter et, d’après eux, dans le but de l’expulser.
Bénéficiant de l’immunité diplomatique, sa résidence était mise sous la protection des Forces de l’Onuc comme certaines autres Ambassades. Un détachement tunisien assurait sa garde. Devant l’insistance des éléments de l’ANC qui voulaient arrêter l’ambassadeur coûte que coûte, et après de longues heures de palabres, et suite au refus du détachement tunisien de leur laisser la voie libre, les Congolais ont ouvert le feu sur nos éléments. Ce fut une longue fusillade sur nos troupes qui, usant du droit de légitime défense, ont riposté énergiquement.
C’est l’incident le plus grave et le plus sérieux auquel les Forces de l’ONUC en général et les troupes tunisiennes en particulier ont eu à faire face au cours des six premiers mois de présence dans ce pays. Cet incident malheureux sera tendancieusement exploité par les partis politiques anti-Onu.
Il a fallu, à la Brigade Tunisienne, après les pertes subis par les Congolais ( plusieurs morts dont le Colonel Nkokolo, le Commandant militaire de Léopoldville et blessés), et un mort et sept blessés dans nos rangs (dont notre camarade feu le Lieutenant Mahmoud Gannouni qui reçut plusieurs balles à l’estomac, ce qui a nécessité son évacuation sur la Tunisie dès que son état de santé l’eut permis) beaucoup de diplomatie, du sang froid et assez de retenue pour calmer le jeu et gagner de nouveau la confiance de la population congolaise qui vivait dans une ambiance surchauffée.
Afin de mettre un terme à ces fâcheux incidents qui ne contribuaient qu’à compliquer davantage une situation qui n’était déjà que trop confuse, le Commandant de la Brigade avait décidé de décréter, certains secteurs de la ville de Léopoldville «Zones sûres»-«Zones non sûres» et «Zones dangereuses».
Tous les personnels de toutes les nationalités, civils et militaires, travaillant sous l’égide des Nations Unies au Congo, sous quelque forme que ce soit, en ont été avisés par une note officielle.
Il y a lieu de préciser qu’en plus des missions opérationnelles, l’ONUC employait plusieurs contingents dans les tâches administratives, logistiques, de communications, de santé et de police militaire. D’ailleurs les forces de l’ONU Congo étaient composées de contingents Suédois, Canadien, Pakistanais, Indou, Norvégien, Malaisien, Indonésien, Libérien, Irlandais, Ethiopien, Egyptien, Marocain, Nigérien, Malien (Sénégalais et Soudanais), et Ghanéen entre autres ainsi que Tunisien.
Les incidents se multiplièrent et les accrochages, plus ou moins graves, étaient de plus en plus nombreux.
C’est dans cette ambiance de méfiance, d’incertitude et de crainte des uns par rapport aux autres qu’au mois de janvier 1961 et alors que les officiers tunisiens se trouvaient au cercle mess de Binza en train de déjeuner que notre camarade le Lieutenant Khelifa Dimassi, officier des transmissions du 9° Bataillon , a reçu une communication de l’une de nos unités implantées en dehors de la ville de Léopoldville, à l’Université de Luvanium.
Il a été avisé que le poste radio de l’unité était en panne et qu’elle ne pouvait, par conséquent, communiquer avec le Poste de Commandement. Dans le souci de ne pas laisser nos hommes sans moyen de liaison, il termina rapidement son repas et sans avoir pris d’escorte ni de chauffeur, sauta dans sa jeep et fonça aussitôt vers cette unité.
En quittant la ville de Léo, on est tout de suite plongé dans la brousse avec sa forêt très dense et sa végétation luxuriante. Quelques kilomètres plus loin, il tomba dans une embuscade tendue, d’après des informations non confirmées, par des militaires de l’ANC (Armée nationale congolaise) qui l’auraient arrêté et emmené avec eux.
Nous n’avons jamais eu de ses nouvelles. Le Commandement de l’ANC, répondant aux énergiques injonctions de l’ONUC et de la Brigade tunisienne, nia totalement l’implication de ses hommes dans cette affaire. Nous avons déduit qu’il aurait été victime d’un acte de vengeance après la mort du Colonel Nkokolo, tué lors de la fusillade de l’ambassade du Ghana. Notre camarade de Promotion Khelifa Dimassi, porté disparu, a été le premier martyr de la promotion. (A suivre)