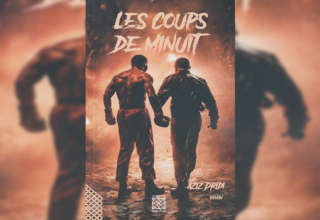Paru chez Sarra édition en 2025, le recueil de nouvelles de Mondher Marzouki est magnifiée par un imaginaire singulier.. Paru initialement en langue arabe, il a été traduit en langue française par la traductrice Leyla daâmi, ensuite, en langue espagnole par Dr Hela Saidani, universitaire linguiste, francophone et hispanophone. La spécialiste en lettres s’est laissé tenter par cette aventure pour créer des ponts entre cultures, de confondre les récits oraux et écrits, et de s’enrichir mutuellement entre cultures.
La Presse — Hela Saidani, vous signez la traduction en langue espagnole de quatre histoires extraites du recueil de Mondher Marzouki titré en version française «L’arbre fantasmagorique et les rêves sublimes». Vous qui êtes francophone et francisante, comment cette aventure a pu être menée à bout ?
En tant qu’universitaire linguiste, je suis profondément passionnée par les langues et les passerelles culturelles qu’elles permettent de construire. Cette aventure de traduction m’a beaucoup honorée et touchée : celle de traduire 4 nouvelles de « L’arbre fantasmagorique et les rêves sublimes » de Mondher Marzouki, et ce, du français vers l’espagnol. Leyla Daâmi, traductrice en langue française, s’est minutieusement mise à traduire le livre en entier en langue française depuis plus d’un an.
Par hasard, les deux versions en espagnol et en français sont parues en même temps. Le livre en arabe est paru dans sa première édition en 2023. J’ai repris le titre en le traduisant mot à mot du français à l’espagnol, tout en me basant sur la version originale en arabe. Cela était plus qu’un exercice linguistique, je dirais plutôt que je m’étais lancée dans une forme de médiation interculturelle.
Ce projet de traduction s’est inscrit dans une triple démarche : Académique, artistique et personnelle. «Académique», car il s’agit de respecter la richesse stylistique de l’auteur, sa profondeur philosophique et ses images poétiques. «Artistique», car il fallait recréer l’univers onirique de ces nouvelles dans une langue à la fois différente et complémentaire. «Personnelle», car en tant que Tunisienne arabe, francisante de formation, francophone, francophile et hispanophone (à travers mes années d’études en Espagne), je me suis retrouvée, consciemment ou non, dans un triple dialogue entre les cultures arabe, francophone et hispanophone.
Pendant la traduction, je ne me suis pas contentée d’une simple transposition linguistique, il a fallu penser en profondeur les équivalences culturelles, les nuances émotionnelles et les rythmes propre à chaque langue. Cette richesse due à des allers-retours entre les langues a rendu l’expérience stimulante et édifiante.
Ce projet est né d’une double volonté, celle de l’auteur qui m’a découverte, et de la mienne. Je l’ai consulté à plusieurs reprises, et discuté longuement autour de ce projet de traduction. J’ai pris en considération une réalité culturelle liée à l’Espagne. Je me suis occupée de la mise en page du recueil. Je suis heureuse d’avoir pu faire rayonner une œuvre tunisienne à l’étranger à travers l’une des langues que je maîtrise le plus « L’espagnol », prolongeant ainsi les récits en dehors des frontières tunisiennes.
Je remercie Germinal Gil, directeur de centre Cervantes, qui m’a beaucoup soutenue et m’a relue afin de mener à bout cette démarche.
Comment s’est passé ce processus de traduction ? Y a-t-il eu un intermédiaire espagnol ou français qui s’est joint à votre travail?
Le processus de traduction s’est déroulé avec beaucoup de rigueur et de passion. Il est important de préciser que je n’ai traduit que vers la langue espagnole. Leyla Daâmi l’a fait en version française. Pendant ce processus, le recours à la version arabe originale et à la française se faisait tout le temps, ce qui m’a permis d’explorer les récits sous différentes perspectives.
Mon plurilinguisme m’a beaucoup aidée. Il m’a permis d’aborder les textes différemment. L’expérience était fascinante. Les langues citées ont toujours cohabité sur la rive méditerranéenne. L’arabe et l’espagnol ont toujours fusionné. C’est une grande richesse que nous partageons, entre deux pays, mutuellement au niveau historique, linguistique, économique.
L’accompagnement de Germinal Gil, le directeur du Cervantes, m’a été d’une grande aide. J’ai pu affiner la qualité de la traduction grâce à lui. Il n’est pas juste intermédiaire, j’évoquerais plus un appui, un soutien, une collaboration et un partage de savoir immense qui s’est fait entre nous. Les deux langues brandissent des valeurs humaines, célèbrent la vie et bouleversent l’humain par leur richesse.
Un défi de taille et sans doute des difficultés. Le challenge primaire est celui de traduire du texte initial en usant de votre lexique hispanophone, à votre manière, sans écorcher la portée originale du texte. Pouvez-vous nous citer toutes ces épreuves contournées pour parvenir à une traduction aussi maîtrisée, finalement ?
Traduire une œuvre, c’est bien plus qu’un passage d’une langue à une autre. C’est un exercice d’équilibre entre fidélité au texte source, l’arabe et créativité dans la langue cible, l’espagnol. Conserver l’âme du texte original, tout en trouvant une voie authentique en espagnol, qui ne trahisse ni le style de l‘auteur ni la charge émotionnelle des récits, c’est un exploit ! Il a fallu contourner plusieurs épreuves en rapport surtout avec la richesse symbolique de la langue arabe et de sa poésie, pleines d’images fortes et de métaphores culturelles qu’il fallait rendre d’une manière identique dans une langue autre qui n’a ni les mêmes structures ni les mêmes références. L’arabe est une langue casuelle et l’espagnol est une langue de position.
Les spécificités syntaxiques sont à prendre en considération et, l’enjeu culturel aussi, en évitant les traductions trop littérales. Il faut préserver la profondeur philosophique et l’étrangeté poétique. Le travail de révision a été fondamental et amplement mené par Germinal Gil, qui a veillé à perfectionner les textes d’une manière exigeante certes mais qui reste gratifiante.
Le travail a-t – il été effectué avec Mondher Marzouki, l’auteur du texte initial ? Jusqu’à quel degré la traductrice en langue française Leyla Dâami vous a-t-elle aidée ?
Bien sûr que j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’auteur, en échangeant avec lui sur certains passages complexes, sur les intentions narratives, ou encore les choix lexicaux les plus fidèles à son univers. Ces éclaircissements m’ont permis de saisir la portée philosophique et symbolique de certains éléments du texte, essentielle pour avoir un résultat final de la traduction juste et respectueuse de la vision de l’auteur.
La version française de Leyla Daâmi m’a servi de point d’appui dans la mesure où elle constitue la première transposition du texte original. Même si nous n’avons pas travaillé ensemble directement, sa traduction m’a offert un éclairage précieux sur certains passages et elle a agi comme un intermédiaire subtil entre l’arabe et l’espagnol. Cela m’a permis de mieux comprendre des nuances, attentions, compréhensions, ou même certaines métaphores. Il y a eu un travail collaboratif et diversifié entre nous trois.
Que signifie «Être aussi polyglotte» pour vous en 2025 ?
Être polyglotte, c’est bien plus un atout ou une compétence, c’est habiter le monde autrement, avoir plusieurs fenêtres ouvertes, sur les cultures, les sensibilités, les imaginaires. C’est pouvoir lire un texte en arabe, penser en français et rêver en espagnol, comme c’est notre cas à travers ce livre.
C’est dialoguer avec l’altérité sans filtres. Dans un monde où les frontières se déplacent et où les identités se croisent, parler plusieurs langues, c’est aussi refuser les simplifications. C’est embrasser la complexité, écouter plus finement et comprendre en profondeur. C’est un engagement à tisser des liens, à créer des ponts entre des univers, à défendre la diversité comme une richesse fondamentale. Être polyglotte, c’est résolument choisir l’ouverture, la curiosité et la rencontre.