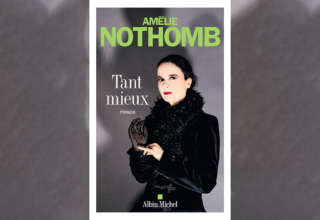Il a toujours fui les projecteurs du showbiz, refusé les normes du succès calibré, et tenu à garder son art affranchi des compromis. Zied Rahabani n’a jamais cédé à ce que l’industrie appelle une «carrière».
La Presse —Ziad Rahabani, disparu hier, samedi 26 juillet, ne se laisse pas résumer. Est-il le fils de… Fairouz et Assi Rahbani ? Oui, bien sûr. Mais il est aussi, et surtout, l’artiste qui ne marche pas sur le sentier balisé par «la famille», qui trouve inspiration et quiétude dans le «hors norme», celui qui entre en scène comme on entre en résistance.
Auteur, compositeur, pianiste, dramaturge, satiriste… Il n’a jamais voulu planifier une trajectoire. Il n’a jamais voulu plaire. Il a simplement voulu dire, jouer, provoquer. Agiter. Perturber. Il a utilisé la musique — surtout le jazz — comme un scalpel pour découper les hypocrisies sociales et politiques, et comme un théâtre pour raconter les âmes cabossées d’un Liban fatigué mais toujours vibrant.
Son passage au Festival international de Hammamet restera dans les mémoires comme un parfait résumé de qui il était : déroutant, distant, fidèle uniquement à son projet artistique. Il n’a pas chanté «ce que tout le monde connaît». Il a joué ce qu’il avait décidé de jouer, avec exigence, froideur apparente, mais une rigueur artistique rare.
Zied Rahbani n’a pas cherché à séduire. Il était là, tout au long de sa vie, pour secouer. Par la satire, par la tendresse déguisée en sarcasme, par les silences aussi. Il était le fils d’une tradition musicale grandiose, mais il a refusé d’en être l’héritier docile. Il a donné à Fairouz une seconde voix, une autre ère. Il a démocratisé le jazz dans un monde arabe qui en avait peu les codes. Il a été, à sa manière, un disciple de Sayed Darwiche ou Cheikh Imam : libre, irrévérencieux, poignant. Aujourd’hui, il n’est plus là. Et son absence, comme sa présence, continuera de troubler.