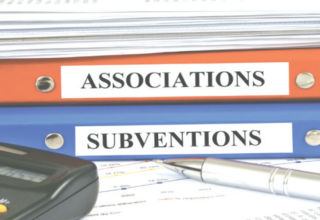Lors de son récent passage à la 79e édition du festival d’Avignon, Afif Riahi, fondateur d’« Echos Electrik » et professionnel de la musique et des outils numériques, a participé à une table ronde qui a traité «des mutations dans le monde arabe», celles artistiques et culturelles. Il a assuré un partage d’expérience des plus édifiants et a éclairé un large public. Cet entretien revient sur cette table ronde, avec un focus sur « Echos Electrik » et « No Logo », qui ne cessent d’œuvrer en Tunisie.
La Presse — Votre participation à la 79e édition du festival d’Avignon, maintenue, cette année, en hommage à la langue arabe, s’est faite dans le cadre d’une discussion édifiante. Parlons–en !
La langue arabe, selon moi, n’était pas assez présente. Il n’y avait pas assez de temps pour une meilleure représentation de la langue arabe et de l’arabité à Avignon. Pas dans le cadre du festival, en tout cas, mais c’est toujours bien qu’il y ait des focus. J ait été invité au festival d’Avignon pour parler de mon association «Echos Electrik». Créée en 2007, elle a pour objectif de démocratiser la culture numérique en Tunisie. J’ai fait ma scolarité dans mon pays d’origine, et je n’ai cessé de travailler sur place. «Echos Electrik» a développé le projet «E – Fest», qui s’est déroulé à la Cathédrale de Carthage en 2007. Un projet qui traitait de la culture numérique mais pas d’un point de vue «Musique – DJing» seulement : il s’agissait d’inclure les outils numériques créatives dans d’autres disciplines artistiques. Plein d’expositions et d’interventions ont eu lieu notamment dans des endroits publics.
Quelles ont été les disciplines ciblées ?
Les principaux axes de l’« E- Fest » ont touché la musique et les arts visuels. Le projet a perduré de 2007 jusqu’en 2017 et a permis de démocratiser les pratiques et de fédérer de nombreux artistes qui se sont questionnés sur ces outils, s’y sont imprégnés et ont vécu l’« E – Fest ». Une manifestation qui, auparavant, a marqué une génération. On a arrêté le festival, par la suite, quand on a senti que la mission était accomplie, celle de rendre le numérique à la portée, et nous nous sommes focalisés sur une décentralisation de nos activités dans les régions, en dehors de Tunis. « No Logo » a donc été créée et s’est développée pendant 5 ans, même pendant la pandémie. C’est une forme d’« E- Fest » mobile, qui s’est déroulé dans 9 villes, et dans d’autres algériennes et marocaines. On était un collectif de 15 personnes, artistes et techniciens, qui passait les trois quarts du mois dans une ville où on y crée des initiatives avec les locaux, en collaborant avec les structures culturelles, éducatives, associations, écoles… Chaque ville connaîtra au fur à mesure son programme, qui prendra la forme « d’une bulle de création ».Une structure imposante qui atteint les 400 m2, de 15 mètres de haut et qui a accueilli de nombreuses personnes. Une bulle a vu le jour dans chaque territoire, avec 400 personnes dedans.
Qu’est-ce que « cette bulle » ?
La bulle est un objet architectural, conçu à base de plastique, avec un design, qu’on construit dans des ateliers avec des participants. La bulle devient un objet gonflable qu’on peut installer dans l’espace public. Cela crée un espace culturel éphémère qui n’existait pas dans un espace public et c’est dans cette bulle qu’on rendait compte de tout ce qu’on a créé et travaillé avec le tissu local de chaque territoire. Un « No Logo » Tataouine a vu le jour, d’où le retour récent de « l’E – Fest » là-bas. Le numérique reste présent mais avec davantage de volonté de développer la culture sur le terrain. De mettre les arts au service d’un territoire et de les développer. On propose des projets qui aident au développement territorial dans les régions éloignées. On utilise toujours nos outils mais pas d’une manière première. On valorise plutôt le numérique et on le diffuse en soutenant ainsi un territoire en y insérant des formes d’expressions artistiques transversales.

Que voulez–vous dire par « transversale » ?
C’est quand les disciplines artistiques peuvent se croiser. La musique, avec l’art numérique, ou le Dj-iing, par exemple. L’idéal c’est de créer un festival qui soit ouvert sur un maximum de disciplines, en les questionnant, sans retenu. Chaque action artistique questionne le territoire et reste au service du public local, pour qu’il puisse y participer. Cette transversalité existe dans l’expression artistique mais aussi @dans cette possibilité d’en faire un« festival ». « L’E – Fest » a fonctionné en billetterie libre. Chacun pouvait payer ce qu’il souhaite. L’argent ramassé a été investi dans la restauration du Ksar où on avait fait « l’E – Fest ». Nous construisons dans la durabilité et nous voudrions laisser une trace des projets culturels conçus.
Que faut-il retenir de cette table ronde autour du monde arabe ?
Dans ce contexte, il y a à la fois notre approche, qui questionne tout ce qui se crée d’une manière actuelle et ce que nous créons au niveau des territoires, qui a été évoqué dans le cadre de cette rencontre dont le thème est « La mutation du monde arabe ». Un titre que je ne valide pas : le monde arabe est en évolution, il ne mute pas. J’ai tenté d’apporter un regard sur ce qui existe dans notre territoire avec cette jeunesse riche d’envie, de talents et d’idées. Les outils numériques sont partagés d’une manière universelle. Pendant l’intervention j’ai valorisé un territoire qui a beaucoup à apporter, dans un monde connecté et des jeunes conscients des enjeux de l’époque.
La table ronde avait comme thématique le prochain programme méditerranéen « Saison méditerranéenne » et un lot d’interrogations : est ce qu’il y a une scène arabe ? Une seule identité ? Comment peut-on les qualifier ?. J’ai valorisé une diversification totale des identités et des scènes. Il ne faut pas nous mettre tous dans le même sac. Nos vécus et nos histoires dans le monde arabe sont tellement différents. Des personnes sont venues instinctivement me parler vers la fin de la discussion et ont exprimé leur joie de m’avoir écouté décloisonner cette pensée « mono-forme » sur le monde arabe. Cela leur a fait du bien d’avoir un témoignage d’expérience et de connaître ce qui se passe dans d’autres territoires. Cela a été favorablement accueilli.
Que pensez–vous de la scène visuelle et artistique actuelle en Tunisie ?
On a vraiment une nouvelle génération plus attentive et plus actuelle que la nôtre. A l’époque de l’« E- Fest », beaucoup de médiation a eu lieu afin de faire connaître les arts numériques et cet univers des outils, autrefois méconnu.
Quand on fait des ateliers sur des outils numériques, de nos jours, beaucoup savent ce que c’est. Cela dit quand même que le domaine des nouvelles technologies et la jeunesse sont ultra à la page. Ce qui manque en revanche, ce sont des espaces où ils peuvent montrer leur travail, leur création et même où se former. Des espaces où ces jeunes peuvent échanger, s’exprimer, créer ensemble.