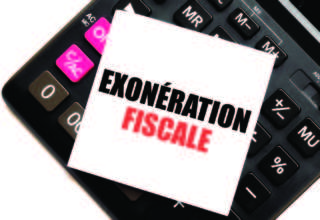La Tunisie se distingue sur la scène économique mondiale par une prouesse remarquable : elle est parvenue à garantir sa stabilité macro-financière, à financer son déficit courant et à honorer la totalité du principal de sa dette extérieure, sans avoir recours à un programme d’ajustement structurel du Fonds monétaire international (FMI). Cette stratégie nationale a eu des effets tangibles, se traduisant par une réduction de l’endettement extérieur, une inflation maîtrisée et une stabilité du dinar. Intitulée « Stabilité́ macro financière en Tunisie réalisations du programme national versus le programme FMI », cette note, réalisée par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), met en lumière les réalisations de ce programme interne face aux exigences traditionnelles du FMI.
Malgré l’absence de soutien formel du FMI, la Tunisie fait face à une double contrainte : combler un déficit extérieur structurel et assurer le service de sa dette. Les chiffres de la balance des paiements révèlent l’ampleur du défi : le déficit courant, bien que réduit par rapport à 2022 (-8,8% du PIB), est estimé à -3,1% du PIB pour 2025 (-5603 millions de Dinars,). Plus préoccupant, le solde primaire (avant le paiement des intérêts sur la dette extérieure) reste négatif, indiquant que les opérations courantes ne génèrent pas un surplus suffisant pour servir la dette extérieure.
Le besoin total net en devises pour couvrir le déficit courant et rembourser la dette extérieure est estimé à 3136 MD en 2025, soit une augmentation significative par rapport aux 98 MD requis en 2024. Cette hausse est exacerbée par la stagnation des exportations (-0,3% sur les huit premiers mois de 2025) et des pertes spécifiques, comme la baisse du prix de l’huile d’olive (1,1 milliard TND) et la diminution de la production d’hydrocarbures (près de 1 milliard TND).
Toutefois, le financement est assuré grâce aux aides en capital, aux Investissements Directs Étrangers (IDE) nets (estimés à 3200 MD en 2025) et aux apports de capitaux à long terme (7500 MD). Le service de la dette extérieure pour 2025 (estimé à 10500 MD en principal) sera couvert, bien que cela nécessite une baisse des réserves de change. Malgré cette réduction anticipée, le stock de réserves devrait rester suffisant pour couvrir 91 jours d’importations, une limite jugée acceptable par les institutions financières. C’est cette gestion rigoureuse qui explique les récentes améliorations de la notation de la Tunisie par les agences internationales.
Programmes opposés : Croissance équitable VS remboursement
Les divergences entre le programme national et les recommandations du FMI résident avant tout dans leurs objectifs fondamentaux. Le FMI cherche prioritairement à garantir le remboursement de la dette envers les bailleurs de fonds, tandis que la Tunisie ambitionne de promouvoir une croissance économique équitable, visant l’amélioration du niveau de vie de sa population.
Ces différences se matérialisent sur plusieurs fronts. Le programme national maintient la stabilité du dinar et des réserves de change, craignant qu’une flexibilité rapide n’entraîne une demande spéculative de devises ou des fuites de capitaux. Le FMI, en revanche, préconise une dépréciation annuelle de 5 à 10 % et la flexibilité de la convertibilité pour fluidifier le système de paiements internationaux.
Sur le plan budgétaire, le FMI exige un solde primaire positif pour l’État afin de garantir la réduction de la dette. La Tunisie a adopté une stratégie de compression des dépenses générales, réduisant le ratio dépenses publiques/PIB de 36,3 % en 2022 à 34,2 % en 2024. Cette politique a permis de ramener le déficit budgétaire de 7,6 % du PIB en 2023 à 6 % en 2024, un résultat supérieur aux prévisions. Ce succès a été atteint en limitant les quantités de produits subventionnés et en contenant la hausse des salaires nominaux, inférieure à l’inflation, ce qui a favorisé l’accroissement des dépenses d’investissement.
Concernant les subventions, la Tunisie a choisi de maintenir le niveau des prix des produits essentiels tout en réduisant les quantités disponibles et en introduisant une contribution de solidarité sociale sous forme d’impôt direct. Les autorités mettent en avant le rôle distributif des prix dans une économie marquée par un secteur informel important, estimant que cette approche permet d’augmenter le revenu réel des ménages pauvres sans recourir à un processus d’identification complexe. Le FMI, pour sa part, prône la suppression complète des subventions afin de rétablir les prix de marché et de limiter le gaspillage.
Le risque latent : Les entreprises publiques
Le point de convergence des préoccupations, mais aussi le principal risque non résolu du programme national, concerne la situation des entreprises publiques. Ces entités souffrent de déficits élevés, de l’accumulation de dettes qui pèsent sur le système bancaire public, et d’une dégradation de leurs services. La mauvaise gestion interne et les facteurs externes (prix bloqués face à la hausse des coûts, dépréciation du dinar) ont aggravé leur situation. Pour certaines, comme la SNCFT, les salaires dépassent le chiffre d’affaires, et pour d’autres (Office des Céréales, STEG), la dette atteint des milliards de dinars. Le FMI avait proposé des solutions allant jusqu’à la privatisation, mais les autorités ont laissé la situation s’aggraver, rendant la réforme de ces entreprises une urgence structurelle qui ne peut plus être différée.
En dépit de ces divergences, l’obligation de faire face au service de la dette extérieure demeure le point commun aux deux approches. La Tunisie a honoré ses engagements passés envers le FMI pour des montants considérables : 750 millions de dollars sont prévus en 2024, suivis de 533 millions en 2025.