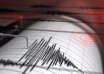Journaliste et critique libanais, il fait partie de ceux qui observent et analysent la pratique culturelle. Témoin aguerri du fait culturel dans le monde arabe, il porte, avec ses écrits, un point de vue distancié sur l’évolution, les enjeux et les implications de la pratique artistique. Longtemps journaliste et critique à «Al youm assabeh» (Paris), puis à «Al hayat» (Londres, Beyrouth), il lance en 2004, avec une nouvelle génération de journalistes et d’artistes arabes, la revue culturelle «Zawaya». En 2006 il est un des fondateurs du quotidien panarabe «Al-akhbar» (basé à Beyrouth), où il assure actuellement les fonctions de directeur adjoint de la rédaction.
Avant de nous lancer dans l’analyse du fait culturel, ses enjeux, ses glissements, et ses paradoxes, essayons d’abord de répondre à la question de l’utilité de la culture ?
Une société privée de culture, qui se contente de consommer les idées et les produits imposés par un pouvoir colonial, va vers sa mort civilisationnelle. On nous rebat aujourd’hui les oreilles avec des rhétoriques sur le désengagement des nouvelles générations —c’est la logique du progrès, nous explique-t-on— et sur une jeunesse qui se détourne de la culture. Si certaines observations ne sont pas complètement fausses, le fait est qu’elles sont exploitées pour justifier l’expansion et la domination d’une culture de consommation, au détriment de la culture que nous définissons comme moyen d’expression citoyen. La culture est un outil, un moyen, un medium, par l’intermédiaire duquel un individu ou un groupe s’exprime, existe, affirme sa présence, son identité, prend conscience, en les formulant, de ses droits, de ses soucis, de son besoin d’affranchissement, de liberté, de transgression, de réflexion et de construction de liens avec le passé et avec le futur, avec d’autres sociétés, civilisations et groupes humains.
Ce qui nous ramène à une question aussi bien politique qu’existentielle : Sans culture, serions-nous menacés de ne plus exister? Une question encore plus cruciale dans nos sociétés où le néocolonialisme veut à tout prix nous déposséder de ce moyen d’expression et nous imposer sa pensée dominante.
Voulez-vous dire que la culture est un terrain à conquérir et à maîtriser ? La culture est-elle un champ de guerre ?
Oui tout à fait, la culture est un enjeu national, un laboratoire citoyen à travers lequel se constitue une identité ouverte et sans cesse réinventée. Un outil de revendication également, garant de la démocratie dans la cité, un facteur rassembleur, générateur de cohésion sociale et de paix civile, un chemin vers l’évolution, le progrès, la justice, la liberté. Voilà pourquoi la culture reste une préoccupation majeure pour tous les pouvoirs dominants cherchant à apprivoiser, récupérer voire étouffer la culture, en imposant un modèle officiel, aseptisé, folklorique, au service de la pensée unique, ayant pour objectif le formatage des esprits. Il s’agit là d’une stratégie d’enfermement dans le moule du «bon citoyen-consommateur» qui suit, obéit et subit, en fonction des exigences du pouvoir en place et des stratégies du système global dominant. Cela s’applique aussi bien au système hégémonique colonial, qu’à toutes les incarnations du pouvoir local oppressif : politiques, économiques, sociales, religieuses. Je pense à la culture patriarcale, aux traditions, aux petits chefs et sous-chefs, au patronat, à l’oppression sécuritaire, sociale et économique… Tous ces pouvoirs vont essayer d’une façon ou d’une autre de nous soutirer cet outil de questionnement qui nous aide à repenser la place de l’individu dans une société, à repenser les droits de l’individu à l’épanouissement, à l’égalité, à la justice sociale, à la différence et à la liberté de penser et de s’exprimer.
Une société privée de culture, qui se contente de consommer les idées et les produits imposés par un pouvoir colonial, va vers sa mort civilisationnelle
N’est-ce pas une vision révolue qu’est celle de la culture comme acte politique ?
Pas du tout ! Tout acte citoyen est un acte politique. De la même manière, toute forme d’expression, de création, est foncièrement politique. Je ne fais pas référence dans mes propos, loin de là, au modèle jdanoviste. Où une élite éclairée qui connaîtrait les intérêts du peuple imposerait aux intellectuels, aux créateurs, les sujets à aborder et les modèles esthétiques à appliquer. Et où tout anticonformisme serait taxé de déviationnisme et sévèrement réprimé. Même la définition de l’art engagé des années soixante-dix a été longuement revisitée, remise en question, et a évolué vers une vision plus nuancée, plus organique, mais toujours aussi radicale et critique vis-à-vis du pouvoir, du système dominant. Le processus de création est délicat et complexe, ouvert à tous les champs du possible. Et la culture est par définition un questionnement incessant de l’expérience humaine. Ainsi quand nous parlons de la dimension politique de la culture, nous n’esquivons pas le domaine de l’intime, du personnel, du marginal, ni les préoccupations esthétiques pures, les questionnements existentiels, spirituels et métaphysiques intrinsèques à la création. Un artiste peut aussi bien défendre les libertés individuelles que ce qu’on appelait jadis «la cause du peuple». Cela dit, la pratique culturelle reste politique au sens le plus large, au sens philosophique et éthique du terme. C’est dans cette optique-là que questionner, suivre, soutenir, défendre la culture, est dans nos sociétés arabes, un acte de résistance.
Dans quel sens peut-on parler du rôle que peut avoir l’artiste ou l’intellectuel dans son groupe et à quel point peut-il préserver son individualité.
Après tout ce qui a été pensé et créé durant de nombreuses décennies dans le monde, après les différents modèles et systèmes expérimentés dans les méandres du siècle dernier, je ne pense pas qu’il serait raisonnable, aujourd’hui encore, de s’aventurer à imposer une mission restrictive à la création, en disant par exemple : voilà ce que l’artiste devrait faire pour la gloire de son peuple et de sa société. Ne cédons pas non plus à la facilité de vouloir se défaire de tout un pan de l’histoire de l’engagement politique. Moi je me place dans une dynamique de réflexion, dans une évolution dialectique vers quelque chose d’autre. Toujours dans la perspective d’affrontement avec l’ordre établi.
A mon avis l’artiste ou l’intellectuel qui se pose des questions, ayant recours aux sources du savoir, ou habité par des préoccupations esthétiques et stylistiques, menant une réflexion sur un moment historique, sur certains aspects d’une société, s’impose à lui-même et d’une manière intrinsèque à sa pratique, l’idée de questionner un système, d’avoir un regard critique sur le monde, allant des rapports les plus intimes et personnels aux questionnements les plus complexes des rapports politiques, économiques et sociaux. C’est bien là aussi que se définit le rôle de l’artiste.
Comment, d’après vous, cela peut se refléter dans la pratique artistique ou intellectuelle ?
Si nous prenons les sociétés libanaise et tunisienne qui ont de nombreux points en commun (l’histoire, les avant-gardes artistiques, le rapport à l’Occident avec des questions récurrentes qui touchent à l’identité par rapport au modèle occidental), je peux dire que l’artiste a, très souvent, regardé en face le monde dans lequel il vit, les souffrances du groupe auquel il appartient. Il a tenté de démonter ce système imposé à travers la création, qui peut être un titre de rap, une installation artistique, un roman classique, une pièce de théâtre, un film ou une composition musicale.
Je pense à des artistes aussi différents les uns des autres, comme Anouar Brahem, Ziad Rahabani, comme Roger Assaf ou Fadhel Jaibi, et bien d’autres, qui ont marqué, chacun à sa façon, un moment important de notre histoire vécue, qui est essentiellement politique. Et même avec les pièges systématiquement tendus à l’artiste dans des sociétés comme les nôtres, (je pense à la fascination vis-à-vis de l’Occident, aux pièges fatals de l’aliénation politique, à la posture de supériorité par rapport au groupe), sa pratique reste à chaque fois un acte politique. C’est un acte engagé, fruit de tant de réflexions et de souffrances, questionnant le système quel qu’il soit, repensant la présence de l’individu dans un groupe, dans une société et dans le monde, à travers tous les facteurs, toutes les influences, tous les défis, tous les systèmes d’exploitation auxquels il est confronté, qu’il en soit conscient ou pas.
Ce sont des romans, des recueils de poèmes, des chansons, des œuvres artistiques, des films et des spectacles, qui m’ont extrait du milieu réactionnaire et isolationniste où je me trouvais par la force des choses au début de la guerre civile libanaise
Sommes-nous conditionnés par ce rapport dominant /dominé, et à quel point selon vous cela influence-t-il la création ?
Le système d’exploitation existe, qu’on en soit conscient ou pas, et nous sommes, sans forcément le vouloir, en confrontation directe ou indirecte avec lui. Tout acte de création en est une transgression. Les systèmes religieux ou politique dominants n’ont jamais aimé l’artiste, cet être qui «défie le créateur», qui recrée le monde et le refait à sa manière selon sa sensibilité, sa vision, sa philosophie, ses choix et ses partis pris. C’est dans ce sens que nous sommes amenés à nous opposer à l’ordre établi, chacun à sa façon et de son point de vue, tout en rêvant le monde, et en défendant des visions plus ou moins réalistes ou utopiques…
Mais tous les grands projets de changement ne sont-ils pas des utopies au départ ?
Je continue à penser, avec l’accumulation des expériences et des réflexions, que les artistes, par définition, sont de grands utopistes, des transgresseurs et des révolutionnaires, bien entendu chacun à sa façon. Certains grands artistes au Liban comme l’homme de théâtre et dramaturge Raymond Gébara, le cinéaste Maroun Baghdadi, le poète Ounsi el Haj sont des créateurs qui se sont heurtés au système. Pourtant ils ont tous les trois en commun d’avoir adhéré à ce même système ! On peut s’aventurer à les classer comme «anarchistes de droite» ! Ils faisaient partie du système de valeurs auquel il se sont opposés, esthétiquement, philosophiquement ou politiquement. Raymond Gébara s’est bien moqué, dans ses écrits et pièces de théâtre, du pouvoir ecclésiastique tout en restant profondément croyant. Pareil pour Ounsi El Haj, grand précurseur de la poésie arabe moderne, qui a chamboulé les règles de l’écriture, transgressant les moules classiques, alors qu’il a plus ou moins sympathisé avec le courant réactionnaire et isolationniste au Liban, caractérisé par une phobie de l’arabité et un complexe de supériorité envers «les Arabes». Ce que je veux dire par là est qu’on ne peut pas ne pas œuvrer pour le progrès, en faisant bouger les choses, quand on est créateur, sensible, sincère et doué, quelle que soit notre appartenance.
D’après vous alors, l’artiste n’est ni totalement libre ni entièrement dompté…
La liberté de l’artiste ou la liberté de créer est très relative, elle est liée à la prise de conscience de l’individu qui réfléchit ou crée, et de son choix moral qui va déterminer l’indépendance vis-à-vis du système, tout en sachant que les tentations sont énormes. L’artiste ou l’intellectuel, surtout dans le monde arabe aujourd’hui, sont toujours confrontés à la tentation de pactiser avec le pouvoir, qu’il soit local, politique ou économique, ou en glissant vers une dépendance intellectuelle, idéologique et matérielle envers l’Occident, source de reconnaissance, de promotion et de privilèges. Ces derniers finissent par considérer leur culture, leur société à travers le prisme orientaliste si bien décrit par Edward Saïd.
Cela évoque pour moi le Faust de Goethe. Le docteur Faustus va pactiser avec le diable, en lui offrant son âme en échange des plaisirs du monde que lui apportera Méphistophélès. Certains artistes et intellectuels arabes cèdent à cette tentation faustienne, évidemment tous les privilèges du monde ne valent plus grand-chose quand on a perdu son âme ! Reste à nous, critiques, qui lisons l’histoire culturelle d’une société de détecter les éléments progressistes dans cette création même si son auteur s’est laissé amadouer, même s’il a vendu son âme.
Ce constat est fort dans le monde arabe, il est même quasi systématique.
En Tunisie, la politique culturelle de l’Etat, est intéressante. Le ministère de la Culture participe en finançant, produisant, coproduisant des films, des pièces de théâtre, et organisant des festivals internationaux. Du temps de Ben Ali, le système a réussi à amadouer certains artistes et intellectuels. Mais pas tous, nous avons pas mal d’exemples d’artistes courageux qui ont su préserver leur âme, et affirmer leur indépendance dans les limites du possible. Ainsi des œuvres critiques et progressistes se sont faufilées à travers les failles du système oppressif qui avait besoin de jouer la carte de l’ouverture.
Selon vous quels seraient les outils utilisés pour domestiquer l’intellectuel ?
Il y a la terreur et la récupération. L’Histoire arabe est pleine d’exemples de cette politique dite «al targhuib wal tarhib» . La terreur, à mon sens, est la moins efficace des méthodes, car elle est visible et identifiable. On peut se révolter contre, se rebeller et se mobiliser (les militants et les artistes assassinés sont des symboles forts, immortels, et mobilisateurs). La politique de récupération est plus pernicieuse et la plus efficace. C’est toujours un désastre de voir apprivoiser les intellectuels, de leur offrir des postes et des privilèges en échange de leur silence ou de leur propagande douteuse. La culture arabe pâtit de ce phénomène. C’est terrible de se trouver face à un artiste qui se dit avant-gardiste et qui fait semblant d’ignorer les ficelles qui font bouger sa marionnette.
Notre talon d’Achille aujourd’hui réside dans cette frange d’intellectuels et artistes de l’avant-garde arabe qui s’excusent du fait d’être arabe, répètent dans leurs faits et gestes à «l’homme blanc» : «Nous sommes des arabes bien, nous ne sommes pas mauvais comme tous les autres»
Quels en sont les risques et les dérapages ?
Aujourd’hui, nous visons trois grandes menaces : la première nous la traînons depuis les indépendances : c’est la menace du folklore. Cette manière d’aplatir la culture en la sortant de son rôle et l’éloignant de la conscience d’une société ou d’un peuple. La seconde menace est l’oppression qui fait qu’un pouvoir montre son visage répressif et empêche toute sortie du rang usant même de la violence et du meurtre.
La troisième menace, et nous en avons fait l’expérience au Liban, c’est les ONG et les fonds internationaux. Quand l’Etat n’est plus concerné par la culture et que le privé n’a pas cette conscience d’investir dans la culture pour la soutenir, le paysage s’ouvre aux ONG qui arrivent avec des financements et imposent des cahiers des charges selon des thèmes particuliers : «Faites un projet sur les droits des homosexuels, faites un film sur la violence à l’encontre des femmes», etc. Certes, ce sont des causes justes et incontestables. Mais ce nouveau mode de production coule l’avant-garde artistique dans un moule stérile et inefficace. C’est un système parasitaire. Les artistes s’embourbent dans ces systèmes artificiels qui ne touchent plus la conscience du public, mais créent des ghettos, des îlots, des poches isolées, et reproduisent le même objet standardisé, au niveau du style et du discours. Ces produits honorent les cahiers des charges des donateurs, sponsors et autres partenaires. Ce que telle fondation ou tel autre centre culturel ou fonds de soutien, (bref ce que le commanditaire attend d’eux). Du coup, nous ne parlons plus de femmes battues parce que nous sommes contre la violence ou que nous défendons les droits de la femmes et l’égalité des sexes, et que nous nous battons pour faire progresser les lois et les mentalités… mais parce que cela plait à l’homme blanc, qui donne les bons points, qui finance, produit, soutient, programme dans les festivals, fait tourner, paterne, invite en résidence, etc. Ça ne veut pas du tout dire que les coopérations, les coproductions, et les échanges avec les pays de l’autre rive sont nuisibles en eux-mêmes, mais de là à en faire le seul moyen de faire de la culture dans nos pays…
Donc, nos combats, qui sont les mêmes depuis Taher Haddad, Quassem Amine et tant d’autres, sont repris et récupérés par un système artificiel qui va faire entrer les intellectuels dans le moule. Ces derniers deviendront, a fortiori, inefficaces, ils vont devenir apprivoisés et du coup ils ne vont menacer aucun système. Bien au contraire, ils seront gavés, ils auront toujours besoin d’écrire de nouveaux dossiers correspondant aux appels à projets, pour toucher encore plus de «dollars» ou «d’euros» et finir par faire des productions que seuls quelques centaines de personnes vont consommer, et puis plus rien. Une prospérité toute relative, artificielle et provisoire, sans aucun encrage, ni aucune continuité.
Outre cet aspect intéressé cela ne viendra- t-il pas d’un souci ou d’un désir de plaire à l’autre ?
Le rapport de l’avant-garde arabe à l’Occident est trop complexe et truffé de pièges. Il est évident que les références de beaucoup d’artistes sont occidentales et il y a aucun mal à cela. Rien ne nous empêche d’être citoyens du monde ou puiser dans l’héritage de l’Occident, voire se le réapproprier (pour Kateb Yassine, la langue française dans laquelle il s’est vu contraint d’écrire était un «butin de guerre»). Par ailleurs personne ne peut renier à l’artiste sa mission d’échange avec l’autre, son aspiration et son droit à l’universalité. Mais il faut avant tout s’ancrer dans sa propre réalité, trouver sa place dans son terroir, s’enraciner dans le cœur de ses gens. C’est ça la seule légitimité, et non pas la reconnaissance, quelquefois intéressée, de l’Homme blanc. C’est en Egypte que Youssef Chahine a réussi des chefs-d’œuvre tels Gare Centrale, la Terre et le Moineau, et ce n’est que bien plus tard qu’il a été reconnu en France et ailleurs. D’ailleurs, ses derniers films sont moins forts, car ce n’était plus pour son public qu’il tournait…
Ce rapport à l’Occident repose sur notre façon de défendre notre vision de la réalité, sans complexes d’infériorité. Mais ce n’est pas toujours évident, bien au contraire. Cela peut venir, entre autres, du fait que l’artiste ou l’intellectuel n’a pas la reconnaissance qu’il souhaite dans sa propre société ; cette même société qui peut être patriarcale, despotique, axée sur le pouvoir archaïque de la tribu ou des institutions traditionnelles.
Et quand l’artiste a vécu en Occident, quand il est en contact avec la culture occidentale, il vit cette tentation de vouloir montrer patte blanche, de dire «je suis quelqu’un de bien». C’est ce que Yasmina Kadhra a fait dans son roman «l’Attentat» repris au grand écran par Ziad Douiri.
Notre talon d’Achille aujourd’hui réside dans cette frange d’intellectuels et artistes de l’avant-garde arabe qui s’excusent du fait d’être arabe, répètent dans leur faits et gestes à «l’homme blanc» : «Nous sommes des arabes bien nous ne sommes pas mauvais comme tous les autres».
En contre-exemple nous avons Ziad Rahabani qui n’a été produit dans aucune maison de disque occidentale, et ce, malgré son talent, sa notoriété et tout l’amour que lui porte le public dans les pays arabes. J’insiste sur le fait que c’est toujours une bonne chose quand le système occidental nous adopte, traduit nos romans, produit nos films et nos musiques, expose nos artistes et fait tourner nos spectacles. Mais la question qu’il faut toujours se poser, c’est : à quel prix tout cela se fait ?
Les systèmes religieux ou politique dominants n’ont jamais aimé l’artiste, cet être qui «défie le créateur», qui recrée le monde et le refait à sa manière selon sa sensibilité, sa vision, sa philosophie, ses choix et ses partis pris
A votre avis, est-ce dans la rupture que réside notre salut, ne serait-ce pas un appel au chauvinisme ?
Moi je revendique notre droit à une culture authentique et indépendante, ouverte au monde, curieuse de l’autre, sans aucun chauvinisme. Le rapport conflictuel avec la culture officielle en Occident et les politiques occidentales, ce n’est pas moi qui l’invente, il s’agit du rapport de l’opprimé à son oppresseur. Cet oppresseur qui continue à l’être en bafouant nos droits, en exploitant nos peuples. Je ne dis pas que l’Occident c’est le grand Satan, je n’appelle nullement à une quelconque forme d’isolationnisme. C’est tout à fait le contraire. Mais le dialogue avec les cultures des peuples est une chose et la soumission au diktat postcolonial en est une autre. Je m’oppose à ce que le pouvoir dominant façonne ma culture, ma mémoire et ma pensée, en fonction de ses propres intérêts. Il le fait systématiquement en m’inculquant la culture officielle qu’il veut véhiculer et non pas celle que moi je veux prendre. Il faut juste avoir conscience de ce conflit.Je suis conscient que nos sociétés n’offrent pas de ressources, de réseaux de distribution, d’institutions qui protègent l’artiste lui donnant la chance de survivre, de travailler, de vivre de son travail et d’être indépendant. Et que tous les intellectuels arabes ne sont pas opportunistes, mais habités du souci de dialogue et d’ouverture. Mais nous parlons ici de ceux qui, par ignorance, par mauvaise foi, par arrivisme, cèdent au discours de l’Occident parce qu’ils ont besoin de reconnaissance. Ils vont montrer patte blanche en échange d’une légitimité qui leur manque. Et là on pousse la «soif de l’autre» jusqu’à aller légitimer l’occupation israélienne de la Palestine. On oublie les massacres quotidiens, les expropriations et les colonisations, et on va «dialoguer pour la paix» à la façon de Boualem Sensal ! En France, sous l’occupation nazi, on aurait du mal à imaginer René Char dialoguer avec Klaus Barbie !
Certains intellectuels libanais, tels Elias Khoury ou Amin Maalouf, ont malheureusement frôlé le piège de la normalisation avec l’ennemi. Ainsi renie-t-on son passé en échange de privilèges et d’intérêts, et devient-on, sans le vouloir peut-être, un instrument de plus pour prouver la prétendue «démocratie israélienne» et, d’une manière éloquente, innocenter notre bourreau, l’absoudre de ses crimes perpétrés depuis 72 ans.
Il se trouve que l’homme blanc nous a tracé les lignes de démarcation entre le bien et le mal. En croyant refuser l’obscurantisme, une certaine avant-garde s’affiche pro-occidentale parce qu’elle est conditionnée par un discours postcolonial qu’elle reprend à son compte sans critique ni réflexion sur l’essence du conflit entre la victime et son bourreau.
Quel artiste et quelle culture notre société produit-elle ?
Il y a toujours une dialectique qui définit le rapport entre une société et la culture qu’elle engendre. Me concernant, la culture a été un facteur déterminant dans mon parcours et dans mon engagement politique. Ce sont des romans, des recueils de poèmes, des chansons, des œuvres artistiques, des films et des spectacles, qui m’ont extrait du milieu réactionnaire et isolationniste où je me trouvais par la force des choses au début de la guerre civile libanaise.
Tout ça pour dire que la culture influence les individus, tout comme elle reflète leurs aspirations, leurs histoires et leurs réalités. La culture, l’art et la pensée changent les individus, changent les sociétés, cela prend du temps certes, mais l’influence de l’artiste ou du penseur sur un groupe reste indéniable. Le groupe aussi cherche à façonner les artistes, tantôt en leur imposant des codes et des limites, mais surtout en inspirant leurs créations et en motivant leurs engagements pour la liberté, la justice et le bonheur de tous. Le tout est de savoir quelle place occupe l’intellectuel dans le débat public. Bouffon du roi ou conscience du groupe ? Et l’artiste serait-il un simple amuseur ou un agitateur ? Le dramaturge syrien Sadallah Wannous distingue dans son fameux «Manifeste pour un théâtre arabe alternatif» entre, l’art comme moyen de défoulement et l’art comme agent provocateur et arme de prise de conscience. Cela dit, on a bien vu qu’un même artiste pouvait passer d’un bord à l’autre, de la provocation au défoulement, avec l’âge, à cause de l’échec, du besoin, sous la pression, la menace et à cause de la fatigue. Cela dépend de l’endurance de ce dernier, de sa capacité à résister, de ses idéaux, de sa conscience des enjeux et du conflit.