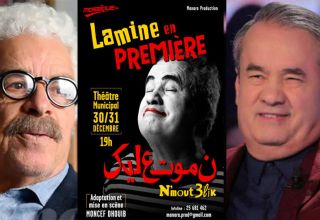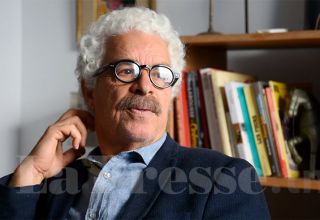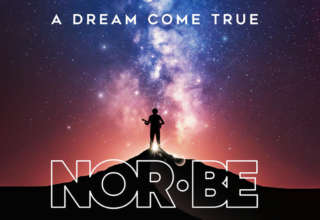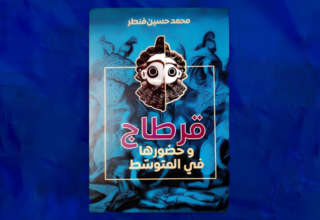Après avoir ouvert le « Cinévog » de 2012 jusqu’en 2019, essentiellement pour les jeunes du quartier du Kram, l’initiative a finalement montré ses limites, mais une autre tout aussi impactante, titrée « 1000 et un films » a vu le jour successivement et a ciblé enfants et collégiens. Mené à bout sous silence sur trois ans, les « Mille et un films » est un projet inédit et d’ampleur à vocation éducative et qui vise à enseigner le 7e art au sein des collèges et écoles du pays. Au fil des années, Moncef Dhouib tend la main à une jeunesse déshéritée et revient sur ces deux expériences d’une vie.
De 2016 jusqu’à fin 2019 et sous silence, un projet très important titré « les mille et un films » a été géré par vous et par une équipe de formateurs en cinéma. Votre cible était les écoliers dans différentes écoles primaires et collèges situés sur tout le territoire tunisien. Aujourd’hui, vous choisissez de le partager avec nous en exclusivité. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les « Mille et un films » a vu le jour en étroite collaboration avec le ministère de l’Education trois ans plus tôt et qui est sans doute un véritable champ de mines de par son apport et sa portée. C’est vrai que j’ai préféré le garder sous silence. J’ai tenu à ce qu’il soit impactant et qu’il aille jusqu’au bout. Je suis quelqu’un qui conceptualise le travail : je ne travaille pas par le hasard des choses. Ayant eu conscience, qu’à un certain âge, on peut perdre à jamais les jeunes, si on ne les rattrape pas avant, qu’on ne les empêche pas de basculer du côté obscur… J’ai donc pensé cibler les moins de 14 ans, qui sont en train de se chercher, et qui n’ont pas conscience des maux de la société et des difficultés de la vie. J’ai donc pensé qu’il faut travailler avec les écoles à l’époque où Neji Jalloul était ministre de l’Education : il a signé directement pour l’application de ce projet qui consiste à enseigner le cinéma aux collèges de 8h à 14h : je devais trouver l’argent et accéder aux écoles. Je me suis adressé à la fondation Rambourg, qui a été réactive, et aussi au CNCI, très partant. Avec ces trois partenaires, on a pu boucler le projet sur trois ans. Le projet a ciblé 300 écoles : 20 élèves de chaque école, 6.000 écoliers touchés au final au bout de trois ans, surtout dans les écoles les plus isolées. Tout s’est fait avec 10 formateurs, choisis sous CV, auxquels j’ai donné une formation pédagogique et qui se sont chargés de transmettre leur savoir. Vers la fin, on a créé un manuel simple « Comment réaliser un film ? ». On a fait en sorte de lancer cet atelier dans chaque école pour que d’autres enseignants prennent la relève après notre départ. On a bien sillonné le pays de bout en bout pour concrétiser les « 1000 et un films». Les passionnés affluaient… et on a pu offrir du matériel à des gamins apprentis qui devaient réaliser à leur tour un scénario, raconter une histoire, traiter d’un sujet et s’inspiraient de leur quotidien pour le faire. Leur apprendre comment créer un scénario, faire un story Bord et le filmer vers la fin. Des exercices cinématographiques consistants et de base. 300 formateurs ont bénéficié de la formation sur trois ans en plus des 6000 élèves. On aurait aimé continuer à élargir le travail mais sans l’aide des ministres qui ont succédé à Neji Jalloul et Hatem Ben Salem, qui étaient les plus coopératifs, le travail ne pouvait aller plus loin.
Pourquoi avoir travaillé avec beaucoup de discrétion ?
Je ne voulais pas créer une hiérarchie dans ce qu’apprennent les enfants : le cinéma n’est pas mieux que les autres savoirs tels que les mathématiques, la philosophie, la science. Je voulais que ça soit aligné avec les autres matières, au même rang. Pourquoi en faire quelque chose d’exceptionnel, que celui d’apprendre le 7e art ? À part la page Facebook, rien n’était montré ou étalé. Résultat après 3 ans : une grande exposition aura lieu après la pandémie afin de présenter les travaux de cette expérience pilote rare dans le monde — oui dans le monde, je peux l’assurer — et ainsi après avoir tout fait, on peut présenter dans les médias tout ce travail aux enfants. D’autres bailleurs pourront voir le résultat final et ainsi élargir l’initiative aux lycées. Cette exposition sera même itinérante dans les institutions éducatives. Je suis très honoré par ce travail effectué. C’est parmi les projets qui m’ont le plus touché et apporté, d’une richesse incommensurable. C’était aussi un projet qui a généré de l’emploi pour des formateurs, payés pour mener à terme la formation. Formateurs et militants y ont cru et ont pu le concrétiser.
Pour finir, on voudrait revenir sur une étape importante, riche mais houleuse dans votre parcours, celle du « Cinévog », une salle de cinéma et de théâtre restaurée qui a ouvert au Kram, essentiellement pour les jeunes de ce quartier de 2012 à 2019. Une manière pour vous de tendre la main à une partie démunie et déchue de la jeunesse actuelle qui n’a pas accès à la culture. Comment cette initiative a vu le jour et qu’est devenu donc ce « Cinévog » ?
Il faut savoir qu’auparavant j’ai toujours rêvé de construire un théâtre indépendant dans lequel je peux travailler avec des amis et des gens du milieu artistique et culturel. 8 ans auparavant, je tombe sur un espace en ruine au Kram, un repaire de camés. Je cherche son propriétaire et on trouve un arrangement pour que je le récupère et que je le restaure à mes frais moyennant un loyer. J’étais enthousiaste. Beaucoup d’amis m’ont aidé pour démarrer. Nous étions en 2012, en pleine euphorie post-révolution. L’emplacement était parfait pour un lieu culturel où la jeunesse est perdue. La culture uniquement comme rempart à une jeunesse qui coule, on y a cru. À l’époque, les allers-retours en Syrie, par exemple, étaient fréquents : la jeunesse déchue était représentée là-bas. On a espéré sauver quelques-uns, leur tendre la main, y remédier, ralentir cette hémorragie de maux… Une mobilisation s’est donc faite, énormément d’activités ont vu le jour, ça bouillonnait dans tous les sens. Mais hélas, l’aspect économique nous a rattrapés et l’endroit ne devenait plus rentable. Le modèle économique guettait la pérennité de l’endroit et il a finalement eu raison de cet espace. Ajoutous à cela un 2e constat tout aussi alarmant : c’est que cette jeunesse-là était déjà perdue et qu’on ne pouvait plus rien y faire, encore moins à travers cette initiative. On était cambriolés tous les trois mois et par moments, j’ai eu l’impression qu’il y avait un effet contraire : tout ce qu’on créait se retournait contre nous. Je ne juge pas ces jeunes gens : C’étaient des jeunes livrés à eux-mêmes, des épaves, des délinquants, des consommateurs de drogues dures, qui étaient déjà perdus, pauvres, qui avaient faim… Il fallait travailler sur des gens plus jeunes, enfants mêmes. Les adolescents étaient irrécupérables : ils devaient bénéficier d’un travail de désintoxication et de réhabilitation. 3e constat : le ministère me demandait de passer des spectacles de mauvaise qualité et on nous a privés de financement, d’une subvention conséquente annuelle. On me proposait de passer des spectacles qui ne sont plus de notre temps, qui n’attiraient pas du tout de spectateurs. Et les donateurs, à un moment, ne pouvaient plus faire grand-chose. C’était un espace voué à l’arrêt et la crise du Corona a tout balayé. Je l’ai rendu à son propriétaire, tel qu’il est et j’ai tenu à ce qu’il en fasse quelque chose, tout en gardant sa vocation culturelle… Et j’espère qu’il le restera puisqu’il est connoté « Culture ». Vivement la fin de cette pandémie qui a terrassé les artistes et l’univers de l’art et de la culture. Je souhaite une bonne résurrection du «Cinévog» et qui sera désormais géré par d’autres mains.