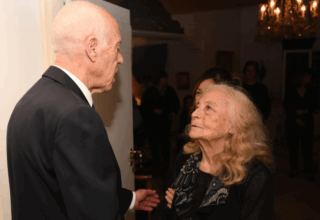Selon les experts, l’année 2010 a marqué un tournant décisif dans le partenariat qui unit la Tunisie et les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le FMI. Changement au niveau de la nature de l’appui accordé, cafouillages dans les processus de pourparlers… Les négociations avec les institutions internationales ont marqué le pas et certaines politiques d’appui ont changé de fusil d’épaule. Alors quel partenariat faut-il privilégier dans un contexte de crise?
La IT Business School vient d’organiser un débat en ligne qui a été modéré par l’économiste Aram Belhadj, et auquel ont pris part des experts et économistes de renommée qui ont abordé diverses questions relatives aux relations de partenariat entre la Tunisie et les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI.
L’intervention de Hédi Larbi, ex-ministre de l’Equipement, a été axée sur l’appui technique et financier accordé par la Banque mondiale, depuis l’indépendance pour soutenir l’économie tunisienne. Selon l’expert, l’année 2010 a marqué un tournant majeur dans le partenariat qui unit la Tunisie et l’institution internationale. Alors que depuis l’Indépendance et jusqu’au milieu des années 2000, l’essentiel de l’appui fourni par la Banque mondiale servait à financer des projets d’infrastructure et de développement, après 2010, tous les financements accordés par la BM allaient exclusivement à l’appui budgétaire. “Depuis 2010, il y a eu un shift structurel très important. Avant 2010, 90% de l’apport de la Banque mondiale, qui était aux alentours de 200 millions de dollars par an, sont utilisés pour financer des projets de développement, il n’a jamais été question de soutien budgétaire”, a insisté Larbi. Il a ajouté que pendant les 40 premières années qui ont marqué les relations entre la Tunisie et la Banque mondiale, en moyenne entre 40 et 50 projets sont mis en œuvre chaque année, et ce, dans des secteurs différents, tels que l’eau, l’éducation, la santé et les projets municipaux. “Depuis 2010, très peu de fonds ont été investis au profit des projets de développement. Tout l’appui accordé consistait en des soutiens budgétaires, pour financer la balance de paiement, les salaires et autres”, a-t-il précisé.
L’appui financier de la Banque mondiale n’a jamais dépassé 1%
Selon l’ex-ministre, ce changement, qui était le choix des autorités tunisiennes, était le fruit d’une politique budgétaire très expansionniste ayant conduit au creusement du déficit budgétaire et de la balance de paiement.
Pour Larbi, ce ne sont pas les fonds débloqués qui sont les plus importants, mais c’est plutôt leur bonne allocation et leur utilisation à bon escient qui font la différence. D’ailleurs, l’apport financier de tous les bailleurs de fonds s’élève uniquement à 1,62% du PIB, alors que celui de la Banque mondiale n’a jamais dépassé 1%. “C’est la manière avec laquelle on va utiliser et gérer ces ressources qui est la plus importante. L’expertise technique et le savoir-faire de ces organisations en matière d’allocation et de gestion de ressources sont très importants. Quand on fait un programme d’ajustement, ce qui importe ce ne sont pas les 500 millions qu’on nous prête, mais ce sont les réformes qui vont l’accompagner”, fait-il remarquer.
Il a, en outre, souligné que l’appui financier ne représente qu’une partie du travail de la Banque mondiale (15%) qui axe son soutien sur l’assistance technique aux pays en matière de formulation de stratégies sectorielles, politiques publiques et réformes structurelles.
Mettant l’accent sur le partenariat historique qui relie le Fonds monétaire international et la Tunisie, Sadok Rouai, ancien conseiller au FMI, a rappelé le rôle joué par l’institution dans la création de la BCT à l’aube de l’indépendance du pays. En effet, en 1956, alors que la Tunisie négociait les termes de son indépendance, Bourguiba a envoyé Cecil Hourani à Washington pour avoir des informations sur les modalités d’adhésion de la Tunisie à la Banque mondiale et au FMI, puisque libérée du joug colonial, la Tunisie a besoin de financements. C’est en cette même année que le conseiller de Bourguiba a également sollicité l’assistance technique du FMI pour la création d’une Banque centrale indépendante. L’expert a, par ailleurs, mis en exergue le rôle décisif que jouent les politiques, financées par les bailleurs de fonds et élaborées et menées par les pays pour favoriser leur progrès et développement à moyen et long termes. L’exemple de l’Arabie saoudite ou encore celui du Luxembourg qui avaient en 1958 des quotes-parts inférieures à celle de la Tunisie, peuvent être, selon l’intervenant, édifiants. Aujourd’hui, les quotes-parts des deux pays sont respectivement 2,5 et 18 fois supérieures à celle de la Tunisie.
Pour Rouai, les cafouillages, qui ont marqué les relations entre la Tunisie et le FMI après 2011, sont dus à l’inadéquation des instruments utilisés par l’institution pour négocier des accords avec les autorités tunisiennes. Selon l’ancien conseiller du FMI, les programmes longs négociés n’étaient pas adaptés au contexte d’instabilité gouvernementale qui a prévalu après la révolution. De plus, l’inertie des gouvernements, qui se sont succédé et qui se sont contentés de refiler la patate chaude des réformes, a également contribué aux péripéties qui ont jalonné les processus des négociations entre le FMI et la Tunisie 2011. Rouai a, également, souligné qu’en cas d’échec des négociations avec le FMI, les autorités tunisiennes doivent disposer d’un plan B pour faire face à la crise.
Fadhel Abdelkefi : “L’accord du FMI
est un passage obligé”
De son côté, Fadhel Abdelkafi a affirmé qu’aujourd’hui la Tunisie ne peut pas se passer de l’appui des institutions internationales, étant donné son énorme déficit commercial qui s’élève à 22 milliards de dinars, les problèmes au niveau de la balance de paiement et la dette astronomique que la Tunisie doit rembourser en 2023. “Très simplement, la Tunisie a aujourd’hui besoin d’un accord avec le FMI pour pouvoir faire face au paiement de sa dette en 2023 qui s’élève à 18 milliards de dinars. Les fonds qui vont être débloqués par le FMI ne vont pas suffire pour payer cette dette, mais cet accord peut donner le feu vert à d’autres financements multilatéraux et bilatéraux parce que ces pays considèrent que la due diligence est faite par le FMI”, a-t-il souligné.
Interrogé sur le recours au BRICS qui est présenté par certains comme une alternative possible aux institutions internationales, Abdelkefi a fait savoir que la Tunisie est très loin de cette perspective puisque cette association rassemble des pays à très forte croissance économique, qui ont des relations géopolitiques qu’ils œuvrent à renforcer. L’ex-ministre des Finances a expliqué que la vraie question qui se pose pour la Tunisie, c’est de savoir si le pays est capable de créer la vraie richesse, sachant qu’il regorge d’énormes potentiels bridés par des réglementations obsolètes, des procédures administratives rébarbatives et des problèmes qui minent chaque secteur. “On peut améliorer les conditions des négociations, certes, mais on ne peut pas laisser tomber un prêteur”, a-t-il insisté.
Le casse-tête de la dette
Évoquant les dérapages budgétaires qui sont à l’origine de l’explosion de la dette tunisienne, Abdelkefi a expliqué qu’avant 2011, la Tunisie était gérée en bon père de famille. L’épargne qui a été d’à peu près 5 milliards de dinars a été épuisée après 2011, dans un recrutement massif dans la fonction publique. “ On a dû faire face, également, à des coups exogènes, tels que le coups du terrorisme qui ont été désastreux pour les finances publiques. On a augmenté substantiellement le budget de l’Etat, espérant faire une relance dite keynésienne, mais qui n’a pas eu lieu, entre-temps les principaux moteurs de la croissance se sont grippés, la productivité de la CPG a été divisée par 10. Si la Tunisie avait pu produire 10 millions de tonnes de phosphate avec le prix mondial actuel, on aurait pu avoir 3 milliards de dollars de rentrées de devises, en une seule année”, a-t-il précisé. Abdelkefi explique le changement qui a eu lieu au niveau de la nature de l’appui accordé par la Banque mondiale, par la politique budgétaire expansionniste qu’a menée la Tunisie depuis 2011 et que quelques économistes ont appelé, selon ses dires, “la politique du Go and Stop”. “Manifestement, ce qui s’est passé, c’est qu’il y a eu une politique de go et que 12 ans après, on n’a pas eu le stop. C’est pour cette raison qu’il y a eu une explosion du déficit budgétaire”, a-t-il insisté.
Évoquant le changement structurel qui s’est opéré en 2011 au niveau des relations de partenariat entre la Tunisie et la Banque mondiale, c’est-à-dire au niveau de la nature de l’appui accordé par l’institution, l’ex-ministre des Finances a fait savoir que le ministère des Finances a aujourd’hui d’autres priorités, en l’occurrence, le paiement des salaires, la compensation et surtout le service de la dette. “Aujourd’hui, n’importe quel ministre des Finances, quel que soit son brio, a des priorités. Tout d’abord, il s’agit de payer les salaires, les compensations et surtout payer le service de la dette qui s’accumule et qui est payé en devises. Et si vous regardez de près les réserves de change, certes elles ne sont pas à un niveau dangereux (90 jours), mais ce qui est clair, c’est qu’il faut regarder de plus près la composition de ces réserves, qui appartiennent substantiellement aux agents économiques. Le cas où il y aurait un retrait de ces devises, le vrai solde serait beaucoup plus inférieur”, a-t-il fait remarquer.