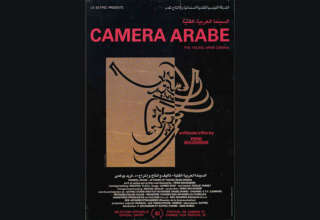Actuellement sur nos écrans, «Joker» de Todd Phillips est une pirouette cinéphilique jetée à la figure des comics américains et une performance de l’acteur de Joaquin Phoenix monstrueusement impressionnante.
«Ma mère me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m’a dit que j’avais une mission dans la vie : mettre du rire et de la joie dans ce monde !». Voici ce que devait être la mission d’Arthur Fleck dans la vie. Il prenait ça au sérieux et il voulait vraiment faire rire le monde ! Mais que s’est-il passé pour que le jeune Arthur Fleck devienne le terrifiant Joker ? C’est ce parcours du côté lumineux de la vie vers son côté obscur que le «Joker» de Todd Phillips raconte. Ce sont les premiers pas du célèbre adversaire de Batman et la genèse du mal mais c’est aussi la genèse d’un super anti-héros, jetée en pleine figure des super héros des «comics», une réflexion sur un cinéma que les Américains ont perdu et que désormais seul Martin Scorsese représente. Filmé, cadré, étalonné dans la droite ligne justement de ce cinéma américain des années 1970 et du début des années 1980, Joker est un manifeste éminemment référentiel.
A travers la descente aux enfers mentale de l’effrayant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), clown professionnel affligé d’un dérèglement neuronal qui déclenche en lui d’incontrôlables explosions de rires, Todd Phillips se sert du personnage pour célébrer la cinéphilie mais à travers le concept des comics books, ce qui est un pari risqué et un grand tour de force.
En deux heures de projection, ce sont, pêle-mêle, Seven, Un justicier dans la ville, Taxi Driver, Un après-midi de chien, Orange mécanique et, bien entendu, La Valse des pantins de Scorsese qui sont convoqués, telle une supplique du réalisateur pour un retour des studios à ces grandes œuvres esthétiques qui n’hésitaient pas à violenter le public. Un blockbuster d’auteur, sommes-nous tentés de dire, sans vouloir pousser l’oxymore à bout et qui a valu au film un lion d’Or à la Mostra de Venise. Un blockbuster plein de noirceur, ce qui n’est pas d’ailleurs dans les habitudes hollywoodiennes.
Son budget non plus n’est pas dans les habitudes de la maison puisqu’on apprend dans le dossier de presse que le budget du film est de 60 millions de dollars, ce qui est un tiers du coût de «The Dark Knight», un sixième de celui d’«Avengers Endgame» !
Voir Joker est aussi découvrir un Joaquin Phoenix monstrueusement impressionnant ! Une performance d’acteur de haute voltige où l’art d’acter atteint son summum et,à notre sens, c’est l’un des rôles les plus marquants de cet acteur après celui de «Her» de Spike Jonze en 2014. L’acteur au mal-être viscéral voyage avec un brio étonnant par les différents états de la folie qui le distingue de ses illustres prédécesseurs qui ont interprété «Joker», de Jack Nicholson à Heath Ledger. Ce genre de rôle dont l’évolution dans le film passe par une sorte d’immense déménagement psychologique nécessite une grande puissance de destruction et de reconstruction interne de la part de l’acteur. Jouer avec toute cette élégance le passage progressif de la raison à la folie est quelque chose de déroutant. Une audace d’interprétation qui n’est pas non plus sans nous rappeler «Taxi driver» de Scorsese où le personnage subit presque également le même passage… Un acteur qui porte le film uniquement sur ses épaules ! En effet, hormis Joaquin Phoenix, présent dans toutes les scènes, aucun autre personnage de Joker n’a droit à un réel développement. Jamais, en face de lui, ne se dressent vraiment d’antagonistes créant une dynamique digne de ce nom. Cela semble un choix d’écriture assumé. Le seul à vraiment tenir tête à l’ouragan Phoenix reste Robert De Niro, présentateur de télé célèbre. Tout au long du film, la lumière est tout entière braquée sur l’homme qui rit de sa sinistre renaissance et qui jubile de son triomphe : «J’ai passé toute ma vie sans même savoir si j’existais réellement, dit sa voix off… Eh bien oui, j’existe et les gens commencent à s’en rendre compte».