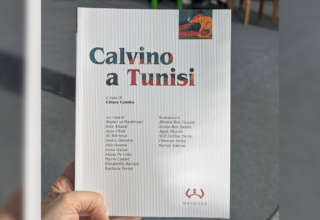«Mythra» de la nouvelliste et romancière tunisienne Zeyneb Boukhris, porteuse de grands espoirs pour la création littéraire tunisienne arabophone, est un roman de très bonne facture qui ne doit nullement sa valeur d’art à sa simple inscription dans ce répertoire fait de bric et de broc que d’aucuns ont appelé, non sans quelque facilité, «Littérature de la révolution tunisienne» et qui a tout l’air d’être un véritable fourre-tout où des écrits de qualité douteuse se confondent lamentablement avec d’importantes productions littéraires.
Mais il doit cette facture lumineuse plutôt à lui-même, en dehors de tout contexte politique ou idéologique, c’est-à-dire précisément aux trois éléments décisifs de sa beauté intrinsèque qui sont la langue, savamment agencée et fluidifiée, la structure narrative, originale et prenante, et, bien sûr, les personnages, tous bien conçus et bâtis. Trois éléments fondateurs qui se conjuguent harmonieusement dans l’acte d’écriture de Zeyneb Boukhris pour mettre en place, à l’orée du champ du réel ou en transcendant le champ du réel, un univers fictif, d’encre et de papier, mais vaguement semblable, par plusieurs de ses aspects, à la réalité socio-historique où il puise certains de ses événements et figures. Un univers original et séduisant que cette autrice crée avec habilité, presque magiquement, et qui, pour nous charmer et faire de nous, lecteurs, ses captifs consentants et heureux, nous jette, dès le titre, un bel appât : « Mythra » ! Qui est-il donc ? C’est un dieu antique de la mythologie indo-iranienne, puis romaine, un guerrier justicier qui mit à mort un taureau en vue de permettre au monde entier de se régénérer grâce à son sang arrosant la terre ! Oui, d’accord, mais que ce dieu vient-il faire à l’entrée de ce roman ?
Voici donc où commencent déjà l’intrigue ou « l’intrigo » (au sens de « calcul », de « combine » de « machination », de « manœuvre ») et le suspense aiguisant notre curiosité et créant en nous cette attente vive à une réponse que l’autrice, bien futée, s’évertue à reporter à plus tard, le plus loin possible, et nous astreint ainsi à la quête du secret de ce titre intrigant et, partant, à la lecture décidément incontournable de ce roman. C’est en quelque sorte l’énigme du Sphinx pharaonique, «soufflée par les Muses » et imposée tel un « droit de passage » et qu’il faudrait pouvoir résoudre et interpréter, parce qu’elle constitue l’une des clefs de l’arrière-fond idéologique sous-tendant l’histoire racontée ici et qu’elle permet de mieux apprécier l’essence des personnages aussi vaillants et dignes, aussi beaux de l’intérieur, que cette troublante Hana Soltani et son fils, fruit de l’amour, Khaled Chamakh, complètement habités, tous les deux, par le mythe de ce dieu libérateur dont ils portent en eux-mêmes, dans leurs idéaux, tant le glaive que la lumière.
Seulement l’autrice, très astucieuse et très habile, bien décidée à mettre à l’épreuve notre attention, préfère complexifier à l’extrême degré sa structure narrative, embrouiller sa progression chronologique, et nous interdire ainsi un accès facile aux significations de ce titre symptomatique ou ce « prince des signifiants », pour utiliser une métaphore de Barthes parlant du nom propre et de sa valeur connotative (« Mythra » est un nom propre).
Et voici, à l’ouverture de l’univers de ce roman, un autre nom propre bien significatif aussi, celui de « Chawqui » (« chawqui » de « chawq » et de « tchwiq » : suspense) désignant ce personnage, très spécial, qui compte dès la « situation initiale » qu’il occupe, nous impatienter, comme son prénom l’indique, nous tenir en haleine et nous séduire à son jeu. Il est en fait le narrateur principal ou, si l’on veut, le narrateur externe ou le narrateur de premier niveau ou encore le narrateur au premier degré. Il est lui-même écrivain publiant des articles hostiles au satané régime du 7 novembre dans un journal de l’opposition dite démocratique. Depuis le « Préambule » (pp. 15-20), il repousse de manière insolite, l’autrice-narratrice et se substitue complètement à elle, non seulement, dans la narration de son histoire, mais même dans la fabrication de cette histoire et dans la mise en scène des personnages qui vont, à leur tour, narrer et commenter les événements, alternativement, et qui vont par là même occuper chacun, séparément, des chapitres entiers ou se croiser et alterner sans accroc dans les mêmes chapitres.
Ainsi donc avons-nous comme première voix narrative ce « Chawqui » récusant son statut de personnage pour endosser volontiers le rôle d’un narrateur extradiégétique qui ne fait donc pas partie de l’action correspondant à l’enchaînement des événements de l’histoire racontée. Une action qu’il élabore par lui-même en s’y infiltrant quelquefois, en tant qu’amoureux de son propre personnage Hana, la sosie fictive de la voisine dont il est mystérieusement épris (chapitres 1, 4, 5 et 6) et en se cachant souvent pour tirer, comme un marionnettiste, les ficelles des personnages auxquels il laisse le plus clair de l’espace narratif qu’il crée à partir des documents écrits et enregistrés sur les cassettes d’un psychanalyste trouvés par hasard dans une poubelle, dans les rues de la Capitale, le lendemain des événements du « 14 janvier » : dans ces notes et enregistrements, il y a les confessions libres de Khaled, un jeune tunisien aux prises avec son passé pénible et son identité trouble, et révolté contre ce régime qui l’avait réprimé comme tout un peuple, poursuivi pour ses idées, emprisonné et torturé sauvagement. Il y a aussi l’évocation d’une mère « étrange » habitant le quartier de « La Fayette » à Tunis et dont le prénom retint très fort ce narrateur principal et lui rappela sa voisine qui l’attirait déjà, sans qu’il ne la connaisse de près. Imaginatif, il décida de créer, dans son œuvre fictive, ce que celle-ci a dû vivre avec son fils, son premier amour, son mari assassiné, Riadh, sa famille et celle de son bien-aimé avant la levée de la chape de plomb du tyrannique régime du « 7 novembre ».
Et c’est donc cette femme baptisée Hana Soltane qui va être mise en scène dès le premier chapitre et qui va narrer, vingt ans après sa fin, son histoire d’amour avec son premier homme, Fadhel Chamekh, le vrai père de son fils Khaled, se trouvant maintenant, suite à un grave accident de la route, dans un profond coma, dans une clinique.
Le narrateur principal s’improvisant l’auteur du roman va donc raconter à sa façon l’histoire de ce couple dont il a appris quelques bribes grâce aux documents du psychanalyste et dont il va imaginer et remplir toutes les cases vides dans ce qui est révélé par ces documents. C’est que la fonction d’un roman, une œuvre d’art —semble dire Zeyneb Boukhris— n’est pas en fait de reproduire telle quelle la réalité, de la copier, mais de la créer, l’enrichir par son imagination, ses idées, ses mythes personnels, ses rêves, ses désirs, ses cicatrices intérieures, bref ; sa subjectivité.
Après l’incipit admirablement réussi qui met en place les premiers éléments du suspense, tout le système narratif de ce roman de Zeyneb Boukhris, ou plutôt de cet auteur par procuration qu’est le narrateur principal, Chawqui, va se construire progressivement, chapitre après chapitre, sur ce coma de Fadhel se poursuivant jusqu’au 19e chapitre. Chapitre où l’on apprend surtout le suicide spectaculaire d’un certain Bouazizi, à Sidi Bouzid, et le début de la chute rapide, toute programmée, toute organisée, peut-être, du régime de Ben Ali.
Suit ensuite dans un véritable désordre chronologique volontaire, mais non sans beaucoup d’aisance, une série complexe de rétrospectives, souvent courtes et vives, bien introduites dans le discours de chacun des 3 personnages du premier plan (Hana, Fadhel et Khaled), bien arrangées, qui s’entrecroisent, nous tiennent constamment sous tension et permettent de raconter des passés divers, proches et lointains, tous convergeant vers le noyau central du récit qui est cette belle histoire d’amour brisée dont est née Khaled, le révolté, victime de ses parents désunis et du régime politique despotique et qui mourut en héros au 20ème chapitre après l’imaginaire irruption, enfin, du dieu guerrier et justicier « Myrtha » (p. 191) et l’éclatement de la « révolution de la liberté et la dignité », après de très nombreuses années de répression, de corruption, d’appauvrissement des masses populaires et d’injustice ( une « révolution » dont le narrateur principal ne tient pas à dire si elle était une vraie révolution ou un coup d’Etat chevauchant une grande colère populaire diaboliquement exploitée et instrumentalisée par des forces obscures. Mystère !).
Et c’est à l’ultime chapitre de ce roman que réapparaît soudain le narrateur principal, Chawqui, qui a fait semblant de se taire et de s’absenter tout au long de plusieurs chapitres et qui vient assumer ici « la situation finale » clôturant l’œuvre qu’il a narrée ou fait narrer, par des personnages, en se substituant à sa vraie autrice volontairement « muette ». Mais il réapparaît pour raconter en même temps « la situation finale » d’un régime politique répressif qui tomba spectaculairement Vendredi 14 janvier 2011 et qui emporta parmi ses martyrs l’un des personnages positifs de ce roman : le jeune et révolté Khaled Chamek tiré comme un lapin par un sniper, à l’avenue Habib Bourguiba, devant l’hôtel portant le prénom de sa propre mère, « Hana » (en arabe « le bonheur, mais c’est plutôt ironique dans ce roman. Une antiphrase).
Voici donc, pour finir, un roman où l’élaboration narrative est tout aussi dynamique que saisissante et belle, où les personnages, très riches de l’intérieur, parviennent aisément à susciter tout notre intérêt et où enfin le processus de littérarisation de la langue arabe, souvent aisée et délicieuse, est porté à un degré supérieur et qui, de concert avec les autres constituants, réussit à nous subjuguer et nous ravir jusqu’au bout. Un roman à lire absolument !