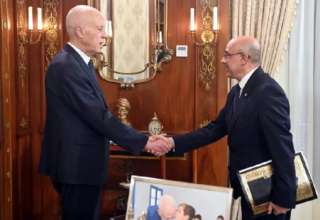Un pied en France, un autre en Tunisie, l’actrice Rabiaâ Ben Abdallah ne manque pas de marquer sa présence dans les films tunisiens. Le dernier en date «Avant qu’il ne soit trop tard», premier long métrage de Majdi Lakhdar dans lequel elle interprète le rôle d’une mère fatiguée soumise aux pressions de son mari dans un huis clos étouffant mais combien excitant pour cette grande actrice dont les rôles sont rares mais puissants.
 «Avant qu’il ne soit trop tard» marque votre retour sur les écrans tunisiens après quelques années d’absence. Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour ce film?
«Avant qu’il ne soit trop tard» marque votre retour sur les écrans tunisiens après quelques années d’absence. Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour ce film?
Cette absence des écrans tunisiens est à la fois volontaire et involontaire. Volontaire, car je suis sélective. J’ai la chance de pouvoir choisir parmi les films ou les rôles qu’on me propose. Une absence involontaire vu que le cinéma tunisien boude les personnages des femmes de mon âge, des femmes mûres. Je suis aussi une actrice créatrice. J’aime les rôles de composition, les personnages que je dois créer de toutes pièces. Des personnages sur lesquels je dois réfléchir et les composer par petits bouts afin de les rendre plausibles, crédibles et donc humains. Depuis la Révolution du 14 janvier, la rareté de ces personnages féminins est encore plus flagrante.
Quant aux raisons qui ont motivé mon choix pour ce film, elles sont d’ordre pratique et artistique. En effet, le timing du tournage correspondait à ma disponibilité. Il a eu lieu pendant l’été, ce qui m’arrangeait, vu mes activités professionnelles.
Aussi, à la lecture du scénario, j’ai tout de suite adhéré à l’histoire. Le récit sort des sentiers battus (du moins en ce qui concerne le cinéma tunisien). C’est nouveau. Et j’aime la nouveauté. Le nombre réduit de personnages m’a tout de suite accroché. Le huis clos, que j’apprécie énormément, a beaucoup joué dans mon choix d’actrice. Les dialogues sont minimalistes. La priorité va vers le jeu, la force de l’interprétation. Travailler sur l’urgence, le suspense est un défi qu’il fallait relever.
Vous êtes une actrice professionnelle confirmée et reconnue, pourquoi avoir pris le risque de travailler avec un réalisateur novice ?
Peut-on appeler ça un risque ? Peut-être ! Je ne sais pas. Une chose est sûre, c’est que les différentes générations d’artistes ne peuvent et ne doivent pas être en rupture. Nous sommes obligés(e)s de travailler ensemble. Car la Tunisie post-révolutionnaire ne peut pas s’arrêter en 2011, pour nier, gommer et effacer son passé. C’est dans la continuité, la transmission que les générations peuvent survivre et vivre en harmonie. Un risque de travailler avec un réalisateur novice ? Pourquoi pas ? Si nos soucis, nos mondes, nos perceptions, nos imaginaires coïncident. Je pense aussi qu’il y a un défi à relever. Et ce, des deux côtés : du côté de l’artiste interprète et du côté du réalisateur. De mon côté, prendre ce risque, c’est surtout ne pas travailler dans le confort. Un confort et une garantie (supposée) être fournis par un réalisateur confirmé. Je ne connaissais pas le réalisateur. Mais les longues répétitions nécessaires m’ont permis de découvrir que le propos était maîtrisé, que Majdi était passionné et a su transmettre cette passion et ce regard tendre qu’il a envers ses personnages. Majdi est novice? Certes, mais il est novateur et c’est le plus important.
Quelles ont été les principales difficultés du film et notamment de votre rôle ?
Pour toute l’équipe, le tournage était une épreuve difficile et éprouvante. Malgré la fatigue, le manque de sommeil, l’exiguïté de l’espace, il fallait aller au bout de nos moyens. Ce qui était excitant.
Tourner la nuit, pendant douze heures, voire plus, a été très difficile. Allez trouver le sommeil à 9, ou 10 heures du matin, vous m’en direz des nouvelles. La chaleur était accablante. Car on tournait dans un espace réduit. Le sous-sol, qui est le décor du film, ne disposait pas de fenêtres. Mise à part celle de la cuisine qui avait un rôle important dans l’action et dans le déroulement dramatique des événements. L’espace réduit nécessitait aussi des déplacements au centimètre près. Ajoutez à cela la caméra subjective qui a ses exigences et ses lois. Ce sont des difficultés que toute l’équipe technique et artistique a partagées.
Je pense que la principale difficulté à laquelle j’ai été confrontée réside dans la psychologie du personnage de Baya. Et surtout, dans la gestion de sa maladie chronique : l’asthme. Sa maladie, son énervement, sa colère contre son mari Ali font d’elle une femme démunie, toujours sur le qui-vive, ne lâchant rien. Sa situation de mère au foyer habitant une maison complètement délabrée a causé sa maladie chronique. Ce qui l’a rendue aigrie, acariâtre, de mauvaise humeur. En fait, c’est une femme épuisée. Question jeu, il a fallu que je gère les crises d’asthme physiquement, organiquement. C’est-à-dire trouver le moyen de régler ma respiration de saccadée jusqu’à une respiration sifflante. C’est plutôt éprouvant.
S’agissant d’un huis clos, ce sont les acteurs qui portent le film. Y a-t-il eu des concertations entre vous au niveau de la démarche et du rythme à adopter ?
Plus de trois semaines ont été nécessaires pour travailler sur le texte, les personnages, les relations entre eux, les enjeux des uns et des autres, les objectifs de chacun d’entre eux. Un travail méticuleux a été fourni avant le tournage pour nous permettre, justement d’être en parfaite maîtrise de nos personnages et des liens, des sentiments, positifs ou négatifs qui animent chacun d’entre nous. Qu’est-ce qui motive les quatre membres de la famille ? C’est énorme comme préparation avant le tournage. Il fallait créer cette famille de quatre personnes pour la questionner, décortiquer ses actions, ses paroles, les analyser et enfin accorder à cette famille une légitimité pour exister. Afin qu’elle soit crédible, justement.
Pourquoi Baya, la mère, ne s’est-elle pas rebellée contre la décision du père qui a mené la famille à la catastrophe ?
Malgré la réputation dont jouit la Tunisie d’être un pays de libertés pour les femmes, il n’en demeure pas moins que la société tunisienne est une société masculine, patriarcale. L’autorité du père dans une famille tunisienne, on n’y touche pas. Et ce, quelle que soit l’origine sociale de la famille tunisienne. Face à un chef de famille, Ali, quasiment absent, démissionnaire, incapable de retenir la date de la soutenance de sa fille, Baya se voit obligée de gérer tout : le quotidien de la famille ainsi que les grands événements (soutenance de sa fille). Baya est responsable de sa famille face à un mari et un père irresponsable. Elle représente un nombre important de femmes tunisiennes qui, une fois mariées, devenues mères, s’oublient. Elles ne sont là que pour satisfaire les besoins, et du mari et des enfants et surtout pour répondre au diktat de cette société patriarcale qui est permissive et tolérante envers l’homme et qui demeure extrêmement sévère envers la femme. Qu’aurait-elle pu faire ? Elle s’est révoltée. Mais à sa manière. C’est tous les jours qu’elle reproche à son mari de les laisser habiter dans un logement vétuste. Est-ce qu’il l’entend pour autant ? Pas du tout. Il vit complètement sur une autre planète, celle du «trésor». Et même quand la première partie du toit tombe, Baya menace de sortir, mais elle ne le fait pas. Elle n’a pas le courage nécessaire pour faire ce pas. Parce que ça ne se fait pas. Elle a peur du «qu’en dira-t-on ?». Et elle est devenue aigrie, acariâtre, de mauvaise humeur et avec un visage sévère.
Baya ne se rebelle pas/plus à cause de ses enfants. Encore une fois, son sens de la responsabilité envers ses enfants prend le dessus. Baya souffre aussi d’un manque d’autonomie financière. Elle ne travaille pas. Elle dépend du peu que gagne son mari. Et elle sollicite de plus en plus son fils Seif, qui l’aide à l’occasion, financièrement. Même si elle travaillait, je suis persuadée qu’elle n’aurait pas pu faire grand-chose face à l’autorité (supposée) du mari. Et tous ses sacrifices, Baya les paie aussi de sa personne. C’est une femme malade complètement affaiblie par son asthme.
Si vous devez définir Baya, quel genre de femme est-elle ?
Baya est une «bint familia», ce qui est un statut flatteur qu’on attribue aux femmes comme Baya afin de les confiner dans leur statut d’infériorité. Dans un statut de dépendance «morale» vis-à-vis de l’homme.
Le choix de la caméra subjective a-t-il servi ou desservi le film ?
La technique de la caméra subjective booste l’acteur. Il se sent responsable face à un challenge de taille. Celui d’être expressif, celui de convaincre, celui de rester tout le temps animé par une charge dramatique infaillible. Par les expressions du visage, l’interprétation dramatique allant crescendo, la caméra subjective transmet au spectateur les sentiments éprouvés par l’acteur. Le spectateur n’est plus là pour «consommer» des images galvaudées, habituelles, mais il est surpris, parce qu’il est «provoqué» dans ses sentiments, dans ses sens ; Il devient lui-même acteur/actant/ il agit et il ressent la peur, l’angoisse, la colère, etc. Le spectateur est dérangé dans son confort de «consommateur» d’images.
C’est la première fois dans le cinéma tunisien que la caméra subjective a été largement utilisée. Je pense que c’est innovant et que le cinéma et l’art en général se doivent de proposer de nouvelles formes d’expression, de nouvelles techniques. C’est par l’expérimentation que les choses évoluent, que le monde évolue.