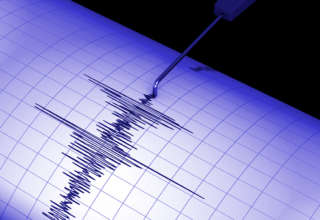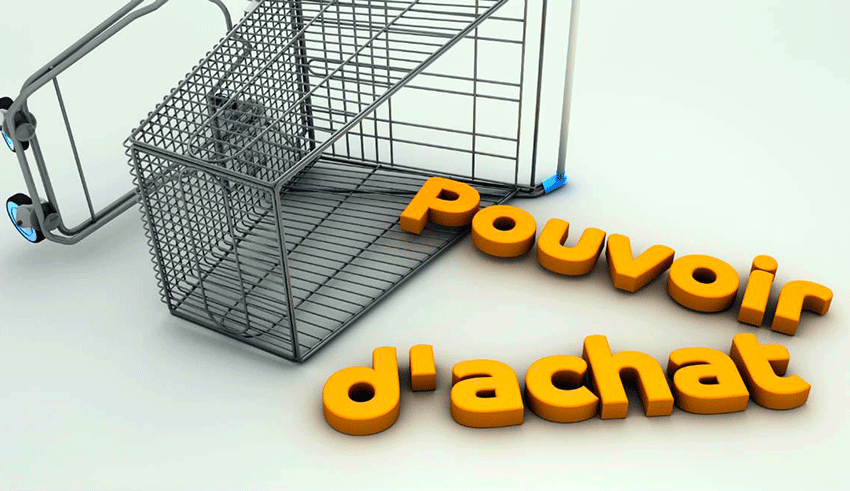Par Soumaya MESTIRI *
Une meilleure redistribution des richesses issues des régions marginalisées tout autant que l’investissement dans une infrastructure enfin digne de ce nom et de ces territoires nourriciers, tel était l’espoir de millions de Tunisiens, relégués par soixante ans de dictature au rang de sous-citoyens et de petits sauvageons polissables à souhait. Dix ans après- pourtant, l’amertume est grande chez toutes celles et ceux qui espéraient voir la fin des privilèges régionaux hérités de la colonisation et perpétués par les élites postcoloniales. Il y aurait sans nul doute beaucoup à dire à ce sujet, ne serait-ce qu’en faisant la liste de toutes les promesses non tenues par les gouvernements qui se sont succédé depuis dix ans. Une question me paraît toutefois chapeauter toutes les autres, une question méta qui informe : celle de savoir pour quelle raison nous en sommes toujours là après une décennie de transition démocratique. Cette question, c’est celle qui interroge le rapport des uns et des autres à ce déni de justice si particulier : pourquoi les revendications de ces femmes et de ces hommes sont perçues par la majorité (observateurs « ordinaires » tout autant que politiciens) comme des caprices d’enfants dont on reconnaît par ailleurs ponctuellement qu’ils n’ont rien de gâtés ? La réponse, telle que je la vois, est en soi relativement simple : si nous en sommes toujours au même point en ce début 2021, c’est en raison d’un profond malentendu sur ce qui se joue dans cette lutte pour la reconnaissance de l’injustice régionale. Plus particulièrement, se donne à voir, selon moi, une extraordinaire confusion autour de ce que l’on nomme traditionnellement « égalité des chances ». Pour le dire vite, cette dernière est perçue, par nos gouvernants entre autres, comme « liberté de » alors que l’équité exige de la considérer fondamentalement comme « liberté à ». De ce « malentendu » fondamental dérive tout le reste, comme j’aimerais à présent le montrer. Que signifie percevoir l’égalité des chances comme « liberté de » ? Par « liberté de », il est question d’absence d’entraves à la réalisation des fins personnelles. Je suis libre quand je ne suis pas empêché par des obstacles Y de réaliser mon objectif Z. Telle est la définition de la liberté négative (appelée ainsi en raison de la grammaire : « être libre, c’est ne pas être entravé »), proprement libérale, héritée de Hobbes. L’obstacle est ici proprement extérieur à l’individu ; si ce qui m’entrave « vient de moi », est coextensif à ma propre personne, il ne peut être qualifié d’obstacle au sens strict du terme. Hobbes donne l’exemple de la maladie, exemple que nous pourrions élargir à la condition socio-économique ou à n’importe quelle autre catégorie (le sexe, l’ethnicité, etc.) et explique que ce sont là des entraves internes : elles n’ont aucune incidence sur ma liberté, n’impactant que mon « pouvoir », selon ses dires. La « liberté à », elle, s’intéresse aussi aux obstacles internes récusés par Hobbes parce que ce qui fait la différence entre les individus ne sont pas les entraves extérieures, mais très exactement ce que le philosophe anglais nomme « pouvoir » et que nous appelons, à la suite d’Amartya Sen par exemple, « capacité » (ou « capabilité »). Etre libre, c’est avoir les moyens de s’accomplir. La liberté, en somme, à être ceci plutôt que cela, et non pas simplement le fait de « ne pas être entravé », quels que soient l’importance de ces entraves et leur caractère inhibant.
Or, depuis dix ans maintenant, les responsables de ce pays persistent à défendre l’idée qu’être libre, c’est ne pas être entravé. C’est pourquoi ils ont beaucoup de mal à prendre au sérieux les revendications d’El Kamour par exemple. Ils n’y voient qu’un caprice, une volonté puérile de persister dans la confrontation parce que leur grille d’analyse est typiquement libérale : les protestataires n’expriment pas leur volonté d’être libres, non, ils ne font qu’entraver la liberté des autres. Fermer la vanne de pétrole n’est problématique que parce que c’est là, fondamentalement, saboter la bonne marche du pays, la paix sociale et la stabilité institutionnelle, en un mot comme en cent : ne pas être patriote.
Ce type de raisonnement est emblématique de ce qu’on a pu appeler, dès 1965 avec les travaux du sociologue mexicain Pablo Gonzalez Casanova, le « colonialisme interne ». Ancêtre spécifique de la « colonialité du pouvoir » systématisée trente-cinq ans plus tard par son confrère péruvien Anibal Quijano, le colonialisme interne, il faut le dire, n’est pas une thématique étrangère à nos chercheurs : l’ingénieur Sghaier Salhi est l’un des premiers à en avoir traité directement, conjuguant les travaux pionniers de l’historien Mohamed Hédi Chérif et du géographe Amor Belhedi, deux autorités académiques dans leurs spécialités respectives. Dresser une typologie des revendications policées, définir les contours du champ de la contestation en distinguant ce qui se fait de ce qui ne se fait pas, ne pas reconnaître la responsabilité de l’Etat postcolonial dans la perpétuation des structures coloniales aussi bien économiques que symboliques, ne pas voir dans la radicalité contestataire à l’œuvre la volonté d’en finir avec une conception indigente de la liberté qui refuse de prendre au sérieux l’idéal de maîtrise de soi et d’autonomie (c’est là le sens de la liberté dite « positive », par opposition à la liberté négative libérale, j’y reviendrai), tout ceci revient à évoluer dans le paradigme du colonialisme interne.
Or précisément, penser l’entrave objective — la fermeture de la vanne — comme acte « encapacitant », c’est en dernière instance dire que ce fait votre liberté (négative) me prive de la mienne (positive). Or de quel droit votre liberté serait-elle plus importante que la mienne ? Affirmer cela, comprenons-le une fois pour toutes, n’a strictement rien de puéril. C’est la manifestation d’une exigence fondamentale, celle qui consiste à reconsidérer les règles du jeu : si nos positionnements se valent, alors la surenchère n’a plus lieu d’être : il n’y a pas de sauvageons égoïstes, d’un côté, et des gouvernants responsables, de l’autre, mais des subjectivités à l’œuvre cherchant, soit, dans le premier cas, à faire reconnaître l’injustice dont elles sont victimes, soit, dans le second, à sauver leurs propres privilèges.
Sortir du colonialisme interne, c’est donc, d’abord, dénoncer le fait que les élites politiques fassent porter aux citoyens la responsabilité de leur propre positionnement subjectif maquillé en patriotisme alors qu’il s’agit ni plus ni moins de l’investissement de stratégies politiques de pérennisation. Pour reprendre la description machiavélienne du politique au sein de la République romaine, nous sommes en présence de deux humeurs distinctes qui s’affrontent : l’humeur des Grands, qui cherchent à dominer le Peuple et l’humeur du Peuple, qui cherche simplement à ne pas être dominé.
C’est, ensuite, repenser la négociation sur cette base anthropologico-politique authentiquement horizontale : des intérêts de part et d’autre qui cherchent à être satisfaits, ni plus ni moins, loin de la rhétorique juridique libérale du rationnel, du raisonnable et du devoir c’est-à-dire, dans le fond, de la culpabilisation. Encore une fois, il n’y a ni « bons », ni « mauvais », mais des passions opposées à l’œuvre. Reconnaissons l’existence de ce conflit essentiel, premier et primaire et travaillons sur cette base.
C’est, enfin, reconnaître que la liberté « à », négative, est une imposture car elle disqualifie la liberté de choisir et donc d’être maître de soi – alors que le libéralisme, étrange ironie du sort, n’a eu de cesse de se faire le chantre de l’autonomie depuis Kant. En effet, lorsque vous disqualifiez les obstacles internes, ceux qui sont propres à la personne et donc lorsque vous refusez toute analyse de type intersectionnel (car vous serez nécessairement amenés à convoquer des catégories dont vous jugez qu’elles n’ont rien à voir avec la liberté mais concernent simplement le pouvoir comme capacité), vous posez en réalité que tous les choix de vie se valent, celui que l’on fait parce qu’on est convaincu de sa pertinence face à d’autres opportunités qui s’offrent à nous, comme celui que l’on fait contraint et forcé, parce que, précisément, nous n’avons pas le choix. Le caractère particulièrement pernicieux de la « liberté à » se lit dans la volonté de pérenniser le système tout en donnant l’impression du contraire. Car supprimer la possibilité de choisir entre différents projets de voie passe aussi par l’institutionnalisation de mesures et de procédures qui ne visent pas tant l’ « encapacitation » des citoyens les plus démunis que la survie de la machine qui les opprime. Pour donner un exemple concret, la discrimination positive amende l’égalitarisme libéral classique en permettant à des groupes de populations marginalisées d’avoir accès à des parcours universitaires/emplois dont ils auraient été exclus en temps normal. Mais ce faisant, la discrimination positive empêche aussi que l’on prenne le problème de l’inégalité des chances au sérieux, c’est-à-dire en amont, fonctionnant ainsi, tout à la fois, comme une simple soupape, voire comme un alibi. Comme une soupape, car elle permet au système, foncièrement inégalitaire, de ne pas exploser : ce faisant, elle ne fait que retarder l’inéluctable échéance ; comme un alibi, car elle donne l’impression que ledit système œuvre à s’amender, alors qu’il instrumentalise la cause, la gérant à peu de frais. Pour reprendre ce que nous disions plus haut, la « liberté de » est elle-même une entrave à la liberté d’être ceci ou cela. Et elle ne peut qu’être une entrave, car elle refuse de considérer que les citoyens ne sont pas en mesure de transformer un bien (par exemple, une aide sociale) ou un droit formel (comme le droit à l’éducation supérieure) en productions ou réalisations effectives et efficientes (comme «avoir un emploi non précaire » ou « être doté d’une qualification reconnue »). Une égalité des chances qui raisonne autant qu’elle résonne en termes de biens, de ressources et de droits formels n’est pas une égalité des chances car elle ne prend pas au sérieux les opportunités réelles des individus. Nous aurons probablement gagné le combat contre l’injustice régionale lorsque nos décideurs auront non pas compris, mais reconnu tout cela. Lorsqu’ils se seront débarrassés du Léviathan postcolonial et de sa matrice de colonialisme interne. Lorsqu’ils s’efforceront à saisir le lien entre le type de domination locale que nous décrivions et le sous-développement à l’oeuvre. Plus spécifiquement, lorsqu’ils auront reconnu la nature et les manifestations du sous-développement d’une nation jeune dont les gouvernants successifs n’ont eu de cesse d’institutionnaliser d’une manière extrêmement pernicieuse l’interdépendance d’un secteur capitaliste moderne et d’un secteur d’économie de subsistance arriéré tout en faisant croire à la prodigalité d’un Etat providence prenant en charge les pauvres hères. Lorsqu’ils auront admis que nous n’avons eu qu’une pseudo-révolution agraire ; la liquidation des Habous d’abord, la décolonisation agraire, ensuite et l’expérience des coopératives, enfin, sont autant d’incarnations d’une réforme agraire étatique qui n’a fait que renforcer la tutelle de l’Etat postcolonial naissant, réussissant la gageure de perdurer en (ne) changeant (que) les dénominations. C’est le cas, par exemple, avec les terres domaniales devenues domaine privé de l’Etat et susceptibles en tant que telles d’être cédées sous forme de concessions aux personnes proches du pouvoir jusqu’en 2011 (le rapport de la Commission nationale d’investigation sur la corruption et les malversations est à ce titre édifiant). Et lorsqu’à partir de 1995, ces terres sont pour partie cédées à de jeunes agriculteurs, ceux-ci, en grande majorité, se retrouvent incapables d’exploiter leurs parcelles en faire-valoir direct en raison de l’absence d’accompagnement étatique. Nous retrouvons dans ce dernier cas, soit dit en passant, une manifestation de la discrimination positive-alibi ; l’Etat se contente de jeter des miettes en amont sans planification stratégique : n’est-ce pas là la définition même de la charité ? Ironie du sort, après la Révolution, une grande partie des terres domaniales confisquées servent à s’attirer les bonnes grâces de pays amis : l’Etat les loue sans états d’âme à des investisseurs étrangers, faisant fi de la portée symbolique d’une telle politique. On l’aura compris, et pour le dire lapidairement, le salut ne peut venir que d’un changement total de paradigme. En tout état de cause, plus de cinquante ans après, les mots du sociologue mexicain Rodolfo Stavenhagen, spécialiste de la question agraire, résonnent familièrement à nos oreilles de Tunisiens :
« L’expérience récente de l’évolution des pays sous-développés nous montre que de vrais progrès économiques ne peuvent être réalisés que lorsque des modifications profondes des structures sociales, voire des révolutions sociales, ont lieu. Cela signifie que la croissance ne dépend pas seulement du montant des investissements mais de leur nature ; qu’elle ne dépend pas seulement d’un certain taux de développement mais du sens qu’il prend ; pas seulement de la quantité de capitaux disponibles mais de la manière dont l’État s’en sert ; pas seulement d’une aide étrangère mais d’une modification totale des rapports avec l’étranger ; pas seulement d’une intervention éventuelle de l’État dans la vie économique mais de la prise en main par l’État de l’économie dans ses aspects principaux, etc. Le développement économique, on le reconnaît de plus en plus, n’est pas un problème technique mais surtout politique. Le problème qui se pose donc est celui de la nature même de l’État, et des rapports de celui-ci avec les classes principales de la société » (Les classes sociales dans les sociétés agraires. Paris, Éditions Anthropos, 1969, p. 18).
En d’autres termes, pour changer le plomb en or et pouvoir mettre en vitrine des Success Stories à la sauce discrimination positive mâtinée de satisfecit méritocratique, il faut déjà avoir le plomb. Ou le phosphate, c’est selon.
(*) Professeure de philosophie politique et sociale à l’Université de Tunis