
Voici le récit passionnant d’un retour au pays natal que nous donne à lire la photographe et romancière tunisienne établie en Grande-Bretagne, Dora Latiri, et qu’on prend un vif plaisir à lire et dans lequel on se délecte à quêter les précieuses significations de ces multiples photographies en noir et blanc, serties, comme des diamants rares, dans son discours textuel, narratif et, si l’on veut, autobigraphique (d’aucuns me rétorqueraient que lorsqu’il est question de création artistique, littéraire, l’autobiographie serait un mythe et qu’il s’agirait plutôt d’une autofiction !).
«Un amour de tn». C’est ainsi que ce «Carnet photographique» s’intitule et qu’il nous convie à accompagner son autrice —dont la très signifiante photo-portrait quelque peu brouillée, comme si elle sortait des nuages du temps, trône sur la première de couverture— dans un singulier voyage mémoriel, sensoriel, émotionnel et vaguement poétique ou même onirique, à travers la Tunisie post-«révolution» à laquelle rentre enfin, après de longues années d’absence, épuisée par l’exil et les pérégrinations, «cachant ses blessures sous ses vêtements», animée par une insurmontable nostalgie, impatiente et rêveuse, confiante, «l’enfant prodige» qui, dans son âme et son cœur, au plus profond et au plus intime d’elle-même, n’avait jamais vraiment largué les amarres ni coupé définitivement les ponts avec sa terre, avec son identité, avec l’image tutélaire, omniprésente, du père, et avec cet imprenable bleu du ciel et de la mer. Irremplaçable bleu, indélébile, qui avait continué à envelopper tendrement sa mémoire et qu’elle rentre, maintenant que de nombreux verrous viennent de sauter, —ou c’est de moins ce qu’elle croit !— pour retrouver avec les traces vives, savoureuses, d’un passé cher qui lui est chevillé au corps et où il y avait une demeure familiale, à La Goulette ou à La Marsa, des sœurs heureuses, une vieille machine à coudre Singer, des draps bleus cousus par la mère et la grande tante, des éclats de rire, des «éclats de vie». Il y avait aussi des poupées jumelles rapportées d’un voyage par un papa aimant, tout auréolé de réussite sociale et de prestige, une fierté nationale, mais qui devenait soudain intraitable quand il s’agissait des «valeurs» matrimoniales de la société traditionnelle conservatrice, lui, le savant, le voyageur et le photographe à ses heures qui aimait toujours photographier la mère aimée et tapisser les murs de la maison chaleureuse avec ses photos. Lui «qui donne la vie (mais) qui la suspend parfois» (p. 50). Il y avait enfin des amours splendides, les zébrures du fouet d’un homme contrarié sur les jambes d’une jeune fille éprise d’un étranger et des sanglots étouffés. Dans les rues, il y avait du despotisme, de la censure, des indicateurs, une constante chasse aux sorcières, des peurs et du silence. Zaba régnait en maître sur l’univers des êtres et les choses ! Et il n’y avait plus rien à faire que de s’en aller loin avec ses racines, sa passion, ses idéaux et sa douleur : «Quand tu aimes il faut partir»! (Cendrars).
Seulement, maintenant, ça y est ! la fameuse «révolution» tant rêvée et que, étrangement, nul parti politique, nulle classe sociale, nul leader n’avaient vraiment prévue pour ces jours-là, vient d’ «avoir lieu» (ou c’est du moins ce que l’on a cru !) et quand on aime, il faut, au contraire, revenir :
«Je suis revenue vers tn (Tunis/Tunisie) et l’amour de tn, retour vers les rêves des dix-sept ans. Celle qui est partie, celui qui est resté, comme si la Révolution allait permettre un recommencement au point de départ. Nous comparons encore les trajectoires et les points d’intersection : qu’est-ce qui m’aura tant manqué pour que je parte, qu’est-ce que tn lui aura tant donné pour qu’il reste ? Coût de l’exil. Prix de l’enracinement (…) «Baghdad (Tunisie) je viens vers toi comme un vaisseau épuisé…Je cache mes blessures derrière mes vêtements.»… (pp. 35-36).
Comme on peut le constater, Dora Latiri mobilise dans cet émouvant récit de retour à la Tunisie après les événements politiques et sociaux l’ayant secouée entre décembre 2010 et janvier 2011, la première personne du singulier, franchement autobiographique et empreinte de quelque lyrisme «révolutionnaire». Bien en phase avec ladite «révolution de la dignité ou du jasmin» —que même les U.S.A du très guerrier, destructeur de pays et de nations, Obama («Yes, we can!»), le Quatar monarchique et anti-révolutionnaire par principe et par foi, et la Turquie de l’Islamiste zélé Erdogan, se sont, paradoxalement, exténués à applaudir —elle combine, comme dans un kaléidoscope, le présent de la «nouvelle» Tunisie «libérée» avec les souvenirs lancinants de son enfance, de son adolescence, de sa première jeunesse rebelle et du père qui, à son corps défendant, l’a bannie, rien que pour avoir épousé «l’homme de son cœur (venant) d’ailleurs» (p. 52), et qui s’en est allé après , le cœur gros de repentir, la retrouver au lointain pays où elle s’était retranchée avec son amour, après l’avoir vue, dans un cauchemar, se noyer, seule, loin de lui.
Sans préjugés, tolérante et aimante, en totale empathie avec sa Tunisie qui lui manquait terriblement et loin de laquelle elle ne pouvait se sentir et se définir que comme tunisienne d’abord, en dépit de l’inévitable hybridité de son être («Je suis d’ici, Je suis de là-bas», parole de Mahmoud Darwich qu’elle met en exergue, à l’entrée de son livre.) et de son prestigieux poste d’enseignante-chercheuse à l’université de Brighton, en Angleterre, elle s’infiltre délicatement partout où elle peut, mange des crevettes à La Goulette, lit la presse tunisienne, prête l’oreille aux voix et bruits qui montent autour d’elle, se rappelle avec saveur le plat de «lablabi» que son oncle envoyait chercher (p. 26), trouve sa joie dans un petit verre de thé que les Tunisiens appellent «kwayess trabelsi» (petit verre tripolitain), remarque le commissariat du quartier à moitié détruit, évoque, avec «la lumière très blanche» (p. 87), «les marchands de fruits et légumes (qui) envahissent la chaussée dans l’illégalité» (ibid), désordre «révolutionnaire» oblige ! parle des «haragas, brûleurs de frontières» (p.49) qui «attendent de se glisser dans un bateau en partance vers l’ailleurs» (Ibid.), reproduit dans son texte, en plein écoulement d’une langue française de la plus belle eau, de multiples bouts de phrases en dialecte tunisien qu’elle capte ici et là et où vibre l’âme de son peuple dont elle se sent proche, plus proche que jamais. Son appareil photo au poing, elle se promène dans la terre retrouvée et prend, en fervent artiste, des photographies diverses, «habitables», comme dirait Barthes dans «La chambre claire», uniquement en noir et blanc et leurs nuances, leurs ombres et lumières ; des photographies nouvelles qu’elle joint à des photos anciennes (les deux petites filles, p. 18, «La gazelle», pp. 44-45) dont elle émaille, à des intervalles perceptibles, son texte et qui représentent, en figeant des moments et des émotions fugaces, des scènes de la vie quotidienne en Tunisie. On y voit des pages de journaux en langue arabe, de petits verres avec leurs reflets sur un papier-journal, une femme en safsari qui apparaît de dos derrière une porte ouverte, des fleurs et une sauterelle, des femmes couvertes de la tête aux pieds qui se meuvent dans un flou artistique et dont l’image se multiplie comme dans un jeu de miroir (pp. 62-63), une terrasse vide, un bateau au lointain, un salon de coiffure, l’enseigne d’un taxi, un marchand de figues de Barbarie, un train, la Sainte Vierge à la «Ghriba», la mer de La Goulette où «la vague n’arrive plus» (p. 114) à «la plage qui ne cesse de s’étendre» (Ibid.), et bien sûr «Little flower», cette «Petite fleur» aux orteils enduits de henné, «lumière, pleine de grâce» (p. 66), avenir de la Tunisie, qui lui demande, elle-même, de la prendre en photo.
Toutes les photographies émanent d’une réalité visible et sensible, chaudement marquée par l’émotion de l’autrice, et le texte où elles sont insérées et avec lequel elles alternent régulièrement ou se confondent et complètent.
Dans les 15 courts chapitres du livre de Dora Latiri, sans chronologie, tout communique, en effet, s’amalgame et se télescope. Les limites entre ce qui envahit son regard et l’assaille de partout semblent s’effacer en même temps que les frontières séparant le passé qui sommeillait en elle sans jamais mourir et le présent se projetant dans un futur où elle essaye de trouver des signes lumineux, mais qui demeure improbable, seulement espéré, rêvé pour une Tunisie à la croisée des chemins ; séparant aussi la ville natale et Lewes, la ville d’adoption, où «il pleut sur la rivière Ouse» (p. 10) comme il pleut sur la mer d’ici. Le télescopage, fruit de la magie des retrouvailles et de l’étonnement, abolit aussi la séparation naturelle entre les deux types de discours, le textuel ou le «dire» et le photographique ou le «voir», et qui sont ici pleinement en interaction qui complexifient la signification et augmentent le coefficient de la réceptivité du contenu de ce livre . C’est l’émotion qui circule, telle un fluide invisible, entre eux, et les unit l’un à l’autre.
Mais «Un amour de tn» est d’abord, ne l’oublions pas, une œuvre d’art où l’on reconnaît un effort de création littéraire et une écriture aérienne et allusive de très bonne qualité, un style elliptique qui ne s’attarde pas dans l’évocation des référents, qui traduit, pour les fixer, des impressions éphémères, mais pénétrantes. On y souligne, en effet, la marque scripturaire d’une volonté de s’exprimer en raccourci et que révèlent ces phrases souvent courtes et incisives, ainsi que ses fragments phrastiques qui se succèdent en cascade, de manière un peu lâche, un peu languissante, comme si l’autrice était en train de transcrire de vertigineux songes précaires ou une espèce d’ état de grâce dans lequel elle flotte en retrouvant le pays aimé. Il y a là une belle ordonnance syntaxique confèrant à ce texte un ton poétique et un dynamisme vivant qui le rendent plus saisissant. On y relève des inversions, de nombreuses répétitions lexicales poétisantes (des anaphores et des anadiploses) parce qu’elles impriment un rythme à la narration. Elles indiquent aussi l’émotion à petites doses successives : «Tout langage émotionnel tend à prendre la forme répétitive», écrivait quelque part Jean Cohen.
Il y a dans ce livre, somme toute, un style léger, fort peu construit, et comme impressif qui tend le plus souvent à reproduire des émotions, des chuchotements intérieurs, des frémissements, des rêves imprécis, vaporeux, des réminiscences flottant dans l’ombre de la mémoire telles des images floues ou en demi-teinte, plus qu’ à évoquer des référents matériels. On croit y reconnaître un peu le style de Marguerite Duras, surtout dans «L’Amant» ou dans «Emily L». Un style qui élève cette «photoautobigraphie» à la dignité de la poésie et donne au lecteur une inexprimable jouissance.
C’est, en conclusion, un style et un livre que Dora Latiri, dont le porte-plume est attaché à son cœur, offre tel un bel hommage à la Tunisie et à sa «révolution», réelle ou illusoire, et qui semblent lui permettre de faire le calme dans son esprit, d’apaiser la part secrète en elle et de se réconcilier enfin avec les images lancinantes du passé tout en restant, à la manière d’Edward Saïd «un flot de courants multiples» (p. 113), préférable «à l’idée d’un moi solide, identité à laquelle tant d’entre nous accordent tant d’importance» (Ibid.).
Dora Latiri, «Un amour de tn. Carnet photographique d’un retour au pays natal après la Révolution», Tunis, Elyzad, coll. «Eclats de vie», 2013, 214 pages, format de poche.
-Dora Latiri a publié,en 2020, son nouveau livre «Citrons doux, L’Aînée», à Contraste Editions, à Sousse, Textes, photographies et dessins , 95 pages, format 15X21.

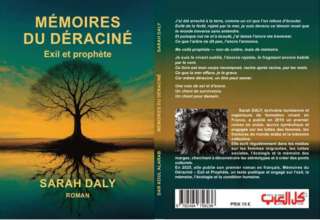














Miled Hassini
3 avril 2021 à 10:57
Très beau texte, Monsieur Bourkhis. Cela donne envie de lire le livre. Bravo pour la richesse, l élégance et la beauté de votre verbe.
Pheefee
3 avril 2021 à 11:58
Bel article. Une brève évasion dans le temps et vivement la lecture du livre. Merci au journaliste et merci à l’écrivaine pour cette petite bouffée de bonheur dans ma tunisie si tristement meurtrie.
Fethi
4 avril 2021 à 04:46
magnifique invitation au voyage
Fethi Khiari