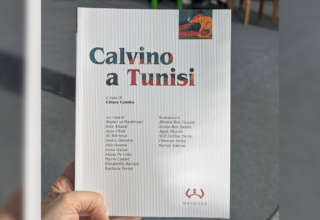Nouvelliste à la plume féconde et étonnante, Rawene Ben Regaya fait partie de la nouvelle vague des écrivaines tunisiennes, souvent jeunes, qui, par leurs œuvres, sont en train d’apporter du sang neuf à la littérature de la Tunisie et qui méritent attention.
Après son premier recueil de nouvelles en langue arabe «Al Awghad» (Les chenapans), publié, à Tunis, en 2020, aux éditions «Dar el kitab» et dont nous avons déjà rendu compte dans cette rubrique culturelle (La Presse, 20-11-2020), elle a publié ces derniers mois chez le même éditeur sa nouvelle belle grappe de textes nouvellestiques intitulée, non sans quelque effet d’accroche, «Habs ennessaâ» (La prison des femmes) et où, fidèle à elle-même, elle va de nouveau à l’assaut de l’empire des machos et évoque, dans un style littéraire particulièrement bien travaillé et pénétrant, des peines, des exclusions et des douleurs que vivent injustement les femmes dans une organisation sociale et morale toujours gravement marquée par les vestiges de l’ancien système féodo-patriarcal et phallocratique.
Jeune écrivaine prometteuse, Rayane Ben Regaya était aussi, passionnément, une volleyeuse de haut niveau, en équipe nationale de Tunisie, avant de réussir son concours de magistrature et de se consacrer à son métier de magistrate, puis de chercheuse au «Centre d’études juridiques et judiciaires» où elle est en train de mener une thèse de doctorat en droit.
Appartenant à la nuit, comme elle tient à nous le préciser, elle passe ses nuits à écrire notre société machiste et à tourner la métaphore qui est le plus fort et le plus beau de son écriture. Une écriture troublante qui lui est chevillée au corps, depuis son enfance, quand elle écrivait en secret et qu’elle savait raconter des histoires attachantes aux enfants de son âge. Interview.
Rawene Ben Regaya, vous êtes une ancienne volleyeuse en équipe nationale ; vous étiez aussi juge au tribunal de Première Instance avant d’être chercheuse en droit, et vous voici soudain autrice de deux recueils de nouvelles en langue arabe. Qu’est-ce qui est venu le premier chez vous : le sport ou l’intérêt au droit ou l’écriture?
Je suis une jeune femme tunisienne âgée de 31 ans, mariée, originaire de la ville de Kélibia, doctorante, juriste de formation, poétesse dans mes moments de loisirs, magistrate chercheuse, grande dévoreuse de romans et de recueils de poèmes, tant en arabe qu’en français. J’appartiens à une famille versée dans la littérature, mon père est professeur universitaire de philosophie. Ma mère est institutrice. Depuis mon enfance, je fus élevée au milieu des livres qui sont devenus mes meilleurs amis et dont la lecture assidue m’a donné des facilités toutes naturelles à l’écriture et à la création littéraire. Depuis ma jeune enfance, je lis tout ce qui me tombe sous la main comme livres et recueils de poèmes. J’étais et je suis encore fascinée par les romans, les nouvelles et les recueils de poèmes. Je lisais ce qu’il y a à la maison, j’achetais, j’empruntais de la bibliothèque communale, j’échangeais les romans avec mes amies et on lisait à tour de rôle. A force de lire, l’idée m’est venue d’essayer moi aussi d’écrire. Depuis que j’étais au lycée, j’ai commencé à essayer d’écrire de petits récits et des fragments de poèmes que je montrais à ma sœur aînée et que je cachais immédiatement et soigneusement dans mes tiroirs sans les montrer à personne d’autre, car mes parents voulaient que je me consacre entièrement à mes études et craignaient que l’écriture en dehors du programme de l’enseignement officiel ne détourne mon intérêt notamment pour les matières scientifiques. Quand j’ai commencé à travailler, j’ai dépensé mon premier salaire en entier dans l’achat de livres et j’ai commencé sérieusement à écrire des récits assez élaborés que je publiais sur les réseaux sociaux. J’étais moi-même surprise par le très large écho favorable que mes écrits ont trouvé chez les lecteurs. Le volley-ball m’a accompagné depuis l’âge de neuf ans. J’étais grande par rapport à mes copines et cela était un facteur de plus qui m’a aidée à exceller dans le jeu. Avec le temps, ma performance s’est grandement améliorée. Mon père m’entraînait pendant des heures supplémentaires sur la plage, en plus des séances officielles d’entraînement. Je suis devenue chef d’équipe et j’ai assumé pendant des années la responsabilité de toute une équipe. Cette mission m’a permis d’apprendre beaucoup de choses merveilleuses sur la vie, telles que l’acceptation de l’autre, la coexistence pacifique, le désir de victoire collective et le partage du bonheur et du chagrin avec les autres. Cela a beaucoup contribué à construire ma personnalité.
L’amour du droit est venu plus tard. Dès mon jeune âge, je me révoltais contre toute forme d’injustice. Rebelle, je n’aimais pas la violence et l’oppression, et au baccalauréat, en étudiant profondément la philosophie, je suis devenue obsédée par l’étude du droit et des sciences politiques. J’ai donc opté pour les études de Droit à la faculté.
La magistrature représente un domaine d’objectivité et de rigueur, tandis que la littérature est le domaine de la subjectivité par excellence. Comment parvenez-vous à concilier votre travail, et les contraintes qu’il vous impose, avec votre activité d’écrivaine ?
Il est difficile d’une façon générale de faire une dissociation totale entre l’écrivain et la nature de son activité professionnelle dans la vie ou au niveau de ce qu’il écrit ou publie, de même, la réconciliation de l’écriture avec la magistrature est difficile, car, en raison de la nature du pouvoir judiciaire, la pression du travail et son importance réduisent le temps d’écrire. Pour ma part, je vole quelques heures à la nuit quand tout le monde dort pour écrire et remettre à la page blanche tout ce que j’ai vu pendant la journée.
Il faut avouer que ma profession m’a quelque peu inspiré. Mais la justice que j’ai cherché à aborder dans mes écritures, c’est elle qui est toute naturelle, dispensée des contraintes procédurales et dont le point de départ est que tous les êtres humains sont et doivent être égaux tant au niveau des droits qu’au niveau des obligations, et, qu’en toutes circonstances, leur dignité doit être respectée et sauvegardée.
«El Awghad» (Les chenapans ou les salauds) est votre premier titre qui n’est pas passé inaperçu. C’est un recueil comprenant 16 nouvelles différentes. Est-ce que vous les avez écrites toutes à la même période ou tout au long de plusieurs mois ou plusieurs années ?
Le livre est le résultat d’un constat de l’existence d’un hiatus entre l’arsenal juridique de protection de la femme qui est très développé que ce soit en Tunisie ou partout dans le monde, et la condition réelle de la vie des femmes. Ces conditions de vie des femmes se sont encore détériorées plus lors du confinement général, décrété par les autorités officielles, suite à la pandémie du coronavirus sévissant un peu partout dans le monde. Le fait que les couples se soient retrouvés enfermés entre quatre murs à longueur de journée, et à subir la contrainte qui leur était imposée de ne quitter le domicile qu’en cas de nécessité impérieuse, a généré, pour un nombre important d’entre eux, des problèmes d’ordre psychologique et comportemental engendrant des disputes, de mauvais traitements de l’un des membres du couple par rapport à l’autre et des violences physiques et verbales entre eux et notamment de la part du conjoint dominant, qui est en général l’homme, sur l’autre conjoint. Partout dans le monde, les statistiques officielles ont montré la recrudescence du nombre des femmes battues par leur époux pendant le confinement dû au coronavirus. C’est dans ce contexte général que sont nés les récits de ces hommes et femmes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle sept récits du livre traitent de la relation entre couples pendant le confinement.
Dans vos nouvelles, vous vous intéressez à une catégorie particulière d’hommes tunisiens qui sont souvent machos et méprisants des femmes et qui sont quelquefois pleins d’infamie et de petitesse. Pourquoi cet intérêt particulier à ces hommes-là ?
Dans mes récits, je n’ai fait qu’évoquer littérairement la réalité objective, telle qu’elle est vécue par mes personnages, sans maquillage d’aucune sorte. J’ai décrit cette réalité sous tous ces aspects à la fois physique, psychique, psychologique, sociologique et parfois philosophique sans me fixer de limites.
Par ailleurs, je ne me suis inspirée que de mon ressenti personnel, de mes observations, de mon entourage, des événements et des contraintes et problèmes de la vie sociale d’une façon générale et de la vie conjugale dans les différents milieux sociaux. Ces hommes, machos et minables, sont nombreux au sein des sociétés arabes. Les intellectuels, les hommes bons, respectueux et respectables constituent une minorité. En tant que femme de lettres, ce qui importe à mes yeux ce sont les phénomènes maladifs.
On a le sentiment que dans vos deux livres, vous partez à l’assaut de la phallocratie endémique, séculaire, de la société tunisienne. Est-ce que vous espérez que l’écriture littéraire vous aidera à changer le monde avec les autres ?
Dans mon ouvrage, je suis revenue sur un sujet tabou et j’ai proposé une relecture de la réalité de la condition de la femme tunisienne. En effet, nous avons en Tunisie un arsenal de lois protectrices de la femme et de la famille en général des plus évoluées et progressistes. Mais le problème de la violence conjugale relève beaucoup plus de la mentalité et de l’héritage socioculturel qui n’ont pas suivi les évolutions progressistes des droits de la femme consacrés par la loi actuellement en vigueur. Quand on considère socialement que la cuisine et la charge de la garde des enfants en bas âge sont l’affaire exclusive de la mère, même quand celle-ci a des charges professionnelles parfois plus lourdes que celles du père, quand on considère comme normal que le mari ou le père s’absente toute la journée, et parfois des journées entières, du foyer conjugal pour fréquenter les cafés ou les bars ou pour aller où personne ne sait, quand le mari, pour un oui ou pour un non, abandonne sa femme dans le lit, alors qu’on ne tolère pas cela de l’épouse, quand le mari ou le père se comporte de la sorte, il exerce une violence d’un autre genre à l’égard de la femme. Se comporter de la sorte constitue un manque de respect de la femme, voire une rupture de l’égalité entre le mari et la femme. Changer cette mentalité relève beaucoup plus de l’éducation que du droit. Les récits que je viens de publier ont pour ambition de fustiger cette mentalité et de contribuer à la changer. Je pense que l’art est là pour accomplir cette mission.
Les femmes dans vos recueils sont souvent en mal d’amour, insatisfaites et malheureuses. Elles rêvent d’amour et d’épanouissement, mais le rêve est voué à l’échec. Pourquoi tous ces échecs amoureux et ces rêves cassés ?
Les femmes vivent souvent le malheur dans le mariage, dans nos sociétés arabes, parce qu’elles croient que lorsqu’elles fuient leurs pères, elles se retrouveront à jouir de la liberté et de la sécurité avec un autre homme, ce à quoi j’ai fait allusion dans l’histoire de Fatima. L’homme oriental se croit maître et «Sultan» car il verse la première eau de vie dans le ventre d’une femme. La qualité d’épouse est devenue une malédiction et apporte misère à l’épouse, qui se trouve un paria, porte toutes les responsabilités, toutes les insultes et elle est la plupart du temps exposée à l’exploitation et aux coups.
Votre écriture nouvellestique est imbibée d’ironie. Pensez-vous que l’ironie soit plus efficace que la dénonciation dénotative franche et directe, lorsqu’il s’agit de montrer, en littérature, les failles, les travers et les tares de la société à laquelle appartiennent vos personnages ?
L’ironie naît de l’intention et, sous la plume de l’auteur, elle renaît sous les yeux et dans l’intellect du lecteur. Donc, elle peut renaître et bouleverser le premier sens du texte. Mais l’ironie n’est pas le seul procédé stylistique utilisé, j’ai eu recours aussi aux métaphores, aux allégories, aux personnifications, aux comparaisons et à diverses autres figures, mixant la narration brodée avec le dialogue, tant intérieur qu’entre les personnages, et me situant dans un temps précis et dans des lieux appartenant à un monde réel qui me sont familiers : la rue, les immeubles, la maison, le foyer universitaire, le lycée, en Tunisie et même ailleurs (Italie Récit n° 5), en ville et parfois à la campagne (Récit n° 7). A mes yeux, ces différents styles sont essentiels dans le domaine de l’écriture littéraire car, consciente, à l’instar de Stendhal, que l’œuvre littéraire «n’est qu’un miroir qui se promène dans la grande rue», que tantôt elle reflète aux yeux du lecteur «l’azur des cieux, tantôt la frange des bourbiers de la route» et que l’homme ou la femme «qui porte le miroir dans sa hotte sera peut-être accusé par certains lecteurs d’être amoral» ! Je crois partager ce que le même illustre auteur avait si pertinemment dit à ceux-ci : «Vous accusez le miroir ! Accusez plutôt le grand chemin où est le bourbier et plus encore l’inspecteur des routes qui laisse l’eau croupir et le bourbier se former». Pour moi, aucun sujet humain ou se rapportant à la vie n’est tabou ou étranger au domaine de la littérature, tout ce qui concerne la vie, sans exception aucune, doit pouvoir être débattu littérairement et la littérature ne saurait se cantonner à ce qui est considéré comme conforme aux bienséances et à la pudeur sans être amputée et sans devenir, de ce fait, boîteuse.
Il y a dans vos textes une tendance manifeste à une métaphorisation constante et à très haut régime qui les impose comme réellement des productions artistiques. A quoi devez-vous cette grande aptitude à doter votre écriture d’une texture métaphorique si importante ?
Honnêtement, en écriture, je n’aime pas les tours d’ivoire intellectuelles et les prises de position hautaines et délabrées des savants, ni les segmentations des académiciens et chercheurs spécialisés. Quand j’écris, j’aime passer du four au moulin, me placer au milieu des gens, dans la poussière des impasses, traverser la boue des anciens quartiers, ce qui rend les scènes que je décris et les sentiments que j’étale très réels. Quand je me prépare pour écrire, je sens, pense, élabore et décris, usant des différents styles auxquels j’ai toujours cru. J’affectionne beaucoup la métaphore, parce que les récits, à travers elle, deviennent un morceau de la vie et même s’ils suscitent parfois l’angoisse et l’anxiété avec les détails inquiétants et douloureux qu’ils relatent.
Bonne chance !