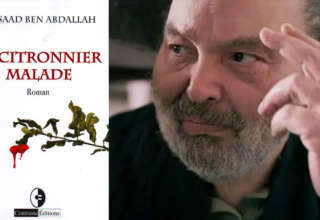Voici un beau livre qui sort, constellé de lumineuses images tant picturales que textuelles, de la joyeuse «Lucarne des Ecrivains» et où l’art consommé de l’étonnant Marjan entre en résonance avec la poésie des mots simples de Patrick Navaï.
Une poésie comme «aquatique» qui coule, s’écoule, dépouillée, allégée, parce que la métaphorisation y fonctionne à un régime volontairement modéré, litotique qui fait entendre plus qu’elle ne dit et qui est, somme toute, non moins belle, non moins saisissante, que ces merveilleuses peintures où Marjan, en poète du pinceau, quête les «divins rivages» (p. 57), c’est-à-dire cette précieuse face voilée vers laquelle, en permanence, tend son œuvre.
Il s’agit, en effet, d’une artistique entreprise interactive à deux mains, celle qui a déjà peint passionnément durant plusieurs années, et celle, arrivée sur le tard, pour écrire, avec un égal bonheur, avec la même passion créatrice, ces 135 poèmes de longueur légèrement variable, aux vers souvent irréguliers et courts et au rythme vif, qui sont loin d’être composés sur commande et se réduire à de simples légendes ou notes explicatives par rapport à ces peintures de Marjan, mais qui sont des textes complets, pleins, que ces merveilleuses peintures, riches en couleurs chaudes et en significations multiples, parlantes bien que muettes, font naître sous la plume féconde de Patrick Navaï sans du tout l’inféoder ou en juguler l’élan vers la liberté imaginative et l’indépendance.
Motivés par sûrement une profonde religiosité intérieure, mais d’abord par une incessante quête du beau où qu’il soit et d’où qu’il vienne, ces joyaux de ce poète français de père iranien, «l’homme que la providence a, semble-t-il, choisi pour parler de Marjan dans ce qu’il a de plus intime» (p. 11), se présentent comme des pensées, des impressions ou des sensations instantanées, n’entendent pas expliquer les toiles de ce peintre français de père tunisien ou simplement en décrire ou retracer le contenu ou encore rendre clair ce qui y serait obscur. Ils entreprennent surtout de les interroger discrètement et d’appréhender avec intelligence et délicatesse cet indicible qui transparaît vaguement au travers de leurs formes informes, de ces yeux toujours grands et ronds qui les peuplent, de ces regards tristes qui s’y promènent, hagards, de ces gouaches vives, en osmose les unes avec les autres, qui ne colorent pas uniquement le monde auquel réfèrent ces peintures, mais racontent la tristesse, la solitude et l’âme de l’être qui s’interroge face à l’univers. Pénétrants, ces poèmes tentent aussi de capter le message de cette insistante croix y apparaissant avec une prodigieuse constance. C’est en fait un pont de mots et d’émotions que Patrick Navaï étend, avec la sérénité de l’homme sensible à la douleur d’autrui, mais déjà aigri, entre son inspiration poétique et ces peintures de Marjan. Lequel, outre la blessure qu’il recèle depuis l’enfance dans sa mémoire douloureusement tatouée et qui est toujours ouverte et marque visiblement son art, croit porter en lui-même un mystère traversant de part en part son œuvre picturale : «Car, si dans ma peinture—observe t-il dans l’avant-propos de ce livre—il y a le jaillissement de mes blessures et de mes manques affectifs, il y a aussi une autre lumière. Une sensibilité profonde et délicate peut capter cette lueur abyssale, cette présence transcendante dans mes peintures : elle vit en moi depuis que je suis enfant, elle m’a toujours nourri et soutenu ! Elle est mon refuge sacré» (pp. 11-15)».
Plus loin, ce rescapé d’une enfance pénible, précise, en vue de rappeler cette douleur que son œuvre essaye de transcender et que Patrick Navaï sait saisir au vol avec toute la dimension ineffable des peintures de Marjan, que «ce sont des œuvres qui ont pleuré à l’intérieur» de lui-même (Ibidem.). Jean Genêt aurait dit en substance qu’il n’y aurait pas de grand art qui n’émanerait pas d’une profonde blessure ! Et Patrick Navaï, qui entre ici en interaction avec ces toiles et avec cette douleur tacite, ne serait pas le premier à avoir vite réalisé que l’art de Marjan, bien que souvent triste, vaut son pesant d’or : Alexis Péron, l’ancien administrateur du grand Musée de l’Art Moderne de Lille (LAM) «qui est le premier à avoir été interpellé par son expression picturale», l’éminent réalisateur Patrice Velut qui «a fait exister sa peinture dans le domaine de l’audiovisuel», ainsi que Didier Benesteau, le commissaire d’exposition et scénographe « qui est le gardien de son œuvre qu’il a su respecter et faire connaître» ont tous compris que Marjan, cet enfant de la banlieue pauvre et difficile, est un illuminé de l’art dont il faut prendre au sérieux le don et le talent.
Ainsi, ce livre de peintures et de poèmes significativement intitulé «Une enfance en oraison», essentiellement autobiographique, retraçant un parcours singulier de l’enfance à la peinture via la foi soudaine et «luminifère», motrice et créatrice, serait-il le fruit de cette reconnaissance que Marjan a trouvée chez ces grands Maîtres et grandes références en la matière. C’est une enfance «en oraison», parce qu’en étroite relation avec la prière liturgique, avec les heures de silence et de méditation solitaire de Marjan à l’église. L’église où il se rendait avant de se découvrir peintre et qui semblait l’avoir sauvé de la délinquance où il risquait de tomber, avant qu’il ne découvre l’art où cette église décisive est aujourd’hui fortement présente : dans 95 peintures sur les 104 qui s’étalent sur de nombreuses pages de ce livre, trône la croix, symbole de la religion chrétienne. Elle est partout dans ces toiles, tantôt lointaine et discrète, tantôt proche et claire, derrière ou devant, de petite taille ou de grande taille. Elle est sur la poitrine, elle brille dans la nuit, elle figure en haut d’une épitaphe, elle se dessine sur les murs, sur les fenêtres. Elle accompagne le rêve de l’invisible. Mais elle est aussi dans les poèmes fortement imbibés de religiosité de Patrick Navaï : «Moi je n’ai pas le temps/ Ma croix m’attend» (p.69).
Outre le onzain inaugural qui annonce clairement dès l’ouverture du livre, cette religiosité chrétienne sous-tendant et marquant très fort cette œuvre picturale franchement engagée dans l’expression du sacré et qui est solidement soutenue par Didier Benesteau «qui a vécu 17 ans dans une communauté religieuse» (Ibidem) et qui a organisé, en 2022, une grande exposition aux œuvres de Marjan dans la Cathédrale de Créteil—ce qui n’était pas sans avoir quelque signification religieuse—il y a dans ces poèmes interactifs de l’auteur des «Voyages encrés» et des «chemins contrariés» (Carnets-Livres, 2008-2010) tout un lexique puisé dans le langage de l’église et qui révèle cette patente religiosité motivant à la fois le peintre—qui «s’est toujours senti un peu moine au fond de lui-même» (Ibidem.)—et le poète—qui serait plutôt animiste ou panthéiste—faisant bon ménage ensemble sous le regard protecteur et complice du «Père» : «le Père te regarde/ comme un père son enfant» (p. 21). «Dieu», «Seigneur», «Croix», «Fidèles», «Salut», «Ordres», «Oratoire», «Oraison», «Prêtre», «Béni» sont en effet autant de mots à la connotation chrétienne évidente et qui circulent dans les vers pour signifier cet engagement dans le religieux et le sacré, «Pour rendre hommage/Au créateur» (Ibid.).) et se positionner artistiquement par rapport au monde qui «tourne à l’envers» (p. 71) et où «la misère s’en donne à cœur joie» (Ibid.).
Commentant cette religiosité que tout lecteur bienveillant ne peut que tolérer, même si elle risque quelquefois de confondre un peu l’art de ce peintre moderne et progressiste avec l’art des églises, Marjan souligne qu’ «Une religiosité est là, au sein de l’âme qui brûle d’un amour étrange et apaise les blessures affectives de l’enfance. Cette sensibilité exacerbée me fait écouter chez l’autre ce qu’il ne dit pas : ses souffrances, ses manques, ses emprises. C’est ainsi que l’enfant que j’ai été a porté en lui-même les peurs et la détresse de sa mère» (Ibidem.). C’est clair donc, le «Père», dans ces peintures et dans ces poèmes, est consciemment, scripturairement, celui de l’église, mais il serait peut-être aussi, dans l’inconscient, le géniteur, le vrai, qui est étranger et qui a disparu en laissant derrière lui peut-être une espèce de trouble identitaire, un trou béant au fond de soi-même, des souffrances, des manques, des détresses maternelles, un vide affectif que cette religiosité, plutôt forte, plutôt prégnante, vient combler.
Trois grands volets composent ce livre et s’articulent tous autour de l’enfant Marjan, celui-là qui, à l’école primaire, n’était pas doué en dessin et qui est devenu, sans jamais s’y attendre, comme par enchantement, un artiste plasticien ayant aujourd’hui le vent en poupe : «L’enfant de la transcendance», «L’enfant qui protégeait sa famille dans sa lumière intérieure» et «L’enfant qui portait les êtres de souffrance dans ses oraisons».
Un livre à lire et à offrir !