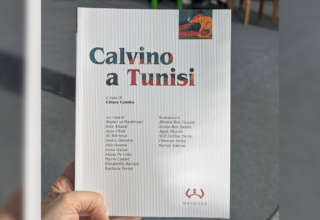Olivier Soutet est linguiste de renommée mondiale. Il est Professeur émérite à l’Université de la Sorbonne dont il est aujourd’hui l’un des plus grands noms. Les directeurs des «Mélanges», qui lui ont été offerts en 2017, écrivent que sa pensée « a modifié durablement le paysage de la linguistique générale et française, en France et au-delà, en imprimant la marque d’un guillaumisme revisité aux théories du changement linguistique et aux approches systématiques de la langue».
S’inscrivant, depuis ses débuts en linguistique, dans la «psychomécanique» de son prédécesseur Gustave Guillaume qu’il fréquente, dit-il, depuis 50 ans, ses travaux, bien nombreux et tous publiés chez de grands éditeurs français dont «Honoré Champion» chez qui il dirige depuis de nombreuses années la remarquable collection «Bibliothèque de grammaire et de linguistique», lui ont permis d’être une grande référence en matière de cette orientation linguistique définie comme «La science des mécanismes fondamentaux de la pensée commune qui interviennent dans la genèse de la langue». Son dernier ouvrage, sorti à la fin de 2022, «Le sens sous tension. Psychomécanique et sémantique grammaticale», réunit en les prolongeant plusieurs des travaux qu’il n’a cessé de conduire dans cette discipline exerçant sur lui, nous avoue-t-il, un grand pouvoir de séduction et lui donnant un exceptionnel plaisir intellectuel. Parmi ses ouvrages les plus connus et qui ont été réédités plus d’une fois, nous citons ici surtout «La syntaxe du français» ( Paris, PUF, 1989, 1993, 1998, 2005 et 2009), «Etudes d’ancien et de moyen français» ( Paris, PUF, 1992), «Linguistique» (Paris, PUF, coll. «Quadrige», 1995, 1997, 2001 et 2005) et «Le subjonctif français» (Paris, Ophrys, 2000). Durant sa brillante carrière d’enseignant-chercheur et de directeur de recherches, il a mérité plusieurs distinctions dont «Chevalier de l’ordre des Palmes académiques» et «Officier de l’ordre des Palmes académiques». Outre ses lourds engagements professionnels à Sorbonne Université, il est le correspondant de «l’Académie des inscriptions et Belles-Lettres». Naturellement modeste et ouvert aux autres, comme souvent les vrais savants, il nous a accordé, la semaine dernière, dans un vieux café parisien, cet entretien :
Vous avez commencé votre parcours de chercheur par la rédaction d’ une thèse, sous la direction de Roger Lathuillère (1926-1989), sur «L’expression de la concession en français des origines à la fin du 16ème siècle». Votre choix de travailler avec ce professeur qui a beaucoup écrit sur la langue classique du 17e siècle et sur la préciosité aurait-elle quelque rapport avec ses préoccupations ?
Lathuillère a été mon professeur en licence et dans le cadre des cours d’agrégation. Il assurait notamment un cours portant sur la langue du 16e siècle. Pensant travailler sur cette tranche historique, je lui ai demandé de diriger ma thèse. Bien que le sujet ait changé, il a bien voulu continuer d’être mon directeur, même s’il était plus philologue que proprement linguiste.
Vous êtes connu surtout pour être psychomécanicien, c’est-à-dire partisan de la théorie du linguiste français Gustave Guillaume (1883-1960) établissant le rapport entre la pensée et le langage. Votre ouvrage «Le sens sous tension. Psychomécanique et sémantique grammaticale» (Ed. Honoré Champion, 2022) réunit plusieurs de vos articles autour de cette discipline dont on a quelquefois du mal à comprendre les principes fondateurs. En gros, comment définissez-vous cette théorie et comment défendez-vous son utilité aujourd’hui dans les études linguistiques ?
La psychomécanique du langage — nom si je puis dire officiel de la théorie linguistique développée par Guillaume — a été et reste en effet le cadre épistémologique et méthodologique des analyses que j’ai pu proposer dans la description du français, tant au plan synchronique qu’au plan diachronique. Je la fréquente assidûment depuis environ 50 ans, depuis le moment où j’en ai fait la découverte en suivant les cours de G. Moignet (en 1972-73). Elle a exercé et continue d’exercer un très fort pouvoir de séduction sur moi et ne cesse de créer un plaisir intellectuel qui tient sans doute à ceci qu’à son contact, non seulement on découvre aux faits observés des explications qui satisfont l’esprit par leur élégance et leur systématicité, mais on est invité à voir des faits, à prendre conscience de faits jusqu’alors inaperçus. Autrement dit, cette théorie a une force heuristique assez exceptionnelle selon moi. Par ailleurs, sans couvrir la totalité des faits «langagiers», elle couvre un champ considérable. Touchant à la philosophie du langage, elle s’interroge sur l’activité de la pensée en action de langage, postulant que cette activité est soumise à une forme de temporalité (le temps opératif), de nature à soutenir les opérations de conceptualisation et de sémiologisation. Reprenant le couple saussurien langue/parole, non seulement elle le reformule en langue/discours mais, dépassant son cadre originellement sociologique, le rentabilise au plan cognitivo-énonciatif, ce qui permet de rendre compte avec économie et élégance des faits de polysémie (celle-ci se laissant décrire comme le rendement potentiellement considérable en termes de signifiés de discours d’un seul signifié de langue). On pourrait ajouter qu’elle propose une typologie des langues originale (malheureusement encore mal connue) et que, sous-tendue par une conception finalisée de l’évolution des langues, elle invite à repenser l’évolution diachronique des langues, au moins en morphologie et morphosyntaxe, comme une évolution au moins partiellement orientée.
Gustave Guillaume semble être convaincu qu’il est nécessaire de retirer de l’analyse de la langue tout ce qui serait de l’ordre du subjectif afin de pouvoir apporter un caractère scientifique à cette analyse. Etes-vous d’accord, pour votre part, que le travail sur la langue peut se passer de l’étude de son côté subjectif ?
De fait, la théorie guillaumienne n’est pas d’inspiration psychologisante et, sous ce rapport, on doit regretter que les dénominations qui la désignent (psychomécanique, psychosystématique, notamment) soient sources de contresens : le préfixe psycho- ne doit pas être compris comme renvoyant à psychologie mais à psychisme, entendu au sens de «support de cognition».S’il est vrai, en effet, que l’acte langagier est accompli par un sujet par nature particulier, ce n’est pas son idiosyncrasie qui est prioritairement à l’œuvre, sauf, marginalement, dans quelques choix métalinguistiques ou stylistiques (qu’on nous permettra de tenir pour seconds, ce qui ne veut pas dire secondaires) mais sa puissance de sujet langagier transcendantal.
On sait aussi que vous êtes l’un des plus grands spécialistes de la grammaire historique du français. Quels sont donc les grands principes gouvernant cette grammaire ?
Je tiens d’abord à préciser que, même si la part de la linguistique diachronique du français a reculé, notamment dans le cadre de l’enseignement universitaire, elle continue de susciter des travaux nombreux et de grande qualité, pour certains très innovants. Plusieurs des chapitres de la récente «Grande Grammaire Historique du Français» (parue en 2020) en portent témoignage. La discipline est diverse, de la philologie aux analyses théoriques et délibérément interprétatives, étant admis qu’aucune théorie ne peut rendre compte de l’entier de l’évolution d’une langue dans ses composantes phonétique, morphologique, syntaxique, lexicologique, pragmatique ou textuelle. Parmi les développements notables des dernières décennies, je retiendrai prioritairement :
a- la création de bases de données textuelles, desquelles constituent des corpus permettant une évaluation quantitative des faits observés ;
b-le renouvellementpartiel de la phonétique historique ;
c-une meilleure prise en compte de l’entier des synchronies successives, constitutives de la diachronie globale. Longtemps, les états anciens (jusqu’à la fin du français classique) étaient prioritaires ; aujourd’hui, on y ajoute un intérêt pour les développements modernes et contemporains, jusqu’à la plus stricte contemporanéité ;
d-une approche typologique, qui fait apparaître les modifications du français dans son histoire, entre moment analytique et moment synthétique. Point de vue qui mériterait évidemment d’être développé.
Les critiques observent que vos travaux tant multiples que variés se situent au croisement de la psychomécanique du langage et de l’histoire de la langue française. Est-ce qu’en fait vous êtes dans deux domaines différents ou dans deux domaines qui s’appellent et se complètent, entre lesquels il y a des passerelles ?
S’il est vrai que, comme je viens de le dire, aucune théorie ne peut rendre compte de l’évolution d’une langue dans sa globalité, je pense cependant que la psychomécanique offre une théorie du signe qui peut permettre de comprendre comment la combinaison du signifiant et du signifié est l’objet d’un ajustement progressif non aléatoire. Il en résulte que, selon moi, les approches guillaumiennes des évolutions en morphologie, morphosyntaxe et sémantique grammaticale marquent un véritable renouvellement en linguistique diachronique. La chose n’est pas nouvelle et il faut rendre hommage ici aux travaux des guillaumiens des générations antérieures : G. Moignet, J. Stéfanini, R. Martin, M. Wilmet, notamment. C’est dans cette filiation que je me place.
Les auteurs des Mélanges «Penser la langue : sens, texte, histoire : hommages à Olivier Soutet» qui vous ont été offerts en 2017 et qui furent publiés aux éditions «Honoré Champion» sous la direction de Claire Badiou-Monferran, Samir Bajric et Philippe Monneret, écrivent que votre pensée «a modifié durablement le paysage de la linguistique générale et française, en France et au-delà, en imprimant la marque d’un guillaumisme revisité aux théories du changement linguistique et aux approches systématiques de la langue». De votre point de vue, dans quelle mesure cela est juste ?
Je laisse à d’autres l’évaluation de cet éventuel apport. Je peux simplement faire état de mon souhait : dégager une systématicité non pas seulement dans l’approche synchronique mais dans l’évolution diachronique.
Outre votre statut de linguiste, certains vous présentent comme «Littérateur». Car, au début de votre carrière de Professeur-chercheur, vous avez écrit des ouvrages sur la littérature plutôt que sur la linguistique dont «La littérature française de la Renaissance» (Paris, Puf, 1980) qui a été republié aussi sous la forme d’un «Que Sais-je ?» (N° 1880) en 1995 et réédité plusieurs fois. On voit aussi que vous travaillez sur des corpus littéraires. On pourrait dire que vous avez deux cordes à votre arc. Comment au début étiez-vous passé de la littérature à la linguistique ?
Mon cursus est classique : j’ai commencé par des études de lettres (classes préparatoires, agrégation) avant de m’intéresser à la linguistique, théorique et historique, sous l’impulsion des enseignements de Moignet. Ce parcours n’a rien d’extraordinaire pour les linguistes de ma génération. Avant de commencer une thèse d’Etat sur l’histoire des tours concessifs en français, je pensais travailler sur la langue de Calvin, théologien protestant qui a largement contribué au développement de la langue vernaculaire dans l’exercice du culte. On devine qu’indépendamment de toute perspective proprement religieuse, cette ouverture au vernaculaire est porteuse de toute une série d’implications linguistiques du plus haut intérêt. J’ai abandonné cependant ce sujet pour embrasser celui que je viens d’évoquer, les tours concessifs, qui m’a semblé plus intéressant, au carrefour de la linguistique et de la logique. Quoi qu’il en soit, la langue de la Renaissance n’est pas sortie de ma sphère d’intérêt et, du reste, mon étude des tours concessifs porte sur la période allant du très ancien français à la fin du 16ème siècle. C’est aussi ce goût pour la langue de la Renaissance qui a conduit les Presses Universitaires de France à me demander — à la fin des années 70 — de proposer une nouvelle édition d’un «Que sais-je» consacré à la littérature française de cette période. Depuis, je n’ai rien publié relevant strictement du domaine littéraire.
On pourrait remarquer que vous êtes quelquefois proche, dans vos analyses, des stylisticiens ? Pourrait-on penser que le style procède aussi de vos préoccupations ?
J’ai enseigné la stylistique notamment dans mon premier poste de Professeur des Universités à Dijon (1988-1994). Je préparais les candidats à l’agrégation aux épreuves de grammaire et stylistique du concours. Si je pense que la stylistique a toute sa place dans le cadre des études linguistiques, au carrefour de la littérature, de l’histoire de la langue et des analyses formelles (phonétique, morphologie et syntaxe), je n’ai pas publié dans ce domaine. Quant à la notion de style, elle a fait l’objet de nombreux travaux. La question théorique posée est celle de l’articulation de l’individuel au général dans la production langagière. La stylistique, comprise dans son extension la plus large, est une discipline très exigeante. Elle requiert des compétences d’ordre linguistique, esthétique et social (au minimum).
On remarque que deux de vos premiers ouvrages à portée généraliste qui sont «Linguistique» et «Syntaxe du français» ont bénéficié d’un accueil très favorable de la part des chercheurs et des étudiants partout dans le monde et ne cessent d’être réédités depuis plus de 25 ans. Par quoi expliquez-vous ce succès par une époque où les livres sur la linguistique et la syntaxe sont légion ?
Je ne pense pas être le mieux placé pour répondre à cette question. Ce sont mes collègues «prescripteurs» et les étudiants qui sont les mieux à même de le faire.
Vous avez dirigé plusieurs colloques et ouvrages collectifs dont, à titre d’exemple, «La polysémie» (Pup Sorbonne, 2005). Pourquoi, pour un chercheur de votre expérience et de votre rang, cette direction d’ouvrages et de colloques demeure t-elle nécessaire, même s’il a déjà obtenu tous les grades et titres ?
L’organisation de colloques et/ou la direction de publications collectives appartiennent à l’ensemble des tâches d’un universitaire, notamment lorsqu’il dirige une unité de recherche. Ces manifestations (colloques, journées d’étude) et pratiques éditoriales (numéros de revue thématiques) se sont multipliées. La participation à ces travaux est devenue prioritaire pour l’évaluation des unités de recherche et des recherches individuelles. C’est en soi une bonne chose, d’autant plus nécessaire que le parcours professionnel, après le doctorat, implique des publications en nombre suffisant pour la soutenance d’une habilitation. Les choses ont changé du tout au tout depuis la disparition de la (grande) thèse d’Etat, œuvre parfois…d’une vie.
Vous avez fondé, avec feu Georges Molinié, l’équipe de recherche «Sens, Texte, Informatique, Histoire» (STIH) qui a réussi à se maintenir jusqu’ici. Quels sont les objectifs scientifiques de cette Equipe et en quoi est-elle utile pour les chercheurs ?
La création de cette unité fut en effet le fait de G. Molinié et de moi-même, en mars 1998. Comme G. Molinié devint Président de Paris-Sorbonne en mai 1998, j’ai immédiatement assumé la direction de cette équipe. Cela, jusqu’en 2011. Pendant ces treize ans, l’unité a augmenté son périmètre et modifié son nom : Sens et Texte ; Sens, Texte, Histoire ; Sens, Texte, Informatique, Histoire. Cet élargissement revenait à accueillir des chercheurs appartenant à d’autres unités appelées, elles, à disparaître. Dans les faits, l’unité STIH est devenue l’une des unités principales en linguistique (théorique, informatique, historique, stylistique…) de Paris-Sorbonne (devenue Sorbonne Université). Avec mes collègues, j’espère que toutes les publications qui procèdent (et continuent de procéder depuis 2011) des activités de cette unité ont été et sont utiles à la communauté des linguistes. J’ajoute que grâce à son budget, au demeurant assez modeste, l’Unité a permis d’aider de jeunes chercheurs, notamment dans la préparation et la publication de leur thèse. C’est quelque chose que nous ne connaissions pas voilà quarante ou cinquante ans.
Vous êtes le correspondant de «l’Académie des inscriptions et Belles Lettres». En quoi exactement consiste votre fonction ? Est-ce un premier pas vers l’obtention de l’épée de l’Académicien?
Les correspondants sont associés aux activités publiques des académiciens : ils peuvent présenter des communications au cours des séances et des comptes rendus d’ouvrages dans les revues publiées sous la responsabilité de l’Académie des Inscriptions.
Quant à l’élection comme académicien, c’est l’affaire des Académiciens et c’est à eux seuls de répondre.
Une dernière question : on sait que vous être très proche scientifiquement de l’éminent Professeur de la Sorbonne et Académicien Robert Martin. Ses travaux ont-ils apporté à vos propres travaux ? Avez-vous réalisé des travaux ensemble ? Lesquels ?
Martin est effectivement un modèle pour moi. C’est un linguiste très complet, qui associe des compétences en linguistique théorique, en grammaire historique et en lexicographie (Trésor de Langue Française et Dictionnaire du moyen français). Ce spectre de compétences est rarissime, d’autant que les travaux de Robert Martin dans tous les domaines cités se situent au niveau le plus élevé.
Sur le plan théorique et en ce qui concerne les travaux de grammaire historique, R. Martin a commencé par se situer dans la filiation guillaumienne. Significativement, il fut le successeur de Moignet sur sa chaire de Sorbonne (en 1979). Ses deux thèses (sur le système des temps narratifs en moyen français, d’une part, sur le mot rien, de l’autre, s’appuient sur la psychomécanique. Dans le courant des années 70, il s’en éloigne pour lui préférer une approche plus logicienne des faits de langue. R. Martin est en effet soucieux de parvenir à une formalisation aussi satisfaisante que possible du fonctionnement des faits en question. Or, il considère que la psychomécanique ne permet pas cette formalisation. On aborde ici un sujet délicat, de nature épistémologique, dans le détail duquel il est évidemment difficile d’entrer dans le cadre de notre conversation.