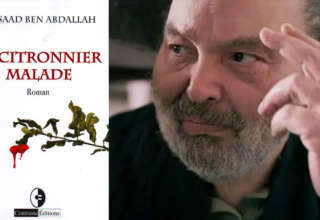Ce roman de Dorra Fazaâ, écrit dans une langue arabe des plus aisées et des plus élégantes, pleine de saveur et agrémentée quelquefois d’expressions du lexique familier, de brèves séquences dialogales et de courts poèmes, doit son éclatante réussite en grande partie à l’aptitude rare de son autrice à établir progressivement son empire sur nous autres lecteurs pour nous arrimer si bien, si fort, comme Shérazade savait le faire avec le sultan Shahriyar, à l’histoire qu’elle raconte, en prenant son temps, en pesant le poids de ses mots justes et de ses longues phrases enchanteresses…
Dès la mise en marche du processus narratif aux premières pages du chapitre inaugural — là où la somptueuse «Villa Allegra», le lieu central de l’action, ouvre sa grande porte aux invités et là où est annoncé le «casting» des personnages de premier plan —(le Général Chedli Chérif avec son inséparable chienne «Izis», sa fille Selma, son fils Khayem, son beau-fils Youssef Haddad, sa petite-fille Rita et enfin l’amie de sa fille, Shams)— nous nous trouvons irrésistiblement pris par ce roman de Dorra Fazaâ «Okhfi El Hawa» (J’occulte l’amour), embarqués dans l’aventure existentielle et sociale de ses protagonistes multiples, adjuvants et antagonistes divers, et complètement sous le charme désarmant d’une voix-off, celle de l’autrice. Une autrice-narratrice, une conteuse sans visage, dépassionnée, mais passionnante, qui, omnisciente, prend en charge, de part en part, toute la narration, nous fait vivre l’histoire à travers ses yeux et nous tient en haleine jusqu’au chapitre ultime, disséminant ici et là, dans son intrigue complexe et épaisse, un arsenal de techniques narratives : des éléments de mystère, des ajournements, des récits secondaires finement enchâssés dans l’intrigue principale —(le récit du tueur psychopathe de Rita dit «Spartacus», celui de la diplômée de l’université et chômeuse Rym, celui de l’aide-pharmacienne Amina habitée par une passion muette à sens unique et sans issue, celui de Adam récupéré par le «salafisme djihadiste», celui de Sam s’investissant dans la défense du droit de ses jeunes voisins de jouer au stade de son quartier populaire, celui de Nasrou travaillant sans conviction sur internet pour la propagande islamiste, celui encore de Saâd qui semble être entré dans la vie avec une puissance de mépris et avec qui la vengeance et l’abjection marchent toujours, un poignard à la main ; Saâd dit «Milichia» (Milice) s’improvisant, après la prétendue «révolution de la dignité», caïd «salafiste», etc.)—, des digressions qui ralentissent à dessein le tempo de la narration et imposent des effets d’attente de nature à ménager la surprise du lecteur, des ellipses pour accélérer de temps à autre ce même tempo ou vitesse de la narration, des «analepses» (retours en arrière) et du suspense qu’elle sait faire monter en climax et qui nourrit la tension narrative constamment recherchée et entretenue jusqu’au bout et jusqu’à nous empresser de dévorer, avec fébrilité, ces 392 pages pour y découvrir ce qu’il va se passer plus loin, toujours plus loin, en cheminant vers la clôture de ces nombreux destins scellés par quelque déterminisme social ou moral et de ces diverses intrigues non-linéaires, la principale (l’histoire d’une notable famille tunisienne de La Marsa, bourgeoise, libérale et francophile ) et les annexes, qui évoluent toutes en parallèle, se suivent, se croisent, s’embrouillent («Intrigue» : de l’italien «Intrigo» = «embrouillement») et s’interpénètrent dans les mêmes chapitres et sur les mêmes pages pour trouver enfin, les unes après les autres, leur dénouement, paisible ou violent, au chapitre quinzième. Chapitre qui clôture le roman et où l’«amour dissimulé» (Cf- le titre du roman emprunté à un vieux poème du poète arabe mystique du Soufisme Ibn Al-Faridh, 1181-1235, mis en exergue à l’entrée de ce livre), vieille de 40 ans, a soudain un goût de sang et de mort. Car, à la grande surprise du lecteur, l’ancienne amante espagnole du «Général» dont on attendait la troublante réapparition depuis déjà la fin du 2e chapitre (p.53), est lâchement assassinée, au musée du Bardo, un inoubliable 18 mars 2015, par une milice terroriste guidée à distance par le sanguinaire «Saâd Milichia» (p.392) ! Et voici donc que la détonation imprévue des balles de kalachnikov déchirant le silence du musée et se mélangeant avec les alarmes, la tonitruance des voix effarées et des cris tragiques des touristes piégés, nous arrache violemment à la tendre rêverie que nous donnent à vivre certains passages de ce roman, pour nous remettre face à la réalité crue et aux souvenirs cruels de notre méconnaissable Tunisie des amères années 2014-2015 dont Dorra Fazaâ a fait le cadre spatio-temporel de son histoire et dans lesquelles elle a puisé toutes ces passions retenues, camouflées, enfouies dans le silence, volées à l’ordre social : celle du Général Chedly nostalgiquement amoureux de l’absente Anna Rebecca Torres vilement tuée, au moment même où nous nous attendons à de merveilleuses retrouvailles amoureuses qui auraient triomphé du temps de l’absence et de la vieillesse ; celle de la psychanalyste Shams obsédée par le bel époux de sa copine Selma qu’elle a dans la peau, celle de Youssef Haddad que trouble l’amie de son épouse et pousse, presque malgré lui, à l’adultère, celle de Amina qui voue un irrépressible sentiment amoureux au mari de sa patronne Selma —toujours ce Youssef Haddad— !, celle du jeune Nasrou qui sent s’ouvrir son cœur à l’odeur exquise de Bochra, la femme du bordel, celle de cette dernière qui se prend d’affection pour un garçon plus jeune qu’elle, parce qu’il est le seul à l’aimer comme un être humain sans faire d’elle un vulgaire objet de plaisir tarifé, celle enfin de Khayam Chérif qui assume dans la culpabilité et la douleur son homosexualité sévèrement condamnée par son père et son ami Yahia qui ne veulent ni la comprendre ni, encore moins, la tolérer.
Mais dans cette Tunisie à l’image ici fort peu reluisante, parce que dangereusement marquée par la spectaculaire montée de l’obscurantisme religieux, l’autrice a puisé également des haines noires, celles, nombreuses et mortelles, que nourrit Saâd contre Sam à l’identité sexuelle trouble et qui le nargue, contre Rym qu’il ne parvient pas à soumettre à son pouvoir machiste, contre les anciens dirigeants du pays, contre la Gauche politique, contre les laïcs, contre les femmes libres, contre son passé misérable et même enfin contre son propre corps disgracié.
Pour terminer, disons-le sans plus tarder : Ce roman de Dorra Fazaâ, écrit dans une langue arabe des plus aisées et des plus élégantes, pleine de saveur et agrémentée quelquefois d’expressions du lexique familier, de brèves séquences dialogales et de courts poèmes, doit son éclatante réussite en grande partie à l’aptitude rare de son autrice à établir progressivement son empire sur nous autres lecteurs pour nous arrimer si bien, si fort, comme Shérazade savait le faire avec le sultan Shahriyar, à l’histoire qu’elle raconte, en prenant son temps, en pesant le poids de ses mots justes et de ses longues phrases enchanteresses à la progression cumulative, mais souple, en exaltant notre imagination, en augmentant le coefficient de la vraisemblance et en nous contraignant avec délicatesse à ne point lâcher son livre avant d’en connaître la fin et avant d’en sortir comme envoûtés, gagnés à sa «cause», mais étrangement triste d’avoir quitté cet univers fictif et ces êtres d’encre et de papier suscitant, les uns, l’admiration — (surtout la petite Rita se battant contre son propre corps mal fait et son complexe d’enfant mal aimée, la courageuse Rym se battant pour sa dignité de femme et de citoyenne et qui, quoique pauvre, ne succombe point aux avances de son voisin de quartier, corrompu jusqu’à l’os, qu’elle s’applique à ignorer le plus superbement possible, et enfin la très dévouée Amina vivant avec les illusions d’ un amour impossible qui met à mal ses valeurs religieuse et éthiques)—, les autres, le mépris et le dégoût même —(Nabil, le compagnon de Rym, qui s’avère opportuniste et qui lui préfère une femme riche au frère puissant, mais surtout Saâd Milichia, sans cesse absorbé par son ego malade, vicieux, hypocrite, retors et spécialiste des coups bas qui succombe, après l’arrivée au pouvoir de son parti obscurantiste, aux goûts bourgeois et aux honneurs risibles des parvenus tout en restant vulgaire). Des êtres pour la plupart défaillants, blessés ou insatisfaits en qui l’autrice-narratrice fait se rencontrer le réel vécu avec la fiction romanesque, la réalité avec les fantasmes, et qui nous tendent souvent un miroir pour y voir si quelque chose de nous-mêmes, de nos éventuelles amours secrètes, de nos désirs prohibés, de nos doutes, inquiétudes et difficultés sentimentales ne s’y reflète pas par hasard.
Dorra Fazaâ, qui nous semble avoir beaucoup travaillé sa matière verbale et narrative, le déroulement de son histoire savamment planifié et réalisé et ses personnages, tous bien conçus et construits, pour enfin réussir son pari de produire ce roman prodigieux auquel les lecteurs ont réservé un accueil des plus favorables et qui s’est déjà vendu en des milliers d’exemplaires, comme rarement d’autres romans tunisiens, a aujourd’hui assez de crédit littéraire pour que nous attendions d’elle d’autres romans, plus forts encore et plus beaux. Bravo !