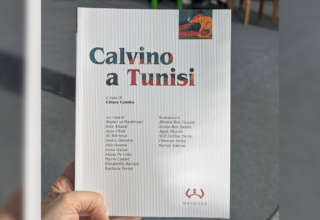Entretien conduit par Ridha BOURKHIS
Sa courageuse et difficile traduction de l’arabe en français de «Barg Ellil» (Éclair dans la nuit), le conte historique et philosophique célèbre, que le romancier tunisien Béchir Khraïef (1917-1983) a publié en 1961, est venue couronner le lumineux parcours de cette brillante universitaire tunisienne francophone et révéler, en même temps, son indéfectible attachement à sa «tunisianité» ouverte au monde et à ses écrivains et cultures. Samia Kassab-Charfi, qui est aussi poète et nouvelliste, a mérité plusieurs distinctions dont l’«Ordre National du Mérite-Éducation et Sciences», en 2005, le «Prix Zoubeïda Béchir» du Crédif, en 2009, le «Prix Tahar Haddad des études en littérature et sciences humaines», en 2019 et enfin «Chevalier de l’Ordre des palmes académiques», en 2020.
Samia Kassab-Charfi est Professeure de l’Enseignement Supérieur à l’université de Tunis 1. Titulaire d’un Doctorat d’Etat en langue et littérature françaises, elle est passionnée, comme rarement d’autres, de poétique et de littérature. D’aucuns, parmi les connaisseurs, pensent même qu’elle serait aujourd’hui sans conteste la meilleure poéticienne tunisienne, la plus compétente, la plus assidue et la mieux publiée. Même quand on ne la connaît pas de près, on devine, eu égard à ses multiples travaux et publications, que la recherche est pour elle un sacerdoce et que le travail est sa devise : son curriculum vitæ de plusieurs pages, particulièrement fourni et varié, presqu’à nul autre semblable, étonne au suprême degré. N’y sont pas mentionnés que ses diplômes de haut niveau, ses divers enseignements (stylistique, rhétorique, analyse du discours, poésie, littérature francophone, méthodologie de la recherche, etc.) au département de français de la Faculté du boulevard 9-Avril, à Tunis, ses cycles de conférences, participations à des jurys de thèses et cours bloqués dans de multiples universités de France, d’Amérique, du Canada et des Caraïbes, et ses nombreuses responsabilités dans le domaine de la recherche doctorale et académique, mais aussi les nombreux mémoires de Master et thèses qu’elle a dirigés, les ouvrages de qualité qu’elle a établis sur les littératures française et francophone («La Métaphore dans la poésie de Baudelaire», «Rhétorique de Saint John Perse», «Patrick Chamoiseau», «Art et invention de soi aux Antilles», etc.), mais aussi tunisienne, et qu’elle a réussi à publier quelquefois chez de prestigieux éditeurs français (Gallimard et Champion) et les innombrables articles et communications qu’elle a fait paraître dans des revues, dans des ouvrages issus de colloques internationaux et dans des collectifs publiés en Tunisie comme en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Hollande, au Maroc, en Angleterre, en Australie, en Amérique et à la Martinique. Deux de ses ouvrages ont été traduits, le premier en anglais et le second en japonais.
C’est tout cela qui meuble brillamment son itinéraire de professeure-chercheuse et qui, sans doute, force l’admiration. Une admiration qui est devenue, chez nous, plus forte, quand Samia Kassab-Charfi nous a agréablement surpris par sa publication aux éditions françaises «Honoré Champion», en 2012, du volume de 550 pages, grand format, qu’elle a composé «à quatre mains» avec son collègue de l’Université de La Manouba, le Professeur de littérature arabe Adel Khedher, sur «Un siècle de littérature en Tunisie (1900-2017)». Un ouvrage majeur constituant, après les écrits de feu Jean Fontaine sur la littérature tunisienne, une très bonne référence pour les chercheurs en la matière et qui vise à «donner une meilleure visibilité aux littératures contemporaines» plurielles et homogènes, produites dans notre pays, en langues arabe, française et, un peu, italienne, du début du XXe siècle aux premières années du XXIe.
Sa courageuse et difficile traduction de l’arabe en français de «Barg Ellil» (Éclair dans la nuit), le conte historique et philosophique célèbre, que le romancier tunisien Béchir Khraïef (1917-1983) a publié en 1961, est venu couronner le lumineux parcours de cette brillante universitaire tunisienne francophone et révéler en même temps son indéfectible attachement à sa «tunisianité» ouverte au monde et à ses écrivains et cultures.
Samia Kassab-Charfi, qui est aussi poète et nouvelliste, a mérité plusieurs distinctions dont l’«Ordre National du Mérite-Education et Sciences», en 2005, le «Prix Zoubeïda Béchir» du Crédif, en 2009, le «Prix Tahar Haddad des études en littérature et sciences humaines», en 2019 et enfin «Chevalier de l’Ordre des palmes académiques», en 2020. Interview :
Vous avez publié en mars dernier, à Sud Éditions, à Tunis, votre traduction en français du conte célèbre écrit en langue arabe par Béchir Khraïef, «Barg Ellil» . Pourquoi de toute l’œuvre majeure de ce romancier et nouvelliste tunisien, auteur surtout de «Eddegla Fi’arâjinha», «Mechmoum el fell», «Bellara» et «Hobbek Derbani», c’est ce conte-là que vous avez préféré retenir pour votre traduction ?
D’abord, je dois dire que c’est parce qu’on a donné «Barg Ellil» à lire au collège à mon fils que j’ai découvert ce roman extraordinaire. J’ai partagé cette lecture avec mon fils et je lui suis reconnaissante d’avoir contribué à cette belle aventure que j’ai vécu avec la traduction de ce chef-d’œuvre ! Je pense ensuite qu’outre le désir de «faire passer» Béchir Khraïef dans une langue autre que l’arabe, pour l’ouvrir à un lectorat plus large, la première motivation était que le héros est… noir. Comme il se trouve que j’enseigne la littérature francophone à l’Université de Tunis, j’ai voulu en quelque sorte le «tirer» vers mes étudiants et les problématiques que nous abordons en Master, notamment. Car en effet, Barg Ellil est une sorte de frère des personnages de la littérature francophone des Amériques noires que nous étudions, dans la mesure où il déploie toute une panoplie de ruses pour contourner les obstacles, les dangers qui se dressent devant lui. Ainsi, le détour, les stratégies obliques (comme lorsqu’il lit la Loi entre les lignes et trouve la brèche où s’engouffrer pour la transgresser), toutes ces tactiques sont l’arme de ces personnes minorées de l’époque (XVIe siècle), qui développent de par leur statut même de formidables capacités de résistance et de désobéissance subtile… Personnellement, je ne peux pas lire Barg Ellil sans y superposer les personnages de la littérature antillaise, comme celui de Ti-Jean L’Horizon par exemple, héros d’un conte de Simone Schwarz-Bart où, comme il est dit dans la 4e de couverture, Ti-Jean fait un voyage initiatique et «entre dans la gueule de la dévoreuse des mondes». Notre Barg Ellil est lui aussi un «marron», c’est-à-dire un esclave qui se révolte et lance à la gueule du monde «sa déclaration d’insoumission» (deuxième partie du roman). Lorsqu’il débarque à Tunis, c’est un tout jeune homme dépossédé : il n’a plus de patrie, plus de famille, plus de repères et il devient quasiment un SDF, un «driveur» dirait-on dans le monde antillais, qui va à l’aventure… Toutes ces choses ont fait que j’ai voulu rendre hommage à la sensibilité créatrice de cet auteur absolument unique qu’est Béchir Khraïef. En le traduisant, j’ai souhaité le rendre accessible à davantage de lecteurs, en pointant la modernité de l’écrivain, son sens aigu de la justice, lui qui aurait pu entamer un dialogue avec Aimé Césaire, dont ces vers de la tragédie «Et les chiens se taisaient» peuvent être lus comme emblématiques du personnage de Barg Ellil, et du contexte historique, très mouvementé, dans lequel il fait irruption : «Et il n’y a plus maintenant qu’un homme perdu, tragique comme un moignon de palmier dans l’émeute banale et le champ de la foudre.» (Césaire, Et les chiens se taisaient, 1956) …
La stylisticienne que vous êtes sait que dans toute écriture littéraire, il y a du «style», c’est-à-dire l’âme singulière de la mise en mots d’une pensée particulière dans une langue donnée. En traduisant ce conte de «Barg Ellil» écrit en arabe et empli d’expressions puisées dans le dialecte tunisien, comment avez-vous fait pour traduire, en même temps que la langue, le «style», en ce sens l’humour, la «tunisianité», les connotations, c’est-à-dire en somme tout l’univers psycho-mental et culturel dans lequel baigne l’idiolecte de l’auteur et au niveau duquel il s’avère souvent, chez d’autres, que «Traduire, c’est trahir» ?
Ah, c’était à la fois un pur bonheur et un supplice ! Même si je ne crois absolument pas à l’intraductibilité et que je pense qu’on peut tout, absolument tout traduire, je ne peux pas nier la résistance de ce texte magnifique, de par sa diversité stylistique justement, à la traduction. Mais il faut malgré tout traduire, parce que la traduction ébranle le narcissisme culturel (c’est Antoine Berman qui le montre très bien) et parce qu’elle élargit considérablement le territoire des lecteurs («Barg Ellil» pourra être lu par un francophone au Québec, en Belgique, etc.). La traduction nous grandit, nous amplifie…Traduire le «patrimoine» tunisien, c’est une spécificité de la littérature : c’est une forme d’«export» qui contribue à valoriser notre capital culturel ! Avec les arts, la cuisine, la musique et les images positives de Tunisie que vous pouvez transporter hors de Tunisie, eh bien, vous avez la littérature, qui est un pôle central de l’économie du savoir dans notre pays ! En ce sens, les éditeurs devraient travailler de concert avec le ministère des Affaires étrangères et celui de la Culture, évidemment. J’en profite d’ailleurs pour rendre hommage au travail remarquable de Sud Éditions et à Mme Monia Masmoudi qui a tout fait pour permettre la traduction de ce très beau roman de Béchir Khraïef. Pour revenir à la difficulté de la traduction, ce sont surtout les locutions idiomatiques, celles où se concentre la quintessence de notre âme tunisienne, qui ont été ardues à faire passer en français ; mais en même temps, les distorsions qui ont été faites sont le prix à payer pour «porter» l’œuvre sur le marché francophone, pour en prolonger encore la postérité et parce qu’elle est absolument magnifique ! D’ailleurs, je pense qu’il faut absolument la traduire en anglais aussi !
On sait que Béchir Khraïef a toujours été dans ses écrits contre toutes sortes de ségrégations et de violence. Cela a-t-il été l’une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de traduire «Barg Ellil» où il s’agit de l’histoire d’un esclave noir aux prises avec les préjugés, les inégalités, l’hypocrisie et la marginalisation et où ce romancier condamne implicitement les discriminations tant sociales que raciales ?
Oui, c’est cette composante anti-raciste et féministe de Khraïef qui m’a séduite. J’aime à dire que Béchir Khraïef est selon moi l’écrivain le plus féministe de la littérature tunisienne arabophone et francophone au XXe siècle. Quand on lit ses «Œuvres complètes» (elles sont disponibles chez Sud Éditions avec des introductions et des annotations du Pr Fawzi Zmerli qui a magnifiquement mis en valeur et élucidé pour nous la poétique de cet écrivain), on se rend compte qu’il n’y a pas une seule œuvre où il ne représente pas un «subalterne». Certes, la société qu’il dépeint est faite de ces êtres de l’ombre, marginalisés et souvent violentés, mais qui font preuve d’intelligence et de débrouillardise. Contrairement aux «grands», qui comme dirait Beaumarchais «se sont donné la peine de naître», ils bataillent pour avoir droit à un mode de vie qui leur convient, pour trouver une petite place au soleil… Or, souvent, et c’est ce que j’adore chez Khraïef, ces personnages font tout pour transgresser non seulement les lois sociales discriminantes mais aussi, les lois du genre… Khraïef se donne ainsi un malin plaisir à décrire, dans le détail du détail, ce que ressent un homme quand il s’introduit dans l’univers fermé, surprotégé, des femmes. Or, cet homme n’est pas dans un rapport pervers ni voyeur, il découvre au contact des femmes quelque chose qui est à l’antipode de la brutalité et du manichéisme masculin : c’est explicite dans le roman. Ce n’est pas un hasard si dans «Barg Ellil», parmi la multiplicité des lieux, il y a les patios, certaines chambres même, et Dar Jwed… Or, cette posture, que j’identifie pour ma part comme une posture militante, courageuse, c’est la posture même qu’il adopte dans son style ! Car que fait Khraïef quand il écrit ? Il fait entrer le loup dans la bergerie (rires)… Autrement dit, il infiltre la langue dialectale (al ‘ammiyya) dans le giron de la langue régente, de la grande langue classique, littéraire, arabe. Il le dit parfaitement en 1959 dans un article théorique qui s’intitule «Khatar al fusha ala al ‘ammiyya» et que j’ai traduit en français pour une revue canadienne. Ce merveilleux Khraïef fait avec la langue dialectale ce qu’il fait avec ses «subalternes» : il la met sur le devant de la scène, il lui donne droit de cité et je dirais même qu’il l’anoblit. De marginale, il en fait une héroïne. Bien sûr, en tant que femme, je suis très sensible à la bienveillance sincère de Khraïef, à sa solidarité avec les femmes, mais au-delà de sa bienveillance, c’est à son génie qu’il faut rendre hommage parce que c’est l’un des rares écrivains qui a pointé, au cœur même de son écriture, ce cumul de discriminations. Toute sa poétique est ainsi dédiée à ces causes «intersectionnelles», propres aux instances qui dans la société sont impactées par plusieurs types de discriminations — y compris notre langue dialectale !
La francophone que vous êtes a bien surpris, en 2019, les lecteurs par un ouvrage sur «Un Siècle de littérature en Tunisie (1900-2017)» (Paris, Champion) où la littérature en langue arabe de Tunisie occupe la plus grande partie des 550 pages de cet ouvrage que vous avez fait avec Adel Khedher et qui vous a requis, à vous deux, beaucoup de recherches et plusieurs années de patient labeur. D’où vous est venu soudain cet intérêt pour la littérature tunisienne, après une si longue carrière universitaire au cours de laquelle vous vous êtes illustrée plutôt par vos études sur Charles Baudelaire, sur Saint John Perse ou encore sur Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau ?
Ah, c’est une question intéressante…En fait, comme vous l’avez dit, j’ai beaucoup travaillé sur la littérature française, pour me former et parce que ma directrice de thèse était spécialisée dans ce type de corpus. Pour vous répondre franchement, je dirai les choses suivantes. D’abord j’ai pris conscience il y a une dizaine d’années que notre manière de faire de la recherche était beaucoup trop monolingue, ou «franco-centrée». Or, je ne pense pas que l’on puisse, en Tunisie, continuer à faire de la recherche en littérature en restant dans une perspective exclusivement monolingue. J’avais de plus en plus de mal avec cet ostracisme et c’est la raison pour laquelle nous avons d’un commun accord, Adel Khedher et moi, choisi de travailler dans une perspective inclusive. Qu’est-ce qu’une perspective inclusive ? C’est une perspective qui vous mène à considérer un corpus en français dans ses liens, sa contiguïté avec les corpus de langue arabe, et même de langue italienne, produits dans la même aire. Ensuite, il y a le fait que les œuvres de langue arabe, dont je connaissais certaines, classiques, me «manquaient» dans ma pratique de chercheuse. Je sentais qu’il y avait un «truc» très important qui m’échappait. Grâce à ce projet — et je remercie Adel de m’avoir ouvert «la barrière de corail» en me permettant d’accéder à des œuvres de langue arabe que je ne connaissais pas et qui se sont révélées lumineuses ! —, j’ai découvert un archipel passionnant : celui des «littératures de Tunisie», où des écrivains d’origines et de langues différentes ont gravité autour de problématiques plus ou moins communes. Personnellement, je trouve dommage de continuer à travailler sur des écrivains tunisiens de langue française sans les mettre en dialogue avec des écrivains tunisiens de langue arabe ! Pourquoi cette ségrégation ? N’aurions-nous pas tendance à reproduire une forme de complexe de supériorité lié à l’usage de telle ou telle langue ? Or, notre rôle en tant que profs, en tant que chercheurs, ce n’est pas de reproduire, mais de faire bouger les lignes, et au-delà, de donner confiance à nos étudiants pour qu’ils investissent cette plateforme commune. Pour qu’ils tracent dans d’autres pistes que celles où nous avons déjà tracé…