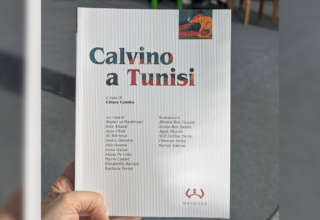Le plus essentiel et le plus fort dans l’art de ce roman de Dorra Fazaâ, ce n’est pas uniquement l’intelligente construction des personnages et leur habile mise en scène, mais aussi et surtout le suspense aux effets puissants que cette romancière d’exception sait parfaitement ménager en intensifiant la fragmentation et la discontinuité dans le découpage de la structure narrative et en établissant volontairement ce délicieux «désordre» narratif qui, loin de lasser le lecteur, attise de plus en plus son désir d’aller jusqu’au bout de l’histoire en le maintenant sous une tension constante…

Il y a des larmes et du sel dans le premier roman entre tous remarquable de Dorra Fazaâ, «Chaïon mina el bahr fina» (Quelque chose de la mer en nous). Des larmes et du sel que révèle discrètement ce titre métaphorique et qui tombent, au chapitre inaugural, des yeux de Alya, la mère de Béchr Limem par qui le malheur arrive :
«Comme elle n’a jamais pleuré depuis des années, un fleuve abondant éclata dans les yeux de la femme qui a essayé de ne jamais renoncer; du sel brûlant coula sur les blessures des années, les revers des jours et les défaites du temps. Elle a pleuré comme une enfant (…). Sans résistance, elle a abdiqué espérant laver les souillures de sa vie. Elle croyait que les larmes sont capables d’effacer les péchés et qu’elles sont une once de la mer en nous, la mer qui nous purifie par son flux et reflux nous inonde, nous noie et nous distrait… Celles-là sont les larmes, quelque chose de la mer en nous». (pp. 12-13).
C’est que sous la boue intérieure dans laquelle patauge l’ethos de ce redoutable personnage de premier plan qui apparaît de manière discontinue, mais marquante, dans presque tous les chapitres du roman, il reste quelque chose d’humain qui demande encore à être purifié par ce liquide lacrymal ayant quelque chose de la mer (le sel) purificatrice, quand le destin se retourne soudain et sort ses griffes pour frapper, blesser à mort et laisser des stigmates indélébiles sur l’âme et le corps.
Mais rien n’y fait ! Car cette problématique femme du monde, Alya Abess, a beau pleurer à chaudes larmes, lorsque lui parvint la triste nouvelle de l’accident mortel de son fils chéri, sa purification par les larmes et leur sel ne serait pas de si tôt : personnage «dégradé» (en termes de Georg Luckàs) «dont l’aventure profonde est la recherche dégradée» (Ibid.), non pas vraiment de «valeurs authentiques» (Ibid.), mais des «valeurs» inauthentiques, superficielles, éphémères, du «monde lui aussi dégradé» (Ibid.) de l’argent, des apparences et de l’artifice, Alya, venimeuse et à l’ego gravement hypertrophié, va continuer à nous sidérer, le long de ce roman, surtout par l’étrange turpitude de son esprit qui n’a de semblable que celui de son enfant. Celui-là qu’elle a trop aimé et protégé, trop possédé et «castré», qu’il est maintenant coincé dans les cordes d’un insurmontable complexe d’Œdipe. Prodigieusement avancé, lui aussi, en perversion et en monstruosité presque naturelle, ce beau monstre fait à son image a hérité d’elle son venin, sa condescendance blessante et la vanité qu’elle semble tirer du mépris qu’elle affiche aux autres d’où qu’ils viennent. D’elle, il a hérité surtout cette formidable puissance du Mal qui l’habite. Avec elle, ses rapports sont sado-masochistes et il les transpose, par une sorte de vengeance presque consciente, presque délibérée, sur ses amantes ou plutôt poupées qu’il aime casser aussitôt qu’il en a joué et en a joui à fond.
Litissia (ou Comba), la servante noire de sa maman, la «sans-papier» exploitée dans tous les sens et faisant régulièrement l’objet d’intimidation et de chantage, en sait quelque chose, elle qui est engagée par sa maman pour satisfaire aussi ses caprices sexuels de «pervers narcissique».
Mais Ghada en sait beaucoup plus ; la très belle et convoitée Ghada, l’«instagrammeuse» et jeune comédienne qui représente, elle-même, un personnage «dégradé» à sa façon et qui tomba un soir sous l’irrésistible charme de ce rouquin aux yeux bleus qu’est Béchr et se laissa vite attirer à son univers de fantasmes et de domination sexuelle sans âme, avant d’emprunter le chemin difficile et lumineux de sa propre purification. Purification via la retenue ou «l’ascèse», via l’éloignement des fallacieuses lumières et des honneurs factices, ainsi que par la voie fabuleuse de l’amour vrai, celui qu’elle aurait tant aimé vivre avec l’avocat quinquagénaire, vieux militant politique de gauche, Menef. Lui-même quelque peu «dégradé» par ses déconfitures politiques ainsi que par les concessions graves qu’il fait, à son corps défendant, sur ses valeurs cardinales d’égalité et de justice, afin de répondre aux demandes pressantes et embarrassantes de Alya. Cette sœur démoniaque qu’il exècre autant qu’il affectionne, qui le repousse autant qu’elle l’attire et qui finit toujours par le manipuler comme elle manipule tout le monde autour d’elle, dans les hauteurs de son aristocratie décadente livrée au pouvoir de l’argent et au trafic d’influences. Un trafic sale dénonçant une société tunisienne «dégradée», gangrenée par la corruption et le favoritisme auquel Menef essaye de résister comme il peut en poursuivant, lui aussi, sa quête d’une pureté éthique et sentimentale qu’il n’a plus vraiment atteinte depuis la mort entre ses bras de son amour Ramla.
Ramla, cet autre personnage du roman, absente mais présente par le rayonnement post-mortem de son âme, par son souvenir toujours incandescent, presque mythique et spectral ; qui gît dans la mémoire de Menef, cadenasse son cœur et l’empêche d’épouser Hind, en dépit de la pureté de la passion qu’elle lui voue et qui a consumé toute la fraîcheur de jeunesse de celle-ci. Tuée par les balles de la police vraisemblablement lors des manifestations populaires, à Tunis, du «Jeudi noir» (26 janvier 1978), idéalisée, sacralisée, mythifiée même, Ramla est la prison secrète dont Menef, cet éternel célibataire, avait fermé la porte sur lui-même depuis des années. (p. 442).
D’autres personnages purs ou moins impurs, blessés ou blessants, se succèdent ou se croisent dans ce court et brûlant fragment d’histoire tunisienne s’étalant du 1er septembre 2012 au 8 février 2013, et au fil des 18 chapitres de ce roman à l’intrigue plurielle ou éclatée et où la composition narrative se met en place, non pas grâce à une construction linéaire et progressive, mais grâce à un étonnant «déséchafaudage» (Michel Collot) auquel procède systématiquement l’autrice-narratrice s’appliquant à faire le montage, presque cinématographique, de son roman en déconstruisant la linéarité chronologique des événements narrés, en introduisant dans la narration, comme dans les scénarios aux techniques desquels Dorra Fazaâ est rompue, des va-et-vient, des digressions, des rebondissements, des suspensions ou des coupures, des analepses ou des rétrospectives et en effaçant les frontières entre les lieux, les intrigues parallèles, les plans narratifs et enfin ces personnages, tous bien conçus et faits, tous captivants, émouvants même, malgré la splendide laideur intérieure de certains parmi eux, tous disent, chacun à sa façon et selon sa «caste» ou sa position sociales, cette Tunisie, particulièrement «dégradée» de l’après «révolution de liberté» ou «de dignité» ou encore «de jasmin» ou plutôt d’impostures et d’assassinats politiques : dégradants au suprême degré !
Investie de valeurs positives tels l’amour de la patrie, la liberté et la modernité, la jeune Nour Abdelkader dont le sang et les larmes de douleur et d’injustice coulent dès l’ouverture de ce roman, est autrement plus pure que tous : portant bien son prénom ou plutôt aptonyme (en arabe «Nour» = «Lumière») et trônant dans cette histoire en «héroïne» positive aux antipodes de ces autres personnages négatifs faits pour salir, pervertir et détruire : Béchr qui l’a violentée et humiliée injustement, à l’entrée du roman, en vue de se venger de sa propre mère à travers son corps à elle, martyrisé et jeté par terre comme une ordure, Alya qui a fait intervenir ses relations pour bloquer la procédure judiciaire qu’elle a engagée contre cet agresseur, et Adel, son frère, animé de vieilles rancunes contre la société tunisienne discriminatoire qui l’avait réduit au rejet et à «l’invisibilité», mais aussi d’une profonde frustration sexuelle, et qui devint «salafiste jihadiste» et se fit tirer comme un lapin par les forces tunisiennes de l’anti-terrorisme.
A l’opposé de Adel dont presque personne n’a regretté la sanglante disparition, il y a Salim, un personnage plutôt pur, qui mourut en héros dans un combat contre des terroristes et que la narratrice-autrice investit de fortes valeurs symboliques constructives, telle sa vaillante sœur Nour, telle sa brave mère Meryem qui prépare tous les jours, à l’aube, du pain (de la vie) dont elle fait vivre sa famille déshéritée et qui trouve en Chokri Bel Aïd, dont l’image discrète parcourt et boucle tout le roman, son idole politique, le libérateur promis de sa classe sociale et le seul «Chahid» (Martyr) qui mérite ses larmes.
Mais le plus essentiel et le plus fort dans l’art de ce roman de Dorra Fazaâ, ce n’est pas uniquement l’intelligente construction des personnages et leur habile mise en scène, mais aussi et surtout le suspense aux effets puissants que cette romancière d’exception sait parfaitement ménager en intensifiant la fragmentation et la discontinuité dans le découpage de la structure narrative et en établissant volontairement ce délicieux «désordre» narratif qui, loin de lasser le lecteur, attise de plus en plus son désir d’aller jusqu’au bout de l’histoire en le maintenant sous une tension constante. Là, dans cette superbe et permanente manipulation du suspense à la Hitchcock qu’elle continue à mettre en place jusqu’au paragraphe ultime de ce roman (p 482 : le cadavre du moniteur de gymnastique, amant passager de Alya, jeune marié, qui flotte sur un lac par une nuit noire et dont le tueur est enveloppé dans le mystère !), Dorra Fazaâ nous paraît très douée qui s’ingénie à nous impatienter et nous faire, non pas lire son roman, mais le dévorer, comme d’ailleurs dans son deuxième roman «Okhfi el Hawa» (J’occulte l’amour) où elle fait preuve aussi de ce même talent très avantageux lui permettant de nous entraîner dans tous les extrêmes de l’émotion et de la jouissance littéraire (cf-notre papier et notre interview avec D. Fazaâ dans ce journal du 6/5/ et du 3/6/2023).
Pour terminer, ce roman à la langue fluide qui ruisselle de saveur, bien que constituée de phrases pour la plupart verbales et complexes, souvent croissantes et amples, sans jamais être ampoulées et lourdes, qui s’étendent sur des paragraphes entiers, est en réalité infiniment plus beau et saisissant que cette bien modeste présentation ! A lire absolument !
Dorra Fazaâ, «Chayon mina el bahri fina», Tunis, Editions Sindbad, 2020, 482 pages. ISBN : 9 789938 958546. Prix Fondation Abdelwahab Ben Ayed (FABA) 2020.