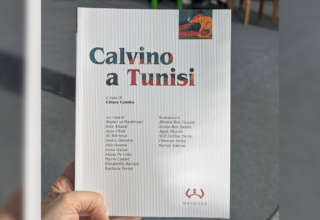« Beaucoup plus qu’un livre d’histoire, la Muqaddima est un projet intellectuel pour une compréhension globale de l’urbanisme, des dynamiques du pouvoir et des transformations sociétales », a déclaré la Sud-Coréenne Karima Kim, lauréate du Prix Ibn Khaldoun pour la promotion et la recherche dans les sciences humaines 2025 (catégorie « International »), pour sa traduction de la Muqaddima en langue coréenne.
La professeure coréenne s’exprimait lors de la cérémonie de remise du prix organisée mardi au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres, à Ksar Saïd, Tunis. Ce prix est attribué par la Chaire ICESCO « Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine » de Ksar Saïd, en partenariat avec l’association Med21.
Le comité d’évaluation, composé des historiens Abdelhamid Larguèche (président), Latifa Lakhdar et Faouzi Mahfoudh, a également attribué deux autres prix : au Franco-marocain Mehdi Ghouirgate (catégorie « Méditerranée ») et au Tunisien Moncef M’halla (catégorie « Pays d’accueil »).
Deux prix honorifiques ont par ailleurs été décernés à titre posthume aux professeurs tunisiens Ahmed Abdessalem et Aboul-Kacem Mohamed Kerrou, en présence des membres de leurs familles respectives.
Dans son intervention intitulée La Muqaddima, un pont entre les langues et les civilisations, Karima Kim a affirmé que « la pensée d’Ibn Khaldoun dépasse son cadre spatio-temporel. Elle propose des outils d’analyse qui demeurent utiles à notre époque ».
Bien plus qu’un historien du passé, « en Corée, Ibn Khaldoun est aujourd’hui considéré comme un penseur contemporain, porteur d’une vision critique et d’un esprit ouvert sur l’autre ».
Elle a qualifié la Tunisie, pays natal d’Ibn Khaldoun, de « lieu de mémoire, mais aussi de pensée vivante et d’innovation ». Elle y voit un pays tourné vers l’avenir, guidé par la pensée khaldounienne « comme un flambeau vers de nouveaux horizons ».
Karima Kim est revenue sur les conditions ayant entouré sa traduction, entamée en 2005. Elle dit avoir été animée par un sentiment de devoir envers le lecteur coréen, afin de transmettre la profondeur de la pensée d’Ibn Khaldoun dans leur langue.
Cette traduction est le fruit d’un long voyage intellectuel et culturel qu’elle qualifie d’expérience personnelle, dépassant le simple cadre académique.
Professeure de littérature arabe à l’Université de Hong-Kong des études étrangères de Séoul, Karima Kim est spécialiste de la littérature de la maqâma et de la littérature arabe contemporaine de la diaspora. Titulaire d’un doctorat portant sur l’œuvre d’al-Jahiz, notamment Al-Boukhala (Les Avares), elle rappelle qu’al-Jahiz (Abû Uthmân Amr Ibn Bahr al-Basrî), érudit irakien du IXe siècle, fut une figure majeure de la pensée arabe.
L’idée de traduire la Muqaddima est née d’une conviction intime : cette œuvre constitue un pont entre civilisations et ouvre de nouveaux horizons pour le dialogue entre l’Asie de l’Est et le monde arabe.
Elle a toutefois reconnu les contraintes liées à ce travail, notamment linguistiques, lexicales, et culturelles. Le style dense, les références historiques et les contextes propres au monde arabo-musulman ont nécessité un équilibre rigoureux, dans le respect du texte original.
Cette traduction a nécessité six années de travail, soit davantage que le temps qu’Ibn Khaldoun lui-même aurait mis à rédiger son manuscrit.
La version coréenne de la Muqaddima a connu un grand écho dans les milieux académiques et culturels de Corée du Sud. Sa publication a été largement médiatisée, suscitant un intérêt croissant pour la civilisation islamique et la pensée arabe.
L’ouvrage sera au cœur d’une conférence filmée cet été dans le cadre des classiques de la littérature mondiale présentés à l’Université nationale de Séoul.
En 2020, la version coréenne figurait parmi les œuvres primées du prestigieux Prix Sheikh Hamad pour la traduction et la compréhension internationale, décerné au Qatar. Une reconnaissance pour cette œuvre monumentale née au sud de la Méditerranée et désormais traduite vers de nombreuses langues, dont le coréen.
Véritable vecteur d’interculturalité, « la traduction ne se limite pas à transmettre les mots, estime la professeure Kim. Elle est un outil pour comprendre l’autre et construire des ponts entre les esprits et les cultures ».
À travers cette œuvre, elle dit avoir voulu offrir un aperçu de la profondeur de la pensée arabe et de la richesse de sa civilisation.
Karima Kim a conclu en souhaitant que cette rencontre jette les bases d’un « dialogue constant entre Orient et Occident, entre langues et cultures, dans un esprit de compréhension et de respect mutuels ».