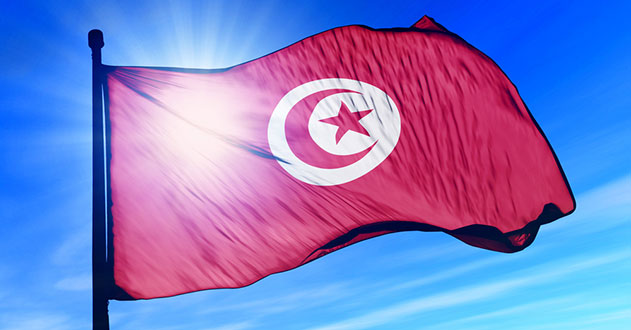
«Bientôt je quitte… fin 2021, au début de 2022, etc». «Ici je déprime, ici je suffoque». «Je crains pour l’avenir de mes enfants». Bien des voix s’élèvent, ces derniers temps, dans le train, dans le métro, à bord d’un bus ou d’un taxi, et jusque dans le sud, jusque dans le nord du pays. Cela est un signe.
La Tunisie, terre qui nous unit, est aujourd’hui à un tournant. Toutes les raisons de s’effondrer et toutes les autres de se relever sont plutôt réunies. Les plus pessimistes pour qui « le pays ne se relèvera jamais » ont fini par quitter le navire. Alors que ceux qui sont restés continuent de lutter. Ils le font au prix de leur bonheur, leur confort psychique.
Les chiffres esquissent, jusque-là, un camaïeu de gris. D’autant plus que 40% des Tunisiens qui ont émigré vers les pays de l’Organisation de coopération et de développement économique (Ocde) entre 2011 et 2016 étaient titulaires de diplômes universitaires, selon le Centre de Tunis des études stratégiques (Ctes). Le syndicat des médecins de la santé publique, lui, estimait à 800 le nombre de médecins qui auraient émigré, tous les ans, au cours des dernières années. Et la pandémie est venue mettre à nu les graves conséquences de cette fuite de cerveaux.
Pis encore. Quelque 4.000 ingénieurs ont quitté le pays, d’après des statistiques officielles. Et quelque 63% des résidents de la première promotion de médecine de famille (MF) à la faculté de Médecine de Tunis (FMT) planifient une carrière à l’étranger, selon une enquête interne. In globo, près de 78 % des compétences souhaitent quitter le pays, d’après un récent sondage du Ctes.
Les questions qui se posent
Pourquoi un tel exode, une telle érosion, cette assassine fuite de cerveaux ? La Tunisie est-elle devenue invivable ? Les Tunisiens sont-ils désormais ingouvernables ?
Toutes ces questions trouvent réponse dans ce que nous vivons depuis bientôt trois décennies et demie. Trois décennies et des politiques à peu près identiques. Une école publique qui éduque mal et qui forme passablement. Un système de santé pour les riches et un autre pour les pauvres. Une justice loin d’être indépendante du fait de l’interférence des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Des gouvernants qui s’égarent en cherchant des explications à des événements chaotiques quand ils ne versent pas dans la paranoïa (répétition voulue, se référer à la rubrique du 16 juin dernier). Et des Tunisiens qui, novices en démocratie, font souvent preuve d’un cynisme aveugle et irrationnel, envers tout ce qu’on leur raconte.
Conjugués ensemble, ces facteurs suscitent déception, détresse et désespoir. Ceux qui ont peiné à prendre leur mal en patience sont partis chercher leur bonheur ailleurs.
Un long chemin pour ceux qui restent
Pour ceux qui sont restés, ceux qui refusent de baisser les bras, le chemin sera long. Et un combat de longue haleine est une condition sine qua none pour le sauvetage de la République, des enfants de la République. Ces enfants valeureux du pays réalisaient l’ampleur des défis à relever. Pourtant, ils sont restés dans ce pays où l’on y manque de tout, où peu de choses fonctionnent.
Ces Tunisiens qui admettent que le pays n’est pas le régime en place, mais plutôt le berceau de l’enfance, la terre des aïeux, des proches, les rues et ses coins qu’on traversait autrefois hilare, les médinas et leur chant tantôt diurne tantôt nocturne, ont aujourd’hui besoin de croyances nouvelles. Des croyances nouvelles en mesure de consolider le ciment de l’appartenance nationale. Des croyances nouvelles pour ne plus croire que ceux qui continuent à vivre en Tunisie ne sont que des morts sans sépultures. Des morts que même la mort a refusés.
Ces mêmes Tunisiens ont besoin de nouvelles croyances pour entendre qu’ils n’ont désormais besoin ni du privilège de la lignée, ni de parents aux comptes bancaires bien garnis pour poursuivre leurs études dans les grandes universités internationales.
Ils ont, de surcroît, besoin de ces croyances pour admettre que le pays a vraiment entamé sa métamorphose. Une vraie métamorphose qui rompt définitivement avec les régimes qui réverbèrent la géographie des inégalités économiques, éducatives et culturelles.
Démocratiser la consommation culturelle et esthétique
Aujourd’hui, le Président de la République a ratissé large pour assainir la condition humaine sous nos cieux, il serait encore plus judicieux de se référer à l’histoire pour s’inspirer des expériences les plus réussies. Il y a lieu ici de revenir sur le projet émancipateur des Bolcheviks (membres d’une des deux factions du Parti ouvrier social-démocrate de Russie). L’on s’intéresse ici à un axe majeur de la politique de cette mouvance, notamment le fait de miser sur la démocratisation du savoir et de la consommation esthétique pour l’éducation du goût et l’exercice de la pensée.
Autrement dit, lorsque Lénine a lancé, en 1917, une campagne de démocratisation du savoir, son pays (la Russie) était plongé dans une guerre civile. Malgré le manque criard de moyens, on enseignait dans des granges, des usines, des fermes, des tentes de nomades, des bâteaux, etc. Partout en Russie, s’organisaient des salles de lecture où des gens du peuple côtoyaient les représentants de l’ancienne intelligentsia (couche sociale russe dont les membres en possession de diplômes d’éducation supérieure avaient la capacité de cerner les problèmes de la Russie et de ses aspirations révolutionnaires).
Plutôt entravés qu’arriérés, les Tunisiens, y compris ceux des quartiers pauvres, des villages et bourgades, ont, au demeurant, besoin de penseurs engagés et de gouvernants éclairés, capables de montrer la voie. La nouvelle voie devra puiser dans de nouvelles croyances ayant pour maîtres mots : démocratisation du savoir, démocratisation de la consommation culturelle et esthétique. Car «on façonne les plantes par la culture et les hommes par l’éducation», si l’on se fie à l’Émile de Rousseau.











