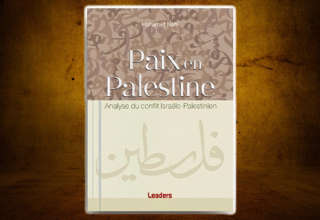«Ashkal», ce premier long-métrage de Youssef Chebbi, a remporté l’Antigone d’or, le prix de la critique et le prix de la meilleure musique au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2022. Il a été, également, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2022. «Ashkal» est un film dérangeant, qui nous prend en haleine, baigne dans le cinéma de genre entre enquête, polar et science-fiction.
«Ashkal» est fait d’une image froide et terne à la texture grossière dessinée par le directeur photo Hazem Berrebah, d’une image qui fusionne avec les décors de Malek Gnaoui, d’un montage réalisé par Valentin Feron et d’une bande-son signée Thomas Kuratli qui secouent sans s’imposer au premier plan. Et d’une interprétation des plus remarquées de Fatma Oussaifi et Mohamed Hassine Grayaa.
Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.
Dès les premières images, une succession de plans fixes, les formes sont là, présentes, imposantes, froides, inachevées. Les textures sont rêches, du béton, du ciment et des ouvertures béantes. L’univers glacial et hostile nous communique cet étrange sentiment d’angoisse. Le film ne nous laisse pas facilement pénétrer sa trame, il nous laisse sur le seuil de l’histoire qui ne commence pas, mais dont les éléments commencent à nous happer par bribes, par fragments. Pourtant, nous nous laissons prendre par le silence de la Fatma, la policière, par son visage expressif, son regard troublé, par cette image de femme dans la grisaille, un corps vibrant, retenu, émotionnellement ébranlé.

«Ashkal» est une teinte, une image faite d’un pigment terne, et de relief, un relief qui égratigne, qui abîme et balafre. C’est cette structure sans âme, que des âmes se perdent. Le feu d’immolation des corps en est la seule source de chaleur.
Des corps qui brûlent, qui s’enroulent, se décomposent et s’effacent, illuminent les visages blêmes et se reflètent dans les pupilles des personnages en stupeur. Résoudre l’énigme n’est pas forcément un désir de comprendre, de déchiffrer et de classer l’enquête, mais un moteur pour donner de l’épaisseur à un état de délabrement. Le fait divers en devient un phénomène, un mystère tentaculaire entre corruption, exploitation, misère et pots-de-vin. Mais dans un exercice de style et avec une telle fluidité, le film bascule dans un univers quasi onirique, fantastique avec un personnage sans visage, sans identité, sans empreinte, qui se consume à répétition dans une pratique incontrôlée, comme s’il créait une chaîne de chaleur, dans laquelle le feu est un moyen d’effacer le passé et de revendiquer un avenir. Table rase par le feu, le feu comme purificateur, le feu comme source d’énergie. Le feu qui remet le compteur à zéro avec ce troisième personnage dont on voit juste les mains, cet homme qui brûle sans être détruit et qui gagne progressivement en importance, au point d’en venir à kidnapper le film…
«Ashkal», qui tourne le dos aux clichés habituels, pose la main sur d’autres et en détourne le sens. Et comme il l’explique d’ailleurs dans une interview: «Je ne vois pas le feu uniquement comme une entité destructrice. C’est aussi une entité accueillante, qui permet une sorte d’élévation, ou de révélation, une autre forme d’existence… La fin est une allégorie de la religion, ou de la façon dont elle est vécue en ce moment en Tunisie. La religion est pleine d’histoire, de racontars, d’interprétations, de légendes auxquelles s’abandonnent ceux qui se lancent dans le feu… Ils marchent vers ce qu’ils conçoivent comme une vérité. Ce n’est donc pas nécessairement une scène de suicide collectif. Et j’aime que Fatma y figure en position de témoin. On ne sait pas si elle va suivre les autres ou garder son esprit critique».
L’étrangeté de cette œuvre nous met dans une situation d’inconfort, d’inquiétude, où toute bizarrerie devient crédible. Et de notre posture de spectateur distant que nous prenons dès le début, nous nous retrouvons, tel le personnage de Fatma, témoins certes, mais pris au piège. L’histoire, ou l’intrigue, se referme comme un étau sur nous, jusqu’à devenir, dans la séquence finale du film, dans un état de borderline, pour basculer dans un sens ou dans un autre. Dans la posture du témoin, ou celle de l’illuminé qui suit le mouvement de groupe. Sans jugement, aucun des deux postures que propose «Ashkal» n’est recevable, chacune donne suite à une piste différente de lectures. Faites la vôtre. «Ashkal» est frappant par les révélations qui nous racontent les images, les visages et le peu de paroles. Des formes qui répètent, reproduisent, deviennent échos d’elles-mêmes jusqu’à nous hanter, à nous habiter, à nous ébranler, à nous effacer.