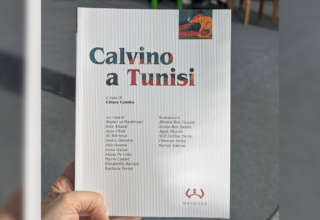Tout le roman de Meryem Sellami est, en dernière analyse, une mise à mots d’une souffrance et une narration bien romancée d’un itinéraire thérapeutique débouchant sur la libération de l’être malade de sa propre prison intérieure. Le discours thérapeutique visant à regarder dans le noir abyssal du personnage principal (« le mot est un regard dans le noir », Hugo) à rendre clair ce qui y est obscur, transparent ce qui y est opaque, et à donner de la visibilité à ses plaies béantes pour essayer de les cicatriser, est savamment greffé sur le discours artistique (l’écriture romanesque).Tous les deux s’interpénètrent et se développent en même temps dans l’énonciation narrative de l’autrice, socio-anthropologue, mais certainement très connaisseuse aussi en matière de psychanalyse.
Obnubilée sans répit par les spectres féroces d’un passé dont elle est captive et qui la roule comme une épave, constamment arrimée à sa solitude psychologique et mue avec force par le désir de fouiller dans le clair-obscur de son être et de tenter d’y appréhender le « Moi » blessé, traumatisé d’abord par une agression sexuelle, pendant son jeune âge, puis, plus tard, à l’âge adulte, par un avortement mal vécu l’ayant culpabilisée jusqu’à lui donner des cauchemars effrayants, Hajar ou Héjer, la troublante héroïne de ce roman psychologique de Meryem Sallami, « Je jalouse la brise du sud sur ton visage », a tout l’air de s’affranchir enfin de ses vieilles entraves intérieures juste à l’ultime phrase clausulaire du chapitre 40. Là où ce nombre qui ne serait peut-être pas fortuit dans la stratégie narrative de cette jeune romancière tunisienne francophone, semble porter les sur-significations que lui donneraient symboliquement certaines cultures l’attachant surtout à l’idée de « l’épreuve » ou à celle de son résultat, « la transformation », ou encore à celle du « désert », lieu de solitude par excellence où Jésus de Nazereth se serait, d’après la Bible, retiré durant 40 jours pour endurer la double épreuve de l’ isolement et du jeûne et échapper par la même à la tentation du diable ou des démons. Ces vieux démons tenaces qui siègent aussi dans la psyché agitée de Hajar et que cette dernière a dû traverser douloureusement les 269 pages entières de ce roman, c’est-à-dire tout l’itinéraire thérapeutique, comme d’autres traversent le désert ou se livrent à un long exorcisme, afin de mettre hors d’état de nuire et retrouver ensuite son identité reconstruite et sa liberté conquise. Et ce, après une épuisante pérégrination entre deux pays, deux rives de la Méditerranée, deux grandes villes, deux analystes, et via un cumul d’ inhibitions et de tabous, des rêves de liberté compensant des frustrations anciennes, des amours sexuels éphémères, réels ou fantasmés, et même des passages psychédéliques où les désirs, l’alcool, l’ecstasy et les plaisirs du corps sautant tous les verrous, s’entrelacent avec des hallucinations psycho-sensorielles.
C’est en effet à ce quarantième chapitre (263-269) que la longue épreuve de Hajar semble se terminer après l’avoir vraisemblablement transformée et conduite, presqu’à son insu, vers « le chemin de sortie de la souffrance » (p. 265) que l’imperturbable Docteur Hirsch (Dr. H.) lui a montré petit à petit, séance après séance, en l’ « amarrant à (ses) désirs, à l’amour qui est en (elle) et qui, lui seul, peut (la) sauver » (Ibid.), même si elle vient d’émerger « laminée, perdue » (Ibid.), cassée, d’une terrible passion d’amour, tumultueuse et impétueuse, l’ayant dévastée à mort et dépossédée d’elle-même. Une passion quelque peu mortifère nourrie pour son deuxième analyste ou psychothérapeute : le brillant Docteur Azer, établi à Nice, mais originaire comme elle du Sud tunisien et qu’elle a aimé de tout son être, comme s’il était le père irrémissiblement absent (p.254) et dont l’image trouble remonte du plus profond de ses sombres souvenirs et du manque d’affection qui l’avait cruellement marquée.
Et c’est bien à cet analyste devenu soudain amant après avoir été pour son analysante (patiente) passionnée l’objet d’un grave transfert psychologique ou déplacement sentimental, que Hajar s’est en effet vite attachée de la manière la plus dévouée et possessive au point de devenir jalouse même de la « brise du sud » dont elle a l’impression, toute onirique, toute romantique, qu’elle flotte « sur son visage » (Cf- le titre très poétique du roman).
Avec des yeux émerveillés, Hajar a donc regardé cet homme en qui elle a cru trouver le réparateur de son être fracturé, et sous ses yeux à lui, elle s’est sentie belle et a vécu cette gloire intérieure que donne souvent aux amoureux l’assurance d’être aimés. Dans ses fiévreuses rêveries d’amour, elle a projeté de convoler en justes noces avec lui, de lui donner de beaux enfants et de vivre librement sa vie en sa chaleureuse compagnie. Seulement elle ne savait pas que, loin d’être un vrai « Azer », (en arabe, celui qui aide, qui soutient), comme son prénom l’indique, son amant était en réalité un pervers narcissique, un « P.N. », comme disent les spécialistes, un dévoreur de femmes incapable de s’émanciper de son ego hypertrophié et égoïste, incapable de triompher du fantôme obsédant de la mère absente qui le hante et organise sa fuite irrémédiable : « Il a un manque qu’il veut combler coûte que coûte sans jamais y parvenir. Ça vient beaucoup de la mère. Il n’a pas reçu, enfant, toute l’attention dont il avait besoin. Alors à chaque relation amoureuse, il attend d’être réparé. Il passe par trois phases : idéalisation-déception-haine. Son mode de fonctionnement par la suite sera la fuite » (p. 226), soutient le « psy » d’Elsa, l’amie de Hajer. Hajer jetée froidement comme un vieux linge ou un ticket périmé, abandonnée comme quelqu’un qu’on laisse seul sur le bas-côté de la route, au moment même où la vie poursuit, avec son cortège de plaisirs, son allègre chemin. C’est en effet la chute mortelle du funambule qui marchait dangereusement sur la corde raide suspendue au-dessus du vide et qui, sans avertir, se brise. C’est la descente aux enfers, la mort subite aux joies du corps, aux mirages, au bonheur et c’est la défaite brûlante, massacrante, qui ramène Hajer à sa douleur initiale, maintenant plus intense encore et plus perturbatrice !
Meryem Sellami dont l’écriture est admirablement sensible et délicate, aérienne, nous donne à lire ici, un peu à la manière de « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes, des pages magnifiques sur l’insoutenable douleur due à ce poignant sentiment d’abandon qui est « un désaveu de la chair. Le corps commence à souffrir de la perte avant même qu’elle n’ait été pensée, formulée. Et un corps trahi devient le pire ennemi. A tout moment, il réclame l’autre. Le pleure à sa manière. Les seins, le sexe, les mains ne savent plus quoi faire, ni contre quoi se heurter. Ils ne savent plus quoi espérer. Ils ne savent plus vivre. Hajar ne comprenait pas. Sa chair souffrait plus qu’elle. Elle la débordait, l’horrifiait, l’assiégeait… » (p. 241).
« Libre » est le mot-clef sur lequel s’arrête de manière incisive la toute dernière phrase de ce roman. Mais « libre » pour s’en aller mourir après avoir vu jusqu’où la vie peut être traîtresse, douloureuse et, somme toute, absurde, ou « libre » pour embrasser le nouvel horizon de lumière ouvert à Hajar par la thérapie et pour vivre pleinement, encore vivre et aimer, « littéralement et dans tous les sens » (Rimbaud), en dépit du risque de la souffrance dont on ne peut « faire l’économie », comme le remarque si sagement le très serein Docteur H. (p. 265) ?
La narratrice, pourtant omnisciente, préfère ne pas répondre à ce questionnement et laisse sur son sillage une espèce de « flou artistique » intriguant le lecteur et le poussant à s’interroger sur la vie et la mort, sur la liberté et la souffrance.
Tout le roman de Meryem Sellami est, en dernière analyse, une mise à mots de cette souffrance et une narration bien romancée d’un itinéraire thérapeutique débouchant sur la (possible) libération de l’être malade de sa propre prison intérieure. Le discours thérapeutique visant à regarder dans le noir abyssal du personnage principal (« le mot est un regard dans le noir », Hugo) à rendre clair ce qui y est obscur, transparent ce qui y est opaque, et à donner de la visibilité à ses plaies béantes pour essayer de les cicatriser, est savamment greffé sur le discours artistique (l’écriture romanesque). Tous les deux s’interpénètrent et se développent en même temps dans l’énonciation narrative de l’autrice, socio-anthropologue, mais certainement très connaisseuse aussi en matière de psychanalyse.
Pour conclure, il y a beaucoup de plaisir à la lecture de ce beau roman, servi par une langue épurée et élégante, continûment guidé par un souci d’intelligibilité, en dépit de la grande complexité du personnage. Les phrases y sont souvent minimales, bien coupées, bien ciselées, sobres et sans fioritures ni exubérance qui rappellent un peu le style de Marguerite Duras dans par exemple « L’amant ». Courtes pour la plupart qui se réduisent quelquefois à un seul mot (des monorèmes), elles avancent à pas comptés et cadencent savoureusement un texte au tempo vif reproduisant un peu le rythme rapide et fougueux du personnage souffrant voulant arriver vite au bout du tunnel et tirer enfin le jour de la nuit. « Détaboutisée », l’écriture de Meryem Sellami sait appeler par leurs noms les choses bien naturelles et bien humaines du corps aimant, en quête du plaisir et d’épanouissement.
Meryem Sellami, « Je jalouse la brise du sud sur ton visage », Tunis, Cérès, 2022, 269 pages. ISBN: 978-9973-19-837-2. Prix Comar de la découverte du roman en français, 2023.
Meryem SELLAMI est docteure en sociologie et maître-assistante à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (Université de Tunis I). Elle a publié « Adolescentes voilées. Du corps souillé au corps sacré » (Presses de l’Université de Laval (PUL) 2014) et elle a contribué, avec les chercheurs Denis Jeffrey, Jocelyn Lachance, David Le Breton et Jihed Haj Salem, au collectif « Jeunes et djihadistes-Les conversions interdites » (Presses de l’Université de Laval (PUL) 2016). « Je jalouse la brise du Sud sur ton visage » est son premier roman.