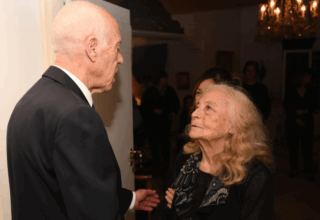En octobre 2016, un staff médical, relevant des deux services de psychiatrie «A» et «C» du CHU Hédi Chaker, à Sfax et de la Faculté de médecine, plus exactement de l’Université de Sfax, avait réalisé une étude portant sur dix années d’expertises psychiatriques en droit pénal, axée sur la «Criminalité chez le jeune adulte : à propos de 97 cas d’expertise psychiatrique pénales». Quel bilan, quelle lecture ?
L’objectif de cette étude était d’examiner «l’intérêt de la prophylaxie de la délinquance chez les jeunes, visant à prévenir et à traiter les troubles psychiques. C’est une prévention légitime des comportements déviants chez les enfants, les adolescents et même les adultes».
Il s’agit d’un article riche en informations, lesquelles auraient dû être prises en considération, afin de savoir gérer le dossier de la délinquance juvénile, voire des crimes —souvent atroces, abominables, impensables— commis par les mineurs. Aujourd’hui, faute de stratégies et de moyens à même de maîtriser les mauvaises pulsions des jeunes adultes ou encore des grands enfants, ceux âgés notamment entre 13 et 18 ans, le nombre des délits commis par ces derniers va crescendo. Certains le considèrent comme un phénomène international, d’autres pensent qu’il s’agit d’une défaillance de tout un système politique, social, économique et moral.
La piste à emprunter
En 2016, date de la publication de l’article scientifique précité, le récapitulatif de dix ans d’expertise psychiatrique pénale a pu dresser la prophylaxie des mineurs délinquants. En bref, la majorité des 97 sujets, âgés entre 16-20 ans, étaient de sexe masculin et sans qualifications professionnelles. Les principales infractions étaient le vol avec 36,1%, l’homicide ou tentative d’homicide de 25,7%, coups et blessures (11,3%) et délits sexuels (7,3%). «Sur le plan nosographique, 49,5% avaient une personnalité antisociale, 11,3% étaient des schizophrènes. La démence au sens légal a été retenue pour 29,9%».
Ceci dit, l’article scientifique a mis le doigt sur moult détails, soit le milieu (urbain, semi-urbain, rural), la nature des quartiers (populaires, chauds dans 44,3%), le niveau scolaire (57,7% primaire, 37,1% secondaire et 5,2% universitaire), le climat familial (12,4% souffraient d’une carence affective surtout provenant d’un père qualifié de violent)… «Des antécédents judiciaires ont été retrouvés chez 28,9% parmi eux 63% avaient été incarcérés auparavant au moins une fois».
La sanction est irrévocable
Toutes ces données et tous ces facteurs propices à la délinquance des mineurs auraient pu être les points de départ vers des plans d’action orientés dans le but de prévenir la criminalité des jeunes ou des enfants. Coupables et victimes, pour certains, les enfants en difficulté avec la loi n’échappent pourtant guère à la sanction. Selon l’article 43 du Code pénal, «tombent sous la loi pénale les délinquants âgés de plus de treize ans révolus et de moins de 18 ans révolus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans».
Encore faut-il souligner que «la tendance à la dépénalisation du droit pénal des mineurs n’existe pas en droit tunisien», ce qui affirme la rééducation pénale infaillible des mineurs délinquants. Aussi, commettre un délit s’avère être immanquablement l’erreur impardonnable quoique sensiblement allégée au nom de l’enfance, de l’immaturité psychologique et autres considérations.
Banalisation du crime
Sauf que le terrain favorable au crime des jeunes adultes perdure, voire s’élargit, aussi bien par l’absence des mécanismes et institutions susceptibles d’absorber les enfants et les adolescents et de les tirer des climats socio-économiques à risque que par la démission parentale.
Selon le Dr. Wahid Koubaâ, psychiatre, la prolifération de la criminalité juvénile revient à bon nombre de facteurs, lesquels convergent tous vers la banalisation du crime. «La liberté dont disposent les enfants de nos jours ouvre la voie vers la banalisation du crime. Les enfants manipulent les smart-phones. Ils y visualisent toute sorte de crime. Au début, cela les choque, puis, au fur et à mesure que cela se reproduisait sous leurs yeux, tout devient banal, même ce qu’il y a de plus atroce», explique-t-il. Il n’exclut aucunement les médias qui diffusent autant de crimes opérés à travers le monde, sous forme d’infos. «Même les plateaux de télévision et les fictions encouragent à la violence. D’ailleurs, nous entendons, de plus en plus, parler d’un nouveau terme «al tanamor», lequel pousse davantage les jeunes aux conflits, aux disputes, à la violence», renchérit-il.
Overdose de pression et de tension
Parallèlement, les enfants en difficultés avec la loi encaissent, souvent, autant de pression et de tension dans leur environnement familial et social. « Parmi ces pressions, il convient de citer la pression scolaire. Les parents mettent trop de pression sur leurs enfants ce qui n’est point constructif. Certains vivent dans des familles disloquées, où les parents sont divorcés. Mais il faudrait savoir qu’avant la séparation, ces enfants étaient, sûrement, des témoins de disputes, de querelles, de violence physique, verbale, morale… La crise économique qu’endurent certains ménages peut déclencher des tensions et des violences. Au final, tout converge, poursuit le Dr Koubaâ, vers la banalisation de la violence et du crime».
Démission parentale… et institutionnelle !
Comment donc échapper à cette sphère infernale au moment où le physique change, le mental à cheval entre une enfance souvent malheureuse et une jeunesse à dominante impulsive ? A quelle porte frapper alors que les structures pour enfants et adolescents, notamment les maisons des jeunes, les scouts et les clubs, font souvent défaut ?
M. Abdessattar Sahbani, sociologue, dénonce, non pas la démission parentale, mais plutôt celle institutionnelle. «Il faut admettre que l’environnement de l’enfant, de nos jours, est un environnement hostile par excellence. Or, qu’avons-nous fait pour le rendre sécurisé et sécurisant ? Lorsqu’on évoque la question de la criminalité des mineurs, il est impératif de s’interroger sur le rôle de la sécurité et celui de l’école, lesquels sont fondamentaux dans la lutte contre la délinquance. Il est facile, poursuit-il, de pointer du doigt la démission parentale puisque la famille est devenue le bouc-émissaire auquel l’on accole tous les problèmes. Mais nous avons tendance à oublier que les parents ne sont plus en mesure d’éduquer, seuls, leurs enfants».
Pour le sociologue, la famille n’a pas choisi de démissionner. Elle a été contrainte à baisser les bras car elle a du mal à maîtriser la situation. «L’impact des médias, en général, de ceux de masse, en particulier, est pour beaucoup dans cette vague de violence et de criminalité. Ayant des capacités critiques très limitées, les jeunes sont dans le besoin d’être assistés, éclairés, orientés vers des contenus instructifs. Or, les structures à même d’assurer cette mission sont manquantes. Du coup, personne n’y accorde de l’importance et encore moins les partis politiques et la société civile», ajoute le sociologue.
Manifestement, ce qui manque, grosso-modo, aux enfants et aux adolescents qui succombent au délit, c’est la sécurité —et le sentiment de la sécurité—, le réconfort familial et social —ou l’antonyme de la tension et de la pression— et l’intégration dans des structures où la sociabilité s’apprend sous l’œil vigilant des éducateurs notamment dans les espaces dédiés aux jeunes adultes ou aux grands enfants.
La situation actuelle exige des actions pertinentes et étudiées en fonction des défaillances cernées et des besoins signifiés. Pour le Dr Koubaâ, «tout est à revoir»…