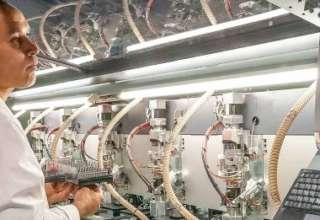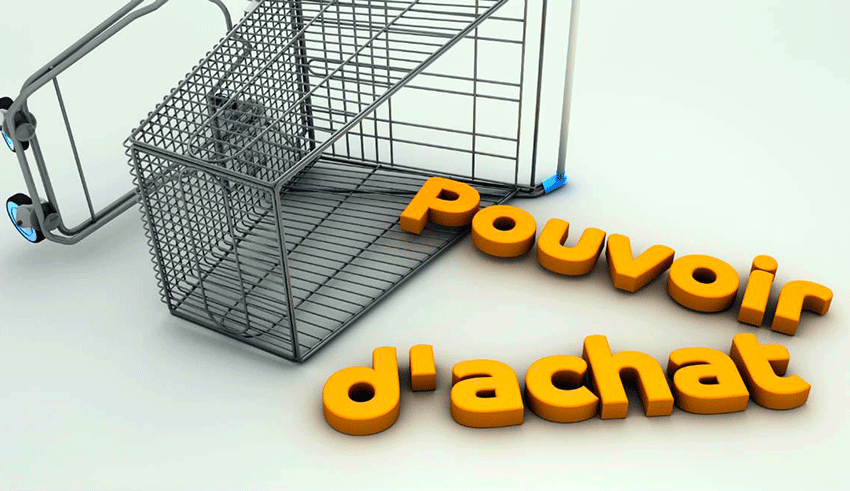Professeur de sociologie actuellement à l’Institut des études supérieures de Doha. Titulaire d’un doctorat de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales de Paris et d’un doctorat d’État de l’Université de Tunis. Il est aussi rédacteur en chef de la Revue Omran des sciences sociales. La révolution tunisienne fête ses dix ans. A l’occasion de cet anniversaire, Pr Mouldi Lahmar propose son analyse sans amertume mais sans concessions non plus.
Vous êtes de l’Université de Tunis, actuellement vous enseignez à Doha, vous continuez de suivre de près l’actualité tunisienne. Dix ans passés après la révolution, quelle est votre évaluation ?
Bien que je sois loin, je suis proche et me considère comme partie intégrante de la réalité tunisienne. Les événements et bouleversements qui ont changé la Tunisie ont de lourdes conséquences au niveau de la dimension historique. Ils sont décisifs. Ce qui me touche particulièrement, c’est cette absence d’accord minimum sur la définition de ce qu’a connu la Tunisie entre septembre 2010 et janvier 2011, que l’on n’arrive pas à qualifier, révolution ou simple soulèvement/révolte populaire. Politiquement, cela ouvre la voie à un retournement contre la révolution, non seulement de ses ennemis, mais même de la part de ceux qui y ont participé par calcul, mais n’ont pas gagné grand-chose à l’échelle individuelle. J’en connais ! Pour réaliser les objectifs d’une révolution, il faut d’abord y croire et admettre sa complexité et son aspect versatile.
A quoi est dû ce manque d’accord minimum ?
Je pense que les difficultés se situent au niveau de l’évaluation politique et sociologique de ce qui s’est passé et se passe actuellement. De cette évaluation, j’entends la construction d’une conception théorique et sociologique des évènements et l’élaboration d’un récit général accepté globalement par la plus grande partie des citoyens. Il y a une difficulté dans l’édification de cette conscience. La difficulté de l’élite intellectuelle qui a du mal à conceptualiser la révolution. Ce n’est pas un défaut. Cela signifie, au contraire, que cette élite a opéré un recul critique pour pouvoir analyser. En revanche, les hommes politiques, malgré les élections qui leur confèrent une légitimité officielle et institutionnelle, n’ont pas encore réussi à gagner une légitimité éthique et politique. La classe politique — s’il y en a — n’a pas gagné la confiance nécessaire pour se projeter dans l’avenir. Evidemment, la crise économique et sociale contribue à accentuer cette instabilité.
La légitimité politique n’a pas été appuyée par des décisions économiques concrètes que le citoyen peut mesurer dans sa vie quotidienne. Cette légitimité politique n’a-t-elle pas été remise en question ?
Ici je m’adresse autant aux politiques qu’à l’élite intellectuelle. Il y a une étape ou un maillon dont on ne tient pas compte au niveau de l’analyse de la révolution, à savoir les spécificités sociologiques de la révolution. Je prétends qu’il y a une relation entre la faiblesse du rendement de la classe politique et les origines sociales de la révolution. Les régimes dictatoriaux ne préparent jamais leur succession. Au contraire, ils anéantissent le pluralisme et toutes les tentatives d’engagement politique. Entre l’ancien régime et la révolution, il y a un maillon encore relativement obscur. L’université tunisienne, qui est l’une des rares institutions dans le monde arabe à avoir entrepris des recherches sur le terrain, dès la fin de l’année 2011, le prouve bien. Nous avons publié un ouvrage collectif (La révolution tunisienne : le détonateur local sous la coupe des sciences humaines 2014), en langue arabe, qui fait office de scanner de la révolution tunisienne depuis Sidi Bouzid et Kasserine. Je voudrais à ce titre remercier mes collègues qui y ont pris part : l’historien Pr Abdelhamid Hnia, le sociologue Pr Ahmed Khouaja, le démographe Pr Mohamed Ali Ben Zina, le spécialiste de la géographie économique Pr, Hamadi Tizaoui, l’urbaniste Pr Kahloun et la psychologue Mme Smida. Une enquête qui a duré des mois dans ces deux gouvernorats et qui obéit aux standards académiques. Je dois dire à ce propos que divers médias sollicités, dont des animateurs et des soi-disant chroniqueurs de télévision, ont refusé de présenter le livre, bêtement, parce que publié par un centre de recherche qatari ! Pourtant, ce livre explique en partie le paysage politique d’aujourd’hui.
Donnez-nous des cas concrets cités par votre ouvrage.
Si l’on comptait tous les adhérents aux formations politiques déclarées ou clandestines en 2010 à Sidi Bouzid et à Kasserine, plus de 91% relevait du RCD. Les autres partis n’avaient que la petite portion qui restait. La majeure partie de ces 8% et des miettes était dominée par Ennahdha. Certaines formations étaient relativement actives sur le terrain, comme le PDP, mais avaient très peu d’adhérents et de partisans, donc occupaient peu de place sur l’échiquier politique et peu d’ancrage social. C’est un constat objectif. On peut ajouter que la majorité des adhérents des partis de l’opposition déclarés menait des activités intermittentes. Certains des militants étaient au chômage et dépendaient de leurs proches. Cela empêchait les autorités d’employer contre eux les méthodes fortes, comme tout simplement les affamer. Le RCD était à l’époque le seul crieur du marché politique. Toute démarche administrative, la plus anodine qui soit, devait obtenir son aval. Plus grave, seul le parti au pouvoir pouvait protéger contre la violence arbitraire de l’Etat. Il était quasi impossible de travailler dans le commerce informel sans avoir ce fameux sésame, la carte d’adhésion au parti. La corruption était généralisée et relevait de l’ordinaire. Le clientélisme aussi. J’ajouterais une remarque pour tirer les oreilles aux démocrates modernistes d’aujourd’hui : 50% des adhérents du RCD avaient le même profil que ceux aujourd’hui de Qalb Tounès. En fait Qalb Tounès est une ONG caritative qui troque son aide contre des voix électorales. Le RCD opérait de la même manière à travers le Fonds 26-26 et les caisses de l’Etat. Ce qui nous pousse à nous poser des questions sur la nature des partis politiques en Tunisie. Tous ceux qui avaient participé à la révolution n’étaient pas affiliés à des ONG. Mieux, 25% d’entre eux étaient de jeunes adhérents généralement fictifs du RCD ! Autre élément relatif à la révolution, c’est un fait historique et indéniable, sans l’encadrement de la Centrale syndicale, l’Ugtt, les évènements auraient probablement pris une autre tournure. 94% des syndiqués avaient participé aux manifestations. Pour conclure, de nombreux députés qui siègent aujourd’hui au Parlement n’ont pas la moindre formation politique « saine », ni la moindre idée sur le fonctionnement des institutions, ni ne peuvent se targuer d’avoir le moindre sens de l’Etat.
C’est ce qui explique ce maigre rendement ?
Je n’ai pas été étonné en 2019, lorsque l’un des chefs de parti parmi les plus radicaux de tendance islamiste, déclarait à ses électeurs qu’ils se sont finalement libérés de l’Etat. Cette personne est député aujourd’hui. La question est comment se fait-il que cette élite qui n’a pas été formée à l’action partisane ou associative se trouve d’un coup propulsée au sommet des institutions décidant de l’avenir du pays, amenée à légiférer et à faire des choix décisifs qui impactent directement la vie des Tunisiens, l’avenir des générations futures et la politique nationale et internationale de la Tunisie. Donc, ces responsables « néophytes » se sont trouvés dans des postes stratégiques, sans encadrement, ni formation préalable. Ce qui ne veut pas dire que nous condamnons – d’en haut- ces nouveaux responsables qui animent le paysage politique. Car la philosophie de l’ancien régime est en cause. Les régimes dictatoriaux empêchent et même criminalisent toutes ambitions politiques non encadrées ni limitées par le système. Ils interdisent aux citoyens de cultiver le sentiment d’appartenance ainsi que celui de citoyenneté. En revanche, il est important de signaler ici que la révolution est un processus. Et comme l’avait si bien dit Ibn Khaldhoun, l’Etat « cuisine », entraîne, fait mûrir ses hommes. Malgré tous les manquements constatés de fait, la révolution a réussi à mettre en œuvre la séparation des pouvoirs, promulgué une deuxième constitution. La vie politique est en train de se réorganiser et permet à celui qui le souhaite d’y prendre part. L’enjeu est à la fois d’éviter la reproduction des conditions sociales et institutionnelles pour l’émergence de nouveaux dictateurs, et pour permettre aux citoyens de « posséder leur histoire », comme disait mon ami le philosophe Amor Cherni.
La révolution a éclaté à Sidi Bouzid, Kasserine et dans les régions intérieures, a été interceptée par Sfax et par les autres villes pour atteindre Tunis le 14 janvier. Le récit révolutionnaire qui prend sa source depuis le 17 décembre jusqu’au 14 janvier est celui de tout un pays qui s’est insurgé contre le dictateur. Qu’en pensez-vous ?
Dans un livre ou un long dialogue avec Mohamed Sayah qui cite Bourguiba, lequel lui aurait dit à propos de la révolution d’Ali Ben Ghedahem que celle-ci avait échoué parce que les habitants des régions rurales ne partageaient pas avec les habitants des milieux urbains le même mode de pensée. Or, entre la révolution de Ali Ben Ghedahem et la révolution tunisienne de 2010-2011, il y a eu l’implantation de l’école tunisienne et maintenant la mondialisation des médias. L’école tunisienne a rendu le concept de citoyenneté et les principes de liberté et de démocratie à la portée de celui qui s’instruit et va à l’école, qu’il soit originaire des zones rurales ou des villes. Quand la révolution a éclaté, les habitants de Sidi Bouzid, de Sousse et de Tunis tenaient le même discours, avaient les mêmes revendications. Les slogans scandés à Sidi Bouzid et Kasserine étaient saisis par les esprits à Sfax et Tunis avant de toucher les cœurs. De plus, la fracture entre les deux environnements, rural et urbain, n’est plus ce qu’elle était du fait de l’intégration sociale, de la mobilité des étudiants. Des fonctionnaires originaires des régions vivant dans les grandes villes et la Capitale. D’ailleurs, parmi les caractéristiques des révolutions, c’est de traverser verticalement et horizontalement la structure sociale. C’est le cas.
La scission que certains sont en train d’exacerber entre les régions intérieures du pays, le Sahel, les grandes villes et la Capitale n’a aucune assise réelle dans la révolution tunisienne… ?
Oui c’est vrai. Mais il faut reconnaître que le modèle de développement économique et social adopté par l’Etat a creusé l’écart entre les régions que vous venez de citer. Dans les années 60, l’Etat tunisien a tenté d’édifier une expérience de développement économique et social inclusif et général. A titre d’exemple, la mise en place de l’usine de cellulose à Kasserine, non sur le littoral, est un choix de l’Etat.
En revanche, il faut reconnaître que les villes et le Sahel étaient des lieux de production des élites qui s’étaient initiées très tôt aux affaires et à la chose publique. L’école est arrivée plus tard dans les régions intérieures (voir dans notre livre, le texte de M-A Ben zina). Ces responsables ont occupé des postes de haut rang et orienté la politique de développement, selon les critères de l’économie libérale et à travers leurs réseaux de connaissances, dans le sens anthropologique du terme. A partir de là, il y a eu la marginalisation des régions. Les régions revendiquent aujourd’hui une discrimination positive, mais non pas dans le dessein d’une décentralisation totale par rapport au centre du pouvoir. L’Etat tunisien devra réviser le plan de développement régional et surtout cesser de dire aux citoyens ce qu’il faut faire pour gagner leur vie. Je montre ici du doigt cette bureaucratie conçue au départ pour mettre en œuvre l’autorité de l’Etat, devenue aujourd’hui un obstacle majeur au développement et un réservoir de chômeurs déguisés. Cinq ou six fonctionnaires pour accomplir la tâche d’un seul agent compétent. Quel gâchis !
L’amendement du régime politique est un sujet récurrent.
La démocratie représentative est sans cesse critiquée, la démocratie directe est la seule alternative qui vaille, pour certains, qu’en pensez-vous ?
Pour le moment, je n’ai pris connaissance d’aucun document officiel présenté par un courant politique ou des intellectuels qui me permette d’étudier ce projet. Seuls parfois les journaux et les réseaux sociaux en parlent. Je préfère rester prudent. Je dirais, cependant, que même la démocratie directe se base sur la représentativité. Ensuite, ce projet risquerait de faire l’impasse sur toutes les données anthropologiques et sociologiques qui pourraient, si elles ne sont pas prises en considération, faire dévier ce projet et surprendre même ceux qui le défendent. La Tunisie n’est pas le Yémen mais n’est pas non plus la France ou l’Allemagne. Cette idée de la démocratie directe se réfère, peut-être sans le savoir, à une conception métaphysique d’un citoyen qui serait un individu libre de toutes attaches, comme l’a imaginé J.J Rousseau. On peut même dire que les problèmes que connaît la France aujourd’hui, avec ses immigrés, sont en rapport avec la nature métaphysique de cette conception, puisqu’elle croit que ses immigrés ne pourraient devenir de « vrais » Français qu’après êtres devenus des individus sans attaches anthropologiques. Condition canonique pour « s’intégrer » dans la Nation qui a un fondement éminemment politique. Ce n’est pas le cas de l’Angleterre ni de l’Allemagne qui se considèrent comme des nations culturelles. Pour revenir au cas tunisien, la conception de la démocratie telle qu’elle circule dans les médias (j’ai notamment regardé l’émission télévisée où Ridha Chiheb El Makki a tenté de l’expliquer) n’est pas encore claire. De quoi parle-t-on au juste ? Je ne suis pas contre l’innovation authentique, au contraire, et je reconnais que la démocratie s’appuyant sur les partis politiques connaît aujourd’hui un certain essoufflement. L’exemple du Parti républicain de Trump l’a montré, également celui de Macron, dans une moindre mesure. Mais il ne faut pas oublier que le local a d’autres composantes que le politique, et que ces composantes sont « secrètement » politiques aussi. Le nier ou l’ignorer, c’est faire un saut dans l’inconnu. La Tunisie nouvelle est née lorsque le vieux Hammami ne crie plus « je mourrai…je mourrai pour que vivent les Hamamma », mais plutôt pour que vive la patrie… la Tunisie. La démocratie directe doit faire en sorte que cette identification ne disparaisse pas.
Il y a encore du chemin à faire. On peut le constater dans l’application de la loi qui n’est pas applicable aux membres de la famille ni aux connaissances. Nous n’avons pas encore atteint le statut juridique du citoyen. On le constate également à travers les délibérations parlementaires ?
L’individualisme signifie que chacun vit et réalise ses objectifs, sans le concours des autres, qu’il soit le voisin, le cousin, le client, l’ami (e). Cet état de fait a pu être mis en place à l’aube de l’indépendance dans les années 60 et 70. Mais sa dimension politique a été perdue à mesure que l’Etat renonçait au projet moderniste et révolutionnaire qui était le fondement même de l’Etat tunisien. Le clientélisme dans toutes ses dimensions est devenu la règle et il concorde souvent avec le régionalisme. Ce modèle a atteint son summum durant le régime presque oligarchique de Ben Ali qui a totalement détruit le principe de neutralité de l’administration. Le moment est venu pour réorganiser l’administration tunisienne de manière rationnelle en la dotant des ressources nécessaires. Après les moments troubles de la révolution et la relative stabilité qui a suivi, on avait commencé à dire « grâce à notre Administration ». Eh bien, moi je n’y crois pas du tout ! En fait, c’est grâce au sens de l’ordre, au degré d’individuation atteint par la société tunisienne, grâce au développement de l’interdépendance fonctionnelle de tous envers tous que nous avons pu tenir et que le pays n’a pas basculé dans la violence ou la guerre civile comme ailleurs. Car la révolution a eu lieu, dans un sens, contre cette administration qui doit apprendre aujourd’hui à être fonctionnelle, impartiale, à respecter le citoyen, respecter sa dignité, et lui rendre le service requis sans qu’il doive recourir à l’entremise d’un proche qui « connaît quelqu’un » pour lui faciliter ce qui est censé être un droit.
Bourguiba a préservé la souveraineté nationale en restant en dehors des conflits. Ben Ali, malgré tous les défauts qu’on peut lui reprocher en matière de politique étrangère, a perpétué cette ligne dont Bourguiba avait jeté les bases.
Après la révolution, il semble bien que la Tunisie ait perdu cette neutralité. Ce qui s’est passé en Libye avec les armes, se passe-t-il en Tunisie moyennant l’argent ? La Tunisie fait-elle l’objet d’interventionnisme étranger ?
D’abord ceux qui essayent de relayer cette fausse idée selon laquelle la révolution est un complot fomenté depuis l’étranger ne sont pas crédibles. Cette révolution a pris de court tout le monde. Personne ne s’attendait que l’étincelle qui avait jailli de Sidi Bouzid se cristallise jusqu’à devenir une vraie révolution. Les plus grandes chancelleries, y compris américaine, ne s’y attendaient pas. Seulement, quand une révolution de cette dimension éclate dans un pays donné, ce pays se retrouve dans le viseur des grandes puissances et des voisins. D’énormes intérêts militaires, économiques, géographiques sont en jeu. Par ailleurs, il n’y a pas d’événements dans ce monde globalisé sans l’intervention d’éléments extérieurs. Cependant, une question fondamentale persiste : comment orienter ce processus révolutionnaire inachevé dans la bonne direction ? Je suis désolé de dire qu’au moment voulu, nous n’avons pas su mettre en œuvre une diplomatie de la révolution. Béji Caïd Essebsi ne représentait pas la révolution. C’est vrai qu’il a gouverné dans la tempête, mais il a suivi la voie tracée il y a très longtemps par Bourguiba. Or, le monde a changé. La Méditerranée a changé, l’Afrique a changé !
La diplomatie tunisienne avait ses fondamentaux, des pays africains s’alignaient sur les positions tunisiennes et Bourguiba était respecté, la Tunisie était reconnue comme un pays émergent à l’époque et prometteur. N’est-ce pas ?
Oui, mais il ne faut pas croire qu’on était indépendant. Bourguiba a été réaliste dans le sens où le monde était divisé en deux grands blocs et il fallait s’y caser avec le moindre coût. Nous vivons dans une nouvelle époque et la bataille actuelle entre d’un côté l’Europe — et au-devant de la scène, la France — et de l’autre côté la Turquie et sa trame invisible, asiatique, nous rappelle le 16e siècle. Ce qui me révolte, c’est que pendant ce temps, le Maghreb historique dort encore, et certaines de ses élites attendent que la solution de ce conflit vienne d’ailleurs…comme au temps de l’occupation espagnole au début du 16e siècle.
Dans la réalité, le Maghreb n’existe pas à cause du conflit larvé entre l’Algérie et le Maroc et qui risque de s’aggraver avec les derniers rebondissements portant sur le Sahara occidental en faveur du Maroc.
Le Maghreb historique existe avant ce conflit. Celui-ci doit être vu et pensé comme une contingence, et la génération qui manifeste en Algérie depuis un an va le résoudre, dépassera cet héritage colonial. Il faut savoir que les nations et les unités politiques sont des constructions historiques et, dans un certain sens, imaginaires. Elles sont des projets toujours en cours de réalisation. Elles cessent d’exister quand elles disparaissent de la mémoire collective et ne représentent plus un enjeu et un futur possible et réalisable. Or, le Maghreb est une entité d’appartenance très présente dans les esprits. Il représente un enjeu et un futur possible à réaliser. Les nouvelles générations doivent penser leur Maghreb dans sa pluralité socioculturelle et son unité politique générale. Générale ne renvoie pas ici à centralisation. L’autonomie locale est la clé. Aussi la royauté au Maroc ne doit pas s’inquiéter de l’union politique maghrébine et les armées et les partis politiques ici et là également. Sociologiquement, ce sont aujourd’hui ceux qui ont l’habitude de réaliser leur gain avec l’aide de l’Etat et de ses rouages privés qui bloquent le Maghreb uni. Lorsque entrepreneurs et investisseurs maghrébins n’auront plus besoin des réseaux privés de ceux qui sont au pouvoir pour développer leurs activités et créer la richesse, et lorsque la société civile devient partie prenante de la gouvernance, les murs artificiels actuels céderont. Les mouvements politiques et culturels et les revendications des générations maghrébines actuelles vont dans ce sens. Les élites politiques aux commandes des Etats maghrébins doivent œuvrer dans le même sens que ce mouvement. Je reconnais, cependant, que les convaincre n’est pas chose aisée. L’héritage colonial et ses enjeux internes sont là pour rendre la tâche encore plus ardue.
Les rapports de force ont-ils changé ?
Oui, cela commence à changer dans notre région, et d’ailleurs je me réfère ici à Marc Lynch qui dans son dernier article dans « Foreign Affairs » (N° de janvier-février 2021) où il a fait une évaluation des dix années de l’« Arab Spring ». Il a conclu par cette affirmation que le résultat certain de ces dix années, c’est que le Moyen-Orient « n’est plus sous contrôle » ! Le changement nous le constatons de fait. Mais, à mon avis, la diplomatie tunisienne n’a pas beaucoup changé. Elle fonctionne selon des repères passés de mode. La Grande-Bretagne s’est inscrite sur la Route de la soie ! Nous autres sommes aux abonnés absents. Où en sommes-nous sur le continent africain ? Sommes-nous des acteurs actifs à la hauteur des évènements ? Le ministère des Affaires étrangères fait-il appel aux ressources humaines de l’Université ? Dans ce contexte, quels sont les profils d’ambassadeurs dont nous avons besoin ? A mon humble avis, ce sont des personnes qui ont une large culture et une philosophie de développement et de communication qui doivent ouvrir les horizons. Mais cette philosophie n’est pas encore mise en place après la révolution. Nous avons besoin de leaders de projet avec des équipes solides de laboureurs (au temps de Ben Ali combien de lauréats ont dû quitter le ministère après être devancés par un médiocre fils de tel… car le département des Affaires étrangères est le monopole des pistonnés et des bien-introduits. On y gagne de l’argent et du prestige. C’est une chasse gardée. D’autre part, notre vision géostratégique qui a été façonnée par l’ère coloniale, n’a pas évolué. Les décideurs — s’ils décident vraiment — ont cru faussement que le Maghreb n’a d’avenir qu’en tant que partie intégrante de l’Europe, et devant œuvrer pour le devenir. Or le Maghreb est toujours capable de tracer sa propre voie sans s’isoler. Il en a les moyens aujourd’hui.
Et qu’en est-il de l’interventionnisme ?
Je crois que la Tunisie a relativement préservé sa capacité décisionnelle. C’est mon avis. Lorsque nous sommes coincés, nous négocions. Je pense que la Tunisie bénéficie d’une marge de manœuvre non négligeable. Et ce, depuis l’indépendance. C’est la vérité. Sauf qu’on assiste aujourd’hui à des interventions complexes où la Turquie, le Qatar, les Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, la France, les Etats-Unis et d’autres pays encore se livrent à des batailles régionales déclarées ou larvées. A mon avis, la diplomatie tunisienne doit réviser la définition de ce qui est considéré comme interventionnisme. Moi je dis que les pays du Golfe arabe préparent actuellement l’après-pétrole. Ils le font sur deux niveaux, l’un interne, l’autre sur le plan extérieur.
Et les deux nous concernent. Le premier parce que les projets de développement en cours ouvrent de grands marchés. C’est ce qui explique en partie l’acharnement d’Israël et de la Turquie à être présents dans la région (Netanyahou l’a dit explicitement). Le deuxième, parce que certains de ces pays ont actuellement un surplus financier qu’ils cherchent à investir en partie dans la région. Cette politique crée des tensions. Car il faut se faire une place dans le marché économique potentiel. Cette place n’est pas facile à obtenir à cause de l’héritage colonial.
Alors, on adopte des procédés différents, parfois meurtriers, comme au Yémen et en Libye. C’est à nous d’analyser cette situation, à travers la grille « financière » si l’on peut dire, froidement et de chercher à en profiter, en négociant notre indépendance. Il serait stupide de tomber dans le piège de ceux qui affirment que telle affiliation est meilleure qu’une autre : « finalement, c’est mieux d’être sous la dépendance de celui-ci et non de celui-là » ! Moi je dis ni l’un ni l’autre. Nous sommes capables de faire librement nos choix, d’être indépendants.
Pour finir, que pensez-vous de la personnalité tunisienne, qui a ses spécificités et devra se préserver, ne subir aucune influence ?
Je ne suis pas convaincu de ce très vieux concept. Ceux qui le défendent, libres à eux. Mais du point de vue sociologique, chaque expérience historique, sociologique dans un temps donné crée des spécificités, non chez les individus.
On ne peut trouver les éléments de cette personnalité tunisienne imaginaire dans chaque individu, pour en tirer des conclusions ! En revanche, il faut que la révolution ouvre la voie aux sciences sociales qui peuvent aider la société à se comprendre et à assimiler les bouleversements qu’elle vit. Les sciences sociales sont essentiellement critiques et aident la société, tunisienne, en l’occurrence, à se repenser. Je lance un appel insistant pour la réhabilitation des sciences sociales. C’est un facteur incontournable pour la réussite de la révolution tunisienne.