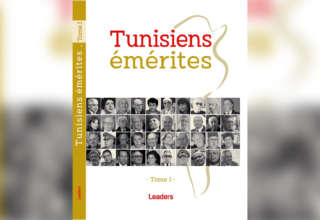Dire aujourd’hui que la révolution a suscité de la déception parmi les Tunisiens, c’est risquer de passer pour un radoteur, tant la chose est ressassée par tout un chacun. Toutefois, comme on ne manque pas de le rappeler souvent, on ne saurait lui contester une chose, à savoir qu’elle a libéré la parole. Y compris, bien sûr, la plus débridée et la plus excessive. Mais aussi celle qui cherche à comprendre. Ce qui n’est pas anodin. A vrai dire, la révolution tunisienne n’a pas seulement ouvert la voie à la parole qui s’interroge : elle l’a provoquée. Rarement dans l’histoire de ce pays ses habitants ont-ils été autant confrontés à l’incertitude quant au sens de l’expérience collective qu’ils sont en train de mener. Et c’est heureux. Si inconfortable que celui puisse être par ailleurs.
Le livre que vient de publier Latifa Lakhdhar, universitaire et ancienne ministre de la Culture, exprime, en tout cas, cette liberté retrouvée de se poser des questions. C’est elle qui l’avoue dans son introduction, en comparant la révolution tunisienne au temps : ce temps au sujet duquel saint Augustin prononçait sa formule célèbre : « Si personne ne me demande ce qu’est le temps, je sais ce qu’il est ; mais si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus ». Et c’est vrai qu’un des cadeaux que nous a fait cette révolution, en dehors de la liberté de parole, c’est l’énigme au sujet de la volonté de l’Histoire qui l’a fait surgir, elle, dans notre réel.
Le livre est donc une tentative d’élucidation de cette énigme. Une contribution au débat, sans nul doute, au sujet de ce que nous sommes en train de vivre. L’auteur y apporte son regard d’historienne, aussi bien pour nous rappeler le fil des événements récents qui ont fait basculer le pays dans sa situation nouvelle, que pour nous transporter dans un passé plus lointain qui permet de replacer notre parcours politique et culturel dans son contexte historique et d’indiquer par là même la nature des ancrages profonds qui gouvernent notre destin national. Mais elle y apporte aussi son sens de l’observation, appliqué aux évolutions de la politique et au jeu des forces en présence, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Sa lecture de l’histoire est, certes, marquée par ce qu’on pourrait appeler des « orientations politiques », qu’on situerait plutôt à gauche. Le présupposé selon lequel une révolution doit logiquement déboucher sur une « démocratie sociale » en est l’indice. Mais ce parti pris, si tant est qu’on puisse parler d’une chose pareille, n’empêche pas la richesse de la documentation et le sens de l’argumentation.
Quelques idées force
Le constat de Latifa Lakhdhar est celui d’une révolution dévoyée, avec la complicité de forces étrangères. L’inquiétude est présente et lui fait se demander si tout cela ne va pas déboucher sur une « farce », de la même façon que le changement survenu en 1987 avait pris de son côté une tournure tragique. Mais si, de page en page, le tableau de cette dérive nous est peint, avec ses acteurs et la progression de son action dramatique, le pessimisme n’a pas le dernier mot. Le combat de la femme, qui fut, après la période coloniale, un des grands acquis de la « révolution nationale » — malgré le déficit démocratique de cette dernière — demeure le lieu à partir duquel peut s’organiser le sauvetage de la révolution de 2011. Le livre n’est, donc, pas uniquement un état des lieux qui serait sévère mais neutre : il sonne finalement comme un cri de ralliement, où la femme est peut-être plus particulièrement ciblée.
Revenons sur quelques idées force qui ponctuent l’ouvrage, avant de formuler deux ou trois remarques. Première idée. Dans son mouvement initial, la révolution met à bas un système qui avait lui-même perverti le projet national mis en place au lendemain de l’Indépendance. Mais les acteurs de l’insurrection ne sont pas capables de transformer leur exploit — la chute du régime — en un projet politique qui réponde à leurs revendications. D’où un flottement qui va profiter à d’autres acteurs. Deuxième idée : cette révolution n’a pas eu la violence revancharde qu’elle a eue dans d’autres pays arabes. A telle enseigne que ce sont des figures de l’ancien régime qui vont engager les mesures les plus audacieuses en matière de rupture avec le passé. Il s’agit en particulier de Mohamed Ghannouchi et de Béji Caïd Essebsi. Troisième idée : les islamistes — le « troisième larron » — vont profiter du vide laissé et, grâce à leur capacité d’organisation et « d’ancrage social », vont utiliser les élections pour s’installer au pouvoir. S’appuyant sur une arme rhétorique redoutable, qui distingue parmi les citoyens « ceux qui craignent Dieu » et les autres, les mécréants, ils remettent implicitement ou explicitement en cause les acquis de la révolution nationale, notamment en matière de statut de la femme et de « républicanisation de l’islam ». Leur impact politique bénéficie de certains facteurs à l’échelle internationale : le soutien de pays du Golfe ; la nouvelle tendance des pays occidentaux à soutenir le conservatisme en politique ; et le fait que « l’Occident projetait, surtout après le 11 septembre 2001, d’encercler les plus violents parmi les islamistes – qu’il a participé lui-même à créer par sa politique afghane – par la promotion des « moins extrémistes » d’entre eux »(p.34). Quatrième idée : contre la tentation de certains de réagir à l’offensive islamiste par une remise en question de l’identité arabo-musulmane du pays, il faut dénoncer, dit-elle, cette « fuite en avant », qui est aussi un « déni d’histoire »… Le deuxième chapitre, le plus long, s’attarde sur ce thème de la « colonialité arabe », pour contester le fait qu’elle puisse être assimilée aux autres expériences coloniales que le pays a subies. L’auteur mobilise des données historiques que beaucoup de lecteurs gagneraient à connaître, ainsi que l’avis de nombreux intellectuels qui se sont prononcés sur la question…
Trois remarques
Que cette quatrième idée nous serve, cependant, à engager une première remarque. A savoir que l’on peut montrer que la colonialité arabe correspond à un ancrage culturel fort, supérieur en tous points à ce qui a été vécu par le pays tout au long de son histoire millénaire, cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas être questionnée et considérée même comme une contingence. Dit autrement : à accumuler les preuves et les témoignages selon lesquels l’ancrage est profond, cela ne permet toujours pas d’établir que cet ancrage est impossible à contester. Car l’impossibilité dont on parle ici est plus de fait que de droit. Même si on pense que le rejet du lien avec le passé arabo-musulman relève d’une forme d’immaturité intellectuelle, ou qu’il est tout à fait maladroit et intempestif, la remarque demeure valable : prouver que la colonialité arabe est, désormais, constitutive de l’identité de l’homme maghrébin, requiert un autre argumentaire. Il suppose que l’on ait établi dans l’absolu quand une colonialité passe dans l’identité d’un peuple et ne peut pas ne pas le faire, et quand, d’autre part, et de façon aussi nécessaire, elle ne passe pas dans son identité et ne peut le faire.
Une deuxième remarque serait celle que pourrait formuler un représentant du camp islamiste en faisant valoir que s’il a été marginalisé par le projet national post-Indépendance à la faveur d’une certaine désaffection du religieux à l’échelle mondiale dans la seconde moitié du XXe siècle, qu’est-ce qui l’empêche de bénéficier aujourd’hui du retour du religieux — phénomène relativement avéré — pour retrouver une place dans ce projet ? D’autant que cette marginalisation a pu elle-même produire un islam des marges dont on a sans doute raison de penser qu’il est dangereux. Le fait que cet élargissement de la participation induise une refonte du projet dans sa conception ne signifie pas que le projet soit lui-même remis en question dans son principe, ni que les nouveaux arrivants nourrissent nécessairement des intentions malveillantes à son égard. Les difficultés que nous observons peuvent tout aussi bien renvoyer à un manque de disposition des anciens acteurs du projet à bouleverser ce qu’ils tiennent pour acquis, en vertu d’une sorte d’inertie intellectuelle.
Enfin, le troisième chapitre du livre nous entraîne sur le terrain des islamisants et autres « néo-orientalistes » qui ont pris le parti de défendre l’expérience de l’islam politique. Le reproche leur est fait de s’immiscer dans les affaires intérieures de notre pays et de développer leurs points de vue en ayant des arrière-pensées d’ordre géopolitique. C’est très recevable. Sans doute le débat avec ces gens-là risquerait-il de prendre des proportions de nature à nuire à l’équilibre général de l’ouvrage s’il était mené de façon serrée. Il y a pourtant une certaine frustration à ne pas voir leurs arguments pleinement développés, citations à l’appui, pour que les objections manifestent à leur tour leur entière pertinence…
Ces remarques n’ont pas d’autre intention que de montrer que l’approche engagée suscite, comme par effet de rebond, des questionnements possibles et des pistes nouvelles à la méditation sur le sujet. Elles n’empêchent nullement de souligner pour conclure la richesse du contenu et le punch incontestable de l’auteur dans sa façon de défendre une certaine lecture de notre histoire. Son mérite est de relancer le débat, tout en le délimitant de façon large, en remontant loin dans le passé et en explorant les ramifications mondiales du présent…Toutefois, l’énigme a-t-elle dit son dernier mot ? A-t-elle cessé d’inviter d’autres regards à vaincre l’opacité du moment que nous vivons? Certes, non !
*Une révolution et son contraire, Edition Nirvana, décembre 2020, 173 pages, 20D