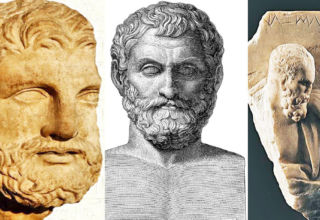Les spécialistes de l’histoire de la philosophie admettent tous que c’est en Asie mineure que prend naissance la pensée philosophique, avec les premiers présocratiques. Mais rares sont ceux qui apportent une explication à cet événement. A vrai dire, la question déborde largement le point de vue historique et entraîne nos trois interlocuteurs sur le terrain du récit mythologique grec, en tant qu’il allie déjà célébration du monde et désir de comprendre.
Po : Ainsi donc, le chemin dans lequel nous nous sommes engagés autour de la recherche sur le récit, autour des raisons qui ont amené les premiers penseurs grecs à se démarquer du discours mythologique comme moyen de dire la vérité du monde, cela nous a amenés la semaine dernière à envisager deux hypothèses dont je pense qu’elles ne sont pas de peu d’importance : la première énonce que l’acte de philosopher est, en son premier commencement, commandé par la possibilité du partage avec l’étranger et que ce partage ouvre une aventure nouvelle en matière d’expérience de la vérité. Nouvelle, cette expérience l’est en comparaison avec l’expérience de vérité offerte par le récit mythologique. Et il faut insister ici sur le fait que le discours mythologique donne bien lieu à une expérience de vérité, même si l’esprit positiviste de notre époque moderne s’est rendu la chose difficile à concevoir. La seconde hypothèse énonce quant à elle qu’il y a une éclipse de l’étranger dans le cheminement ultérieur du questionnement, que l’aventure philosophique prend une tournure solitaire qui est donc en contradiction avec les conditions de sa naissance et, enfin – si j’ai bien pris note de ce qui a été dit -, que sans cette éclipse de l’étranger, le scénario heideggérien d’une inéluctable occultation de l’être par l’étant ne se vérifierait pas…
Ph : Oui, il ne se vérifierait pas pour cette raison que, dans l’élément du partage, la pensée de l’être comme différent de l’étant se prête à une célébration. La présence de l’étranger et le partage avec lui de l’expérience de vérité ne peut que se traduire par une célébration. Or la pensée qui célèbre est une pensée moins soucieuse d’énoncer. D’ailleurs, une vérité qu’on a célébrée, quel sens y a-t-il encore à la consigner sous le froid linceul de propositions ? D’autre part, c’est la pensée qui énonce ce qu’elle dit qui ne peut s’empêcher de poser l’être comme quelque chose qui est, et donc de le ravaler au rang de l’étant, abolissant ainsi la différence entre les deux. La célébration, elle, a le pouvoir de conjurer cette chute. Elle échappe ainsi à la fatalité de l’occultation de l’être par lui-même.
Po : Voilà une précision de poids sur laquelle nous ne pourrons que revenir. Mais je voudrais par ailleurs indiquer que je suis doublement content de voir que le chemin qui se propose à nous en ce moment ait pris cette direction : celle qui confère à l’étranger une part si essentielle dans l’expérience de la pensée. D’abord parce que je trouve l’idée féconde et prometteuse, et ensuite parce qu’elle vient répondre de manière indirecte mais naturelle à une objection que j’avais formulée il y a deux semaines et qui était restée sans réponse. Il était question alors de la lecture du fragment d’Anaximandre par Heidegger, autour du point portant sur la nature de l’injustice commise par les étants. Pour Heidegger, l’injustice consiste d’abord dans la rupture opérée entre le «présentement présent» et le présent qui comprend en lui les deux formes de l’absence. C’est seulement de façon collatérale, pour ainsi dire, qu’il évoque le manque de «déférence» entre les étants, sans d’ailleurs réserver une place spéciale à cet étant particulier qu’est l’autre homme.
Md : Il me semble que c’est ce qui ressortait de la phrase d’Anaximandre. Heidegger se contentait de le relever… Anaximandre parlait bien des «eonta», des étants, et non des humains dans leurs relations les uns avec les autres.
Po : Il est vrai qu’Anaximandre parlait des «eonta» en général, sans évoquer les humains en particulier. Mais cette absence est comblée par le fait que le propos s’adresse lui-même à l’autre homme en tant qu’autre. Ce dernier est donc présent comme destinataire possible de la pensée qui se loge dans le propos. Comme destinataire et également comme partenaire. Tandis que dans la lecture que nous présente Heidegger, l’autre est rendu présent dans le texte lui-même, mais d’une manière incidente et secondaire… En fait, mon idée est que la pensée qui se laisse deviner dans le fragment d’Anaximandre ne se laisse saisir dans toute sa force qu’à la condition qu’on considère l’horizon large de sa destination. A l’inverse, si on fait abstraction de cet horizon, la phrase semble tomber dans une certaine aberration. Qu’on lise le fragment selon les anciennes interprétations, ou qu’on le lise selon l’interprétation de Heidegger, on ne voit pas ce que peut vouloir dire pour les étants de s’administrer les uns les autres châtiment et expiation, ou de faire acte de déférence dans leurs relations réciproques… Que signifie pour l’arbre du jardin qu’on aperçoit là-bas de montrer de la déférence dans sa façon de s’incliner au-dessus du petit arbuste qui pousse près de lui ? Ou de la pierre qui est à ses pieds et qui n’est pas moins un étant que n’importe quel autre étant ? Et cette pierre elle-même, que signifie pour elle de faire preuve de déférence envers l’arbre ? Ou envers le propriétaire des lieux qui rode dans les parages et qui pourrait bien vouloir l’enlever de là en même temps que les mauvaises herbes qu’il arrache ? Il est clair que cette pensée ne prend tout son sens que si elle se donne pour cible l’autre : le prochain autant que le lointain. C’est dans cet élan qui va au plus loin à la rencontre de l’autre que, tout d’un coup, la pensée d’Anaximandre s’éclaire et revêt une réelle pertinence.
Ph : De quelle façon ?
Po : Quelle que soit la lecture à laquelle on accorde sa préférence, on est en présence, avec le fragment d’Anaximandre, de la dimension tragique de l’existence humaine. Tout homme, qu’il soit grec ou perse, indien ou phénicien, égyptien ou chinois, est un être que frappe au cœur la vérité selon laquelle «de là où il vient, il retournera» ! Oui, notre vie est un songe. L’existence terrestre, qui mobilise tant de nos attentions en vue d’y assurer les conditions du bonheur, n’est qu’un souffle qui jaillit pour s’évanouir l’instant d’après : au néant dont nous venons, nous faisons retour. Or c’est seulement quand la pensée de l’homme est saisie par cette vérité tragique que prend sens l’idée que tout être – qu’il soit vivant ou pas – participe de ce même destin. C’est dans la douleur de la blessure, et seulement en elle, que tout être habitant ce monde se montre à son tour comme souffrant, expiant par sa vie déclinante la faute d’être né un jour. Ainsi, dans la même mesure où, considérant le destin tragique de l’autre être humain, on incline à lui vouer déférence, on agit pareillement à l’égard de tous les autres êtres, dans leur diversité.
Md : Ce qui voudrait donc dire que la pensée tragique qui est présente dans le mythe grec l’est aussi dans la philosophie grecque à ses premiers débuts…
Ph : Oui. C’est ce qui avait frappé le jeune Nietzsche.
Po : Je voudrais signaler ici que ce n’est pas parce que je ne me range pas derrière la lecture heideggérienne de la pensée d’Anaximandre que je lui conteste sa profondeur et son originalité. Mais une question me vient à l’esprit… Pourquoi, de toutes les régions frontalières et de toutes les zones de tension qui ont existé entre les peuples dans l’antiquité, c’est la ville de Milet, en cette époque du 6e siècle av. JC, qui a joué le rôle de foyer à la naissance d’une pensée différente ? Et pourquoi c’est dans ce temps et dans ce lieu que la présence de l’étranger a donné lieu à pareille fécondation ? Pourquoi pas ailleurs ?
Ph : Tu poses la question parce que tu as une réponse en tête ?
Po : Non. La question se pose naturellement. Il suffit de se rappeler que le contact avec l’étranger existe un peu partout et depuis bien plus longtemps, je pense, que cette période en laquelle on reconnait la naissance de la pensée présocratique. C’est une objection, en quelque sorte, à l’hypothèse qui s’est proposée à nous et à laquelle nous avons accordé notre faveur.
Ph : En effet, c’est une objection possible… Les historiens de la philosophie n’ont pas toujours une réponse claire à cette question du commencement. Il y a comme un présupposé disant que c’est grâce au génie grec, ou à sa singularité, que la philosophie a pu voir le jour. Il fallait un terreau favorable et la culture grecque l’a fourni. Mais nous sommes dans un scénario un peu différent, puisque nous partons de l’idée que c’est la rencontre entre l’ancienne pensée grecque et la présence de l’étranger sur le sol grec qui a permis la première étincelle philosophique.
Md : Le rôle du génie grec n’est pas nié dans cette hypothèse : la différence, c’est qu’il a besoin de la présence de l’étranger comme d’un catalyseur pour se manifester en tant que puissance de rayonnement universel. Or il me semble que le génie grec se révèle au départ à travers la vocation de la mythologie à se dissocier des contes et des légendes pour mettre le récit au service d’une tension vers ce qu’on pourrait appeler la vérité du monde : n’est-ce pas ?
Ph : C’est exactement ça ! Le discours mythologique est un discours qui, bien avant l’apparition de la philosophie, bien avant les penseurs milésiens et bien avant tous les autres penseurs présocratiques, est déjà tourné vers le monde du point de vue de la vérité qui se cache derrière sa manifestation. Ce qui voudrait dire que la pensée philosophique n’est pas tant une pensée qui apporte du nouveau qu’une pensée qui introduit une rupture dans la manière d’appréhender la vérité en question et de la dire. On peut donc répondre à la question du «Pourquoi à Milet et pourquoi pas ailleurs ?» en faisant remarquer que c’est la nature de ce génie grec qui, dans la forme particulière qu’il a prise, a réagi pour ainsi dire à la présence de l’étranger en accouchant d’un nouveau mode de dire le vrai. En réalité, la question a été abordée précédemment, bien que d’une façon incidente, quand nous avons dit que la pensée grecque considère comme fausse note, comme atteinte à la beauté cosmique, le fait que l’étranger soit maintenu à l’écart de la célébration de l’être par la parole. Or comme le discours mythologique est tourné, lui, vers le Grec, l’impératif de l’hospitalité autour de la pensée de l’être a commandé de donner naissance à un autre mode du dire : un mode grâce auquel l’étranger devient un possible participant. Bien sûr, en répondant de cette manière, je laisse dans l’ombre la question de savoir pourquoi, à la différence des autres peuples de la période antique, les Grecs développent une parole tournée vers le dévoilement de l’origine, et cela avant même l’apparition de la pensée philosophique…
Po : Ce qui est nouveau avec les Grecs, me semble-t-il, c’est la rencontre au sein de l’acte de pensée, entre la célébration sacrée du monde et la tension profane en vue de comprendre son origine.
Md : En quoi cette «rencontre» est-elle absente de la pensée des autres peuples ? Désolé de poser la question, mais est-ce qu’il n’y a pas un mythe autour de ce «génie grec», qui nous vient peut-être du fait que, lorsque les intellectuels européens, et avant eux arabes, ont voulu s’émanciper de l’autorité des théologiens, ils ont dû constituer une «contre-autorité», et que la Grèce antique leur a servi de matière, en quelque sorte ? Est-ce un hasard qu’Aristote se faisait appeler le «premier maître» par les philosophes du Moyen-âge ? A vrai dire, c’est toute la Grèce qui a servi de «maître» à une intelligentsia peu désireuse d’accepter le modèle d’une société placée sous l’autorité du dogme…
Ph : Aristote était le «maître de ceux qui savent». Mais on se contentait aussi de l’appeler «le maître»…
Md : Est-ce que le «génie grec» n’est pas quelque chose qui nous a empêchés de voir chez les autres peuples de l’antiquité leur propre génie, y compris quand il s’agissait d’unir la célébration du monde et la compréhension de son origine par les «lumières naturelles», pour utiliser une expression chère aux penseurs du 18e siècle ?
Ph : Il est possible que le génie des autres peuples ait été occulté par celui des Grecs. Mais il fait peu de doute pour moi que ce sont les Grecs qui ont su marier l’élan religieux de la célébration et l’audace profane de la compréhension. Après tout, que la tradition philosophique nous vienne de là, dans la profusion des œuvres qui nous ont été léguées, c’est quelque chose qui ne trompe pas. Dire maintenant que cette tradition a subi dès le départ une sorte de perversion de sa vocation, comme le fait Heidegger et comme nous le faisons aussi à notre manière, cela n’enlève rien au fait que c’est par les Grecs que tout a commencé en philosophie. Et que ce commencement lui-même n’a été rendu possible que parce que, au préalable, la mythologie grecque exprimait déjà cette union dont je parle entre l’élan religieux et l’audace de comprendre… Là où, chez les autres peuples, le désir de comprendre n’est pas loin du sacrilège, et où le récit sert davantage à combler ce désir pour mieux le faire taire qu’à le nourrir pour qu’il grandisse, chez les Grecs, il y a une passion du récit en lequel on devine que le désir de comprendre participe lui-même de la célébration…
Po : Je souscris !
Md : A supposer que vous ayez raison – et j’incline à le penser -, pourquoi, de toutes les zones frontalières de la Grèce de l’époque, c’est la région orientale de l’Asie mineure, de l’Ionie et de la Lydie, qui a connu ce phénomène de mutation de la pensée ? Si on considère qu’à la présence de l’étranger il faut ajouter une certaine tension, de manière à ce que l’union dans la célébration de l’être vienne comme une réponse de défi à l’imminence du conflit, comme une invitation à conjurer ensemble le risque de la violence et de son désordre, alors rien n’empêche de penser à d’autres régions. En Sicile, mais aussi ailleurs, les Grecs ont cohabité avec une autre puissance qui ne manquait pas non plus de représenter une menace : Carthage…
Ph : Il se trouve que la Sicile a été un autre foyer de la naissance de la pensée philosophique. Elle a donné le grand Empédocle, dont je souhaiterais que l’on se penche un jour sur son cas. Mais la grande différence, c’est que le Grec subissait en Asie mineure l’occupation perse, et qu’il côtoyait en même temps une puissance dont les visées expansionnistes constituaient une menace contre l’existence même de la culture grecque. Carthage, elle, pratiquait une politique de colonisation beaucoup moins inquiétante. C’était à l’époque une puissance essentiellement maritime, soucieuse de disposer de comptoirs ici et là en des points stratégiques pour son activité commerciale, mais très peu engagée dans le jeu de l’occupation armée des territoires étrangers.
Po : En somme, l’hypothèse de la présence de l’étranger comme condition à la naissance de la philosophie suppose deux choses. La première est un conflit possible qui représente une réelle menace, et il s’agit de le conjurer. La seconde est une injustice : la «fausse note» qu’il s’agit de prévenir et qui survient lorsque l’étranger est tenu à l’écart de la célébration-compréhension.
Md : De ce qui précède, il ressort une chose qui me paraît déterminante pour notre propos, à savoir qu’il y a deux types de récit : le premier attise le désir de comprendre, le second répond au désir de comprendre mais seulement pour le faire taire. Si le récit de la mythologie grecque correspond au premier type, comme nous le supposons, il faudrait essayer de montrer de quelle façon il attise le désir de comprendre et de quelle façon aussi les récits mythologiques des autres peuples manquent à le faire.
Ph : Le développement rationaliste de la pensée au cours des derniers siècles, et la tendance à remplacer le comprendre par l’expliquer, nous a rendus relativement inaptes à saisir ce que les anciens récits grecs pouvaient exprimer en termes de désir de comprendre, ou plutôt en termes de glorification de ce désir. C’est vrai que nous devons apprendre à lire autrement les mythes grecs si nous voulons voir de quelle façon la philosophie prolonge à sa naissance le discours mythologique tout en le transformant.
Po : C’est cette originalité grecque qui fait que le récit mythologique se distingue nettement de la légende. Alors que, chez les autres peuples, la légende tient lieu de mythe, ou se confond avec lui.
Ph : Oui, dans un cas le jeu de l’imagination est au service du désir de comprendre, tandis que dans l’autre, le désir de comprendre se perd dans le plaisir de l’imagination.
Md : Et si on essayait de s’en convaincre par l’exemple ! C’est une entreprise qui va certainement nous demander un effort, mais nous ne nous éloignons pas beaucoup de notre chemin en acceptant de le consentir. Car si notre propos est de rétablir le récit dans notre monde d’où il a été expulsé, se faire une idée plus nette de ce que c’est qu’un récit qui consacre le désir de comprendre ne peut que nous intéresser.
Ph : En effet ! Mais alors il nous faudra aussi examiner de plus près comment le mythe grec joue son rôle d’aiguillon au désir de comprendre tout en étant ce que nous avons dit qu’il est, à savoir un dialogue avec les morts. N’est-ce pas ce sur quoi nous étions tombés d’accord il y a quelques semaines ?