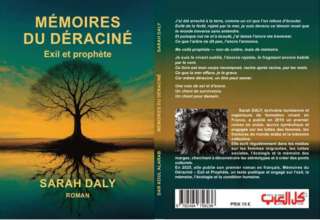Peut-on s’enthousiasmer aujourd’hui pour le personnage et l’œuvre de Camus, plus de 60 ans après sa mort ? Peut-on le faire en dehors des cercles spécialisés de la recherche littéraire, alors que la référence à Camus a quasiment disparu des débats philosophiques et que le monde a accouché, depuis son époque, de conflits tellement nouveaux par rapport auxquels ses prises de position politiques ont toutes les chances d’avoir été frappées de caducité ?
Oui, nous répond Martine Mathieu-Job, en publiant un texte d’une centaine de pages intitulé : «Mon cher Albert» avec, pour sous-titre: «Lettre à Camus». Et l’on se demande si, à travers cet exercice épistolaire posthume, qui est en réalité une forme voulue par l’une des collections de l’éditeur, l’on n’est pas en présence d’une sorte de souvenir de jeunesse: une passion ancienne extirpée de la mémoire pour les besoins de la cause. Les premières dizaines de pages nous conforteraient presque dans cette hypothèse… Avant que les choses ne se compliquent. Et que Camus se voie doucement ouvrir un chemin qui le ramène parmi nous, au cœur de notre époque. Et qu’on soit tout étonné de se rendre compte qu’on n’y trouve rien à redire. Au contraire !
Martine Mathieu-Job est professeur de littératures francophones à l’université de Bordeaux. Son nom est cependant familier à certains d’entre nous, ne serait-ce que pour cette raison qu’elle a fait un passage à l’université de La Manouba. Et que la littérature maghrébine de langue française fait partie de ses sujets de prédilection, aussi bien en tant qu’enseignante qu’en tant qu’auteur de divers textes publiés. Mais ce n’est pas seulement à ce titre qu’elle nous parle de Camus dans sa «lettre». Il existe un lien plus personnel qui se dévoile ici et qui tient en particulier au fait que, comme lui, elle est native d’Algérie. Et que, comme lui, elle continue de porter en elle la marque de ce pays, de sa lumière et de ses hommes.
Contre une certaine incompréhension
Camus compte parmi ces intellectuels français qui ont eu sur la question de l’indépendance de l’Algérie des positions peu tranchées. Beaucoup lui ont fait grief de ses réserves, ainsi que de ses critiques envers les méthodes utilisées par le FLN du temps où il commentait l’actualité à travers ses éditoriaux. A cela s’ajoute le fait que la figure de l’Arabe, ou de l’indigène, est souvent réduite à un rôle très subalterne dans ses romans dont l’action se situe en terre algérienne. C’est vrai de L’Etranger, et plus encore de La Peste. Martine Mathieu-Job ne cherche nullement à occulter cela. Elle y fait même clairement allusion : «Je comprends combien le lecteur arabe ou berbère — et tout contempteur du colonialisme — ne peut que se sentir blessé, et révolté de cette relégation, plus, de cette dépersonnalisation». On peut ne pas être entièrement convaincu par la défense qu’elle produit face au rappel de ce constat, mais il nous faut l’écouter : «vous laissez la victime arabe du premier récit dans un anonymat symbolique, reflétant le fossé séparant des communautés qui, dans ce monde colonial, se côtoient sans se connaître ; vous suggérez de façon subreptice, dans le second, qu’il y a un reportage à faire sur la condition des Arabes […] A l’opposé de l’esthétique coloniale que vous condamnez, vous ne voulez pas faire parler, et encore moins parler pour des personnages dont vous ne pénétrez pas l’univers de façon intime».
Ce qui est plus convaincant, néanmoins, c’est ce qui intervient dans la toute dernière partie du livre, quand il est question de cette œuvre majeure que Camus avait prévu de publier, et qui restera inachevée. En émerge un Camus qui échappe aux querelles, parce qu’il est à la recherche «des gens de son origine». Qui sont ces gens ? Ce sont les «blancs sans terre» : «Ils avaient tout abandonné derrière eux, ces Français, mais aussi ces Espagnols, ces Italiens, ces Maltais, par ailleurs faméliques, venant tenter leur chance sur cette autre rive de la Méditerranée». Dans ce travail de mémoire où, nous dit Martine Mathieu-Job, ce sont diverses voix qui résonnent, l’indigène n’est pas oublié : «vous en saisissez la gestuelle culturelle et la parole rare». Certes, il côtoie l’européen «nomade», poussé par la pauvreté à quitter son chez lui, et qui représente l’autre face de la présence française. Car, contrairement à ce qu’on croit, tous les français présents en Algérie — mais aussi en Tunisie et sans doute ailleurs — ne sont pas des colons, propriétaires terriens et dominateurs. Ils sont aussi du côté des malmenés de la vie, chez qui la parole est difficile et la souffrance souvent muette : à l’image de sa propre mère. Car, justement, Camus veut ici donner une voix à ceux qui n’en ont pas, ou qui en ont peu.
C’est ici sans doute que se dévoile un lien plus secret qui unit l’autrice au destinataire de sa lettre. Martine Mathieu-Job est juive sépharade. Elle n’est pas, par ses origines, étrangère à ce monde des «muets» que Camus cherche à faire revivre. Ce monde où les gens n’ont pas le même rapport à la terre que les exploitants, et qui fait que l’arrachement est chez eux si difficilement guérissable, à supposer qu’il le soit.
Ce lien par la terre, par la blessure que provoque sa perte, s’ajoute à un autre lien, à une autre «patrie», selon l’expression de Camus lui-même : la langue française ! Mais ces deux liens s’additionnent-ils comme deux choses vraiment distinctes ? Ce qui unit martine Mathieu-Job à Albert Camus, et qui nous rend cette union si importante, y compris pour notre époque, n’est-ce pas que la langue française produise des formes et des sonorités que seule l’expérience d’une blessure — celle précisément qu’ils ont souffert en commun — est à même de susciter et n’est-ce pas, d’autre part, que par le jeu de la langue l’expérience d’un arrachement en vienne à conquérir le droit de se dire, aussi bien pour son propre compte que pour celui de tous ces sans voix qui peuplent la terre ?
Si le «métier d’homme» dont parle Camus est au cœur de ce double sacerdoce — l’un au service de la langue dont on tire des possibilités nouvelles, l’autre au service de la souffrance humaine à laquelle on prête voix —, alors on se demande ce qui autoriserait de considérer que la pensée de Camus appartient au passé. En tout cas, nous avons tant besoin aujourd’hui, en Tunisie, d’une langue française qui ne soit pas le legs du colon, d’une langue qui sache se faire écho grâce auquel la souffrance humaine parvient à sortir de son mutisme. Car cette langue ne cherchera jamais à supplanter une autre langue, ni à la dominer du haut de sa modernité : elle offrira seulement ses ressources en jouant le jeu de son dépaysement, en en suscitant peut-être sur le territoire de l’autre langue qu’est la langue arabe.
Mon cher Albert, Martine Mathieu-Job, Editions Elyzad, mai 2021, 100 pages, 13d,