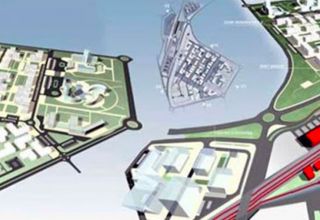Il était le premier journaliste français à se déplacer en Tunisie pour couvrir les chauds événements de la révolution. Olivier Piot, journaliste, grand reporter, formateur et auteur de l’ouvrage La révolution tunisienne. Dix jours qui ébranlèrent le monde arabe, l’un des rares récits journalistiques ayant relayé des faits peu connus sur la révolution tunisienne, a pu porter un autre regard sur une révolution aux faits mythiques, restés toujours sans réponse. Il est d’ailleurs le seul journaliste qui avait témoigné de la présence de snipers étrangers sur le sol tunisien quelques jours avant la chute du régime de Ben Ali. Dix ans après, ce journaliste spécialiste de l’Afrique et du Moyen-Orient compte rééditer son ouvrage pour suivre le processus démocratique en Tunisie qu’il a accompagné dès le départ. Aujourd’hui, après avoir lancé sa plateforme «Médias et démocratie», spécialisée dans la formation des journalistes africains et français, qu’il considère d’ailleurs comme enfant légitime de la révolution tunisienne, Olivier Piot veut faire de la Tunisie un hub en matière de formation des journalistes africains. Interview.
Dix ans après ce soulèvement populaire inédit dans le contexte arabe, quel regard portez-vous sur la révolution tunisienne ?
La révolution tunisienne de 2011 et ce qu’elle a produit depuis reste un cas unique dans l’épisode historique des «printemps arabes». Dix ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie est le seul pays où le mouvement populaire qui a conduit à la chute d’un régime n’a pas débouché sur une régression politique majeure. Certes, dix ans plus tard, de nombreuses questions posées par cette révolution ne sont toujours pas résolues, mais la transition démocratique amorcée en janvier 2011 poursuit sa route. C’est un acquis précieux comparé à d’autres pays, comme l’Égypte, qui ont connu des «contre-révolutions» ou les étincelles «mort-nées» au Maroc et en Algérie, restées inertes depuis. À ce titre, la Tunisie constitue toujours, en 2021, un pôle et une référence dans le monde arabe.
Dans votre ouvrage publié en mars 2011 (1), on peut lire le récit de la révolution tunisienne écrit à chaud par le seul journaliste étranger présent sur place, dès le 2 janvier. Vous avez alors écrit pour Le Monde et Le Monde diplomatique. Cette expérience vous a-t-elle marqué ? Dix ans après, avec du recul, comment décririez-vous ces moments ?
Oui, cette expérience m’a profondément marqué. C’est un fait rare et précieux, dans une carrière de journaliste, d’avoir la chance d’être le témoin direct de l’écriture en temps réel d’une authentique page de l’Histoire. J’ai vécu ailleurs des épisodes importants — comme en Ukraine (en 2004) ou dans les Kurdistans de Turquie et de Syrie (2014) —, mais la révolution tunisienne reste une expérience unique. À Kasserine, Gafsa, Sfax puis Tunis, j’ai assisté à la mutation d’une colère sociale en mouvement politique. Un mouvement dont personne, à l’époque — y compris la veille du départ de Ben Ali — ne pensait qu’il déboucherait finalement sur une révolution. Depuis, chaque fois que je reviens en Tunisie, je garde à l’esprit l’intensité de joie et d’incrédulité qui se lisait sur les visages des milliers de personnes rassemblées à l’avenue Bourguiba le 14 janvier 2011.
Certains mythes de la révolution restent toujours sans réponse. Dans votre ouvrage vous avez témoigné notamment de la présence de snipers étrangers sur le sol tunisien quelques jours avant la chute de Ben Ali, dites-nous en plus ?.
Je crois en effet que dix ans après la révolution, certains mythes persistent sur le déroulement des événements de 2011. C’est le propre de toute révolution que de fabriquer des mythes, mais c’est aussi un devoir pour les journalistes — et les historiens — d’interroger leur pertinence et leur portée. Les snipers étrangers recrutés en janvier 2011 pour tenter de terroriser la population, à Kasserine et ailleurs, font partie de cette «mythologie». Non pas que leur présence soit fausse ou inventée, tout au contraire : ces snipers sont «mythiques» car leur existence est restée figée dans l’angle mort des médias. Dix ans après, les faits dont je témoigne dans mon livre, aucune enquête sérieuse n’a été menée en Tunisie. Qui a payé ces «snipers de Carthage» comme ultime rempart du régime de Ben Ali ? La question reste entière…
Vous envisagez de rééditer votre ouvrage paru en mars 2011. Allez-vous apporter de nouveaux éléments ? Ferez-vous le suivi du processus de la transition démocratique en Tunisie ?
Oui, l’idée de cette réédition est de redonner au lecteur l’intégralité du «carnet de route» de mon reportage de l’époque (4-14 janvier 2011), mais aussi de prolonger l’analyse jusqu’à aujourd’hui. Mon ouvrage de 2011 s’achevait sur des interrogations qui planaient alors sur l’avenir de la jeune révolution tunisienne. En 2021, il est possible de répondre à certaines de ces questions à la lumière des étapes franchies. Et de tisser les fils d’autres questions actuelles : une contre-révolution est-elle toujours possible en Tunisie ? La paralysie des dirigeants politiques sur les questions sociales va-t-elle finir par déboucher sur une seconde révolution ? Ou au contraire accoucher d’un durcissement du régime, avec, par exemple, une entrée en scène fracassante de cette armée dite « populaire » mais dont les réseaux, l’organisation et la culture ont considérablement changé en dix ans ?
En Tunisie, aux yeux des Tunisiens, la révolution a un goût d’inachevé. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires de l’Afrique, mais aussi un homme de la société civile, selon vous que manque-t-il à la Tunisie pour répondre aux aspirations sociales de sa population ?
L’emploi des jeunes, le chômage chronique, la marginalisation des régions et la grogne salariale furent les principaux ressorts de la révolution de 2011. Or, toutes ces questions sont restées sans réponse. Tout se passe comme si, depuis dix ans, le système politique tunisien tournait en rond. Comme si les effets attendus de la révolution étaient congelés et leur solution mise entre parenthèses. Cet immobilisme social (et économique) ne pourra pas durer éternellement. Certes, sur le plan politique et institutionnel, de l’énergie a bien été dépensée, mais elle ne s’est pas transformée en leviers de changement du quotidien des Tunisiens. Sans doute manque-t-il encore un grand projet qui interroge sans tabou des questions, clés : la répartition des richesses dans le pays, la place de la Tunisie dans la mondialisation, la capacité de son économie à produire du mieux-être social plutôt que de maintenir des situations de rentes ou de subir les règles dictées par la Banque mondiale ou le FMI, etc.
Comment évaluez-vous le rôle des médias tunisiens dans l’appui à la transition démocratique ? Que peut-on reprocher aux médias tunisiens dix ans après leur émancipation ?
Je n’ai pas de « reproches » à formuler : ce n’est ni mon rôle, ni mon état d’esprit. Toutefois, à la lumière de l’expérience de la plateforme «Médias & Démocratie» en Tunisie depuis six ans, je constate que des défis ont été relevés et que d’autres restent en suspens. Clairement, les médias tunisiens ont gagné en diversité et en liberté de ton. Rien à voir avec ce qu’ils étaient du temps de Ben Ali. Mais si la Tunisie compte à présent trois fois plus de chaînes de télévision et de radios, la presse papier est déprimée. Selon un récent sondage réalisé en 2020 par Barr Al Aman Research Media, deux Tunisiens sur trois (66 %) estiment avoir « peu ou pas du tout » confiance dans les médias. Cette défiance tient sans doute aux thématiques traitées par les journalistes. Les médias du pays traitent encore beaucoup trop de questions purement politiciennes au détriment des préoccupations sociales et sociétales. Ce manque de « proximité » se double d’un déficit en enquêtes d’investigation grâce auxquelles les journalistes pourraient faire valoir leur réelle indépendance et gagner en légitimité.
«Médias et Démocratie» est une jeune plateforme qui est née des besoins des journalistes africains en matière de formation et d’accompagnement, mais aussi qui est largement influencée par votre expérience pendant la révolution tunisienne. Dites-nous plus sur ce projet que vous avez fondé en 2015 ?
La plateforme «Médias & Démocratie» (M&D) est une enfant légitime de la révolution tunisienne. À l’époque, des amis journalistes de Tunis m’avaient sollicité pour préparer l’après-Ben Ali en créant des outils d’échange avec des journalistes français afin d’accompagner la transition démocratique qui se profilait en Tunisie. D’où le nom de cette plateforme «Médias & Démocratie» qui a vu le jour fin 2015. Avec un objectif : soutenir et aider les confrères tunisiens dans leur envie d’être des acteurs de la transition. Le concept de la formation proposée par M&D est née de cette perspective : des cours théoriques à Tunis, sur des modules innovants du métier (data journalisme, investigation, réseaux sociaux, lanceurs d’alerte, éthique, chartes éditoriales, etc) et une immersion pratique dans les rédactions en France — à «Sud Ouest» (à Bordeaux) et «La République des Pyrénées» (à Pau) —, afin de suivre et d’interroger l’expérience de confrères immergés dans une «vieille» démocratie.
Le duo «médias» et «démocratie» est aujourd’hui mis à mal dans de nombreux pays. Comment évaluez-vous la situation en Tunisie ?
La Tunisie est loin d’être le seul pays où le lien entre «médias» et «démocratie» mérite toute notre attention. Nous assistons malheureusement aujourd’hui à une régression généralisée de la liberté d’informer au sens large et de la liberté de la presse en particulier. Fake news, pression sécuritaire, lutte contre le terrorisme, crise du Covid-19… tous ces facteurs réduisent l’indépendance des médias et grippent la liberté de ton des journalistes. Ce phénomène touche la plupart des pays, y compris de vieilles démocraties comme la France ou les États-Unis. Toutefois, la Tunisie s’en sort plutôt bien jusqu’ici puisqu’elle poursuit la construction de ses outils démocratiques. La création d’un Conseil de presse, comme le rajeunissement du bureau du Snjt ou encore la récente victoire du mouvement de défense de certains textes sur les médias sont des signes qui attestent la vitalité «médiatique» dans ce pays.
Vous envisagez d’ouvrir un bureau «Médias et démocratie» à Tunis. Pourquoi ? Pour qui ? Et avec quels objectifs ?
La prochaine étape pour M&D est en effet d’ouvrir en 2021 un bureau à Tunis, comme un second en Afrique subsaharienne. Mais aussi d’élargir notre capacité d’accueil en France, à Marseille et à l’ouest de l’Hexagone. Ces créations de nouvelles entités africaines et françaises de M&D visent à permettre à la plateforme de rayonner plus largement sur le continent africain, au Maghreb comme ailleurs. Elles traduisent notre volonté de faire de Tunis une plateforme d’échanges entre journalistes; un trait d’union entre la France et la Tunisie et un pont entre la Tunisie et le reste de l’Afrique. En 2021, nous aurons ainsi deux éditions, avec une immersion des promotions à Marseille (en juin) et à Bordeaux (en octobre). Ce déploiement permettra de passer de 20 stagiaires par an (depuis 2017) à plus de 60 chaque année, avec des journalistes qui seront originaires de 8 à 10 pays africains, contre trois aujourd’hui.
Depuis sa création M&D déploie son dispositif notamment en Afrique et en France. Sur quels projets travaillez-vous actuellement ? Envisagez-vous d’étendre votre champ d’activité vers d’autres pays ?
Nous souhaitons faire de Tunis un “hub” de formation en journalisme sur le continent africain. Car si la capitale tunisienne est devenue une référence en matière de transition démocratique sur le plan politique, elle doit aussi devenir un pôle d’excellence en matière de formation au journalisme. À ce titre, M&D lancera officiellement, en janvier 2021, une nouvelle formation baptisée CeJifam (Certificat de journalisme innovant francophone Afrique Méditerranée) conçue par deux universités (Ipsi-La Manouba et l’Epjt- Université de Tours) et les équipes de M&D.
Cette formation inédite soutenue par l’Institut Français de Tunisie (IFT) rassemble, d’ores et déjà, de nombreux partenaires tunisiens (Snjt, Capjc, Uftam, UPF Tunis, RSF Afrique du Nord). Une première promotion de 15 journalistes va suivre un cycle de six semaines à Tunis. Nous espérons que cette expérience donnera lieu à de futures éditions, plus ambitieuses encore. C’est notre façon de prolonger le formidable élan d’aspiration démocratique né en 2011 à Tunis.
• La révolution tunisienne. Dix jours qui ébranlèrent le monde arabe. Olivier Piot – Éditions Les Petits Matins – mars 2011