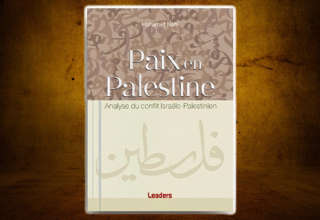Cette «gloire intérieure que donne l’assurance d’être aimée» (Alice Ferney)
«J’ai laissé ma tête se poser sur sa poitrine. J’ai inhalé son odeur. Son odeur que j’aime et que je n’atteins point. Son odeur que je sens dans ses vêtements seulement. Son odeur qui remplit mes narines, alors je me rappelle la mort. La mort de ma mère, quand il m’a serrée dans une étreinte orpheline (…). Je n’étais pas en train de lui dire «Adieu», mais en train d’inhaler son odeur dont il m’a privée. J’étais en train de l’enfouir dans mes profondeurs pour la sentir quand je voudrais.
J’étais perdue dans le flou de mes sentiments. Je hais la mort et l’exècre. Et je n’aime pas que mon père parte. Mais au bout du tunnel de mon âme, il y a quelque chose qui ressemble à une délivrance, voire à une délivrance réelle dont je ne connais la raison…» (p. 171). Mouna Abdessalem, qui remplit dans ce troublant roman de Amel Mokhtar «El korsi el hazez» (La chaise à bascule) la fonction mixte de narratrice-héroïne, étreint ici, affectueusement, au terme de la narration d’une pénible trajectoire psychologique, le frais cadavre de son père, l’éducateur Hamed Abdessalem, qui vient juste de décéder. Impotent et aphasique à la suite d’un violent choc psychique, il sort définitivement du quotidien tourmenté de sa fille, après de longues années de silence, rivé à une chaise roulante ou cloué dans son lit, ne pouvant plus lui parler et refusant même de la regarder, fâché à mort qu’il était contre elle qu’il a surprise un jour dans les bras d’un jeune homme, sur sa fameuse chaise basculante ; chaise symbolisant son autorité familiale et son pouvoir de patriarche et qu’elle a «outragée» par ce «satanique» plaisir physique volé à l’ordre phallocratique. C’est une odeur chère, familière et rassurante qu’elle cherche maintenant, dans l’avant-dernier chapitre de ce roman, à retrouver dans la dépouille de ce papa à qui elle est viscéralement liée et qu’elle a tour à tour idéalisé et méprisé, aimé passionnément, mais confusément haï au point de sentir sa mort, malgré elle, à l’insu de son conscient, comme une délivrance. Car Ahmed Abdessalem, dont l’image obsédante apparaît dans ce roman dès la toute première ligne et qui vient à la fin, sous la forme d’un fantastique cheval blanc, le fermer, après l’avoir hanté, comme un fantôme mental, de bout en bout, était un papa sévère, conformiste malgré sa modernité apparente et pudique qui a tout donné à sa fille Mouna sauf l’essentiel, c’est-àdire l’amour.
L’amour exprimé, audible à travers des mots prononcés, sonores et récurrents, visible à travers des gestes affectueux, des bisous, des étreintes chaleureuses et de tendres caresses sur la chevelure qui nourrissent l’âme et aident le «moi» féminin, encore fragile, à se construire et traverser sans encombre cette phase délicate de son développement où il est attesté par les connaisseurs en la matière qu’ entre 3 et 6 ans, les petites filles vivent une fixation sur leur père qu’elles ne parviennent à surmonter que grâce à cette nécessaire assurance d’être aimées. Assurance décisive, vécue telle une gloire intérieure, que tout prête à croire que Mouna Abdessalem n’a pas acquise et dont l’absence semble avoir laissé au plus profond d’elle-même un gouffre béant que —ni la réussite à l’école, ni son poste prestigieux d’enseignante universitaire, ni sa révolte contre l’institution morale traditionnelle dont elle ne peut s’accommoder, ni l’alcool qu’elle verse comme un baume sur ses secrètes plaies jamais refermées, ni le long célibat confortable dans lequel elle avait choisi de s’installer avec une fausse sérénité, ni les passions enflammées qu’elle a vécues ou fantasmées, ni ces hommes multiples, presque anti-sociaux, pris dans l’engrenage d’une existence passionnante, mais quasi marginale (Mejdi, Mourad, Mohamed, Youssef et Lotfi), auprès desquels elle est allée chercher de l’amour ou de l’amitié—, n’ont pu combler.
S’adressant à ce papa, elle écrit : «De même que tu as rempli ma tête de belles idées et de beaux principes que tu appelais mon trésor et ma seule fortune, de même que tu as ignoré mon âme et que tu es allé outre mon cœur.
Ainsi donc, depuis ces jours-là, jours de l’enfance première, jours où je n’avais même pas 6 ans, je ne me rappelle pas que tu m’as serrée dans tes bras ou que tu m’as embrassée, ou que tu m’as prodigué ton affection concrète, ou que tu m’as dit, ne serait-ce que par hasard, que tu m’aimais (…) Et plus mon corps grandissait, plus tu t’éloignais et t’éloignais et tu devenais avare en sentiments. Je pense que tu les taisais en toi-même (…).
Est ce que tu savais que tu avais affiné mon esprit, mais déformé mon cœur ? Est-ce que tu étais conscient de m’avoir donné la clef de tous les nœuds, mais que tu as créé en moi-même les plus grands des noeux, ceux qui résistent le plus au dénouement ? Que de fois j’aurais aimé courir avec mon corps élancé et me jeter dans tes bras pour que tu me presses !..» (pp. 144-145). Il y a là, c’est clair, le sentiment d’une immense solitude, d’un trou noir, d’un vide abyssal que ce manque grave de tendresse paternelle a laissé en elle qui a toujours retenu à grande peine sa douleur centrale et rentré ses larmes en elle ; et c’est bien ce papa qu’elle a dans la peau qui, par sa pudeur, sa maladresse ou son orgueil, l’a poussée, sans jamais le savoir, dans cette soif d’amour, fièvreuse, toujours renouvelée, jamais étanchée et qui l’a livrée en pâture à d’autres hommes avec qui nulle relation sentimale, pleine et équilibrée, épanouie, n’a pu se construire.
Toutes ont été soldées, d’une certaine manière, par l’échec, parce que hantées par le spectre de ce papa dont elle est demeurée prisonnière et qui continuait à lui mordre le cœur et la mémoire. Tout le nœud autour duquel s’organise habilement l’histoire racontée dans «El korsi el hazez» et que Mouna Abdessalem essaye désespérément de dénouer à travers un discours «thérapeutique» marqué par des souvenirs lancinants, des interrogations anxieuses et une espèce d’exorcisme «scripturaire», réside dans l’inconscient de ce personnage principal. C’est vraisemblablement ce que les adeptes de Carl Gustav Jung appellent le «complexe d’Electre». Un complexe éprouvant qui cause à Mouna un conflit permanent avec l’image du père que même la mort ne résout pas et qui, à l’ultime chapitre de ce roman (XVII), promet d’accompagner l’héroïne jusqu’à la fin de ses jours et même de s’inscrire dans l’éternité des années et du retour cyclique de l’aube et du soleil (p. 174). Car jamais Mouna ne fera totalement son deuil de son père et jamais elle ne cessera d’être rongée par cette irrémédiable déficience affective qui lui casse les ailes et endigue ses élans vers l’amour, vers la vie, et dont fut victime entre autres le triste professeur universitaire Mongi, le vieux garçon avec qui Mouna a accepté, à son corps défendant, de convoler en justes noces et qu’elle n’a enfin épousé que quelques petites heures, avant de le tromper avec son ignoble «ami» Lotfi et de le repousser avec mépris et l’humilier, comme pour se venger de l’hallucinante image du père.
Cet attachant roman de Amel Mokhtar pose aussi d’autres problèmes auxquels les femmes tunisiennes sont toujours en butte : celui par exemple de la virginité, fanatiquement, bêtement, confondue avec l’honneur de l’individu et de la tribu, ou celui, bien plus grave, des attouchements et agressions sexuelles que subissent quelquefois les fillettes, même dans des lieux où on les croit en sécurité (les jardins d’enfants !) ou même en famille (Moncef, l’infect oncle pervers de Mouna, en a sûrement une idée! pp. 136-137) ou celui encore de cette sorte de schizophrénie caractérisant le comportement de certaines femmes cultivées et modernistes qui, en s’opposant avec force à l’institution patriarcale machiste qui les réduit lamentablement à des outils de plaisir et de procréation, se découvrent quelquefois attirées par cette institution et ses valeurs. Toutefois, point n’est besoin de s’attarder sur ces problèmes, plutôt secondaires dans ce roman, car il n’ y aurait aucun intérêt particulier à suivre la narratrice sur tous les sentiers parallèles qu’elle a intelligemment ouverts dans son histoire et de se contenter de voir comment Amel Mokhtar a su écrire avec brio ce nœud central qui est le «complexe d’Electre» et nous sensibiliser, en nous procurant un vif plaisir littéraire, au sérieux handicap psychologique qu’il cause aux femmes. Amel Mokhtar, en romancière de grand talent, a, en effet, su bâtir son univers scripto-narratif dans une très belle langue arabe aisément ordonnée dans des phrases souvent courtes ressemblant quelquefois, grâce au rythme vif qui leur est imprimé, à des vers blancs, et qui sont souvent source d’un puissant effet incantatoire qui attise le désir de lecture.
L’apparente tranquillité de l’écoulement du flux narratif cache une intense fébrilité chez l’autrice due peut-être à son indignation ou à sa révolte contre les circonstances sociales frappées d’ignorance ou de perversion ayant produit cette victime tourmentée, angoissée et angoissante qu’ est Mouna Abdessalem. C’est surtout la cadence vive des phrases qui trahit cette fébrilité ou nervosité, mais aussi le caractère discontinu de la progression narrative qui échappe à l’ordre chronologique pour adopter un nouvel ordre, plus dynamique et plus nerveux, qui est celui des réminiscences, des émotions et des «associations libres» d’idées et d’images.
Disons, pour terminer, que c’est à bon droit que ce roman de Amel Mokhtar, qui a été publié plus d’une fois, pourrait être considéré, du moins à notre humble avis, comme l’une des meilleures œuvres féminines dans le répertoire du roman tunisien moderne, de langue arabe.
Amel Mokhtar, «El korsi el hazez» (La chaise à bascule), 1ère édition, Tunis, Cérès-éditions, 2008, nouvelle édition, Sfax, Dar Mohamed-Ali Hammi, 2016, 175 pages. Illustration de la couverture : Mouna Ferjeni