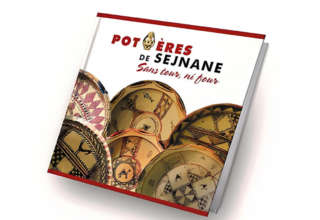Dans ce nouveau recueil de Moëz Majed, il y a d’abord le titre «Libellule» qui produit tout de suite un magique effet d’accroche sur le lecteur, l’interpellant et l’intriguant, et qui mérite d’être interrogé.
Substantif sans déterminant (ni «la», ni «une», ni «cette», ni «ma», ni «ta», ni «notre», etc.), renvoyant à un référent non-identifié, sans actualisation et sans ancrage énonciatif, il voltige, avec sa fine blancheur, sur le violet de la couverture où ses quatre «L» s’allongent, liquides, continus et glissants par-delà les voyelles aiguës, le «i» et le «u», pointue et sombre, attachées aux cris, et par delà la voyelle claire «e» favorisant la légèreté et la rapidité, et la consonne occlusive et sonore «b» suggérant le bruit ainsi que le mouvement — jusqu’à la limite supérieure de la page comme pour signifier les quatre ailes longues et étroites de la libellule et inviter au vol au-dessus de la mélancolie, de la solitude et des sombres souvenirs que pourrait signifier, selon notre approche se voulant délibérément fantaisiste ou même quelque peu «farfelue», ce violet de la couverture. Un violet sur lequel apparaît, très fragile et éphémère comme «le ruissellement des jours» (p.54), comme le temps dont le poète tente ici de suspendre le vol, comme la mystérieuse beauté cultivée magiquement par le poème, cette «créature du vent» qu’est la libellule qui se métamorphose, se renouvelle, tend à la lumière, porte les couleurs de la vie, s’agite dans tous les sens, plane et vole à grande vitesse, avant de se cogner contre le plafond, puis tomber du haut de ses rêves d’affranchissement et mourir. Ainsi serait peut-être le destin du poète !
«Prince des signifiants» tel l’a baptisé Barthes, le titre, ou plutôt ce titre précisément, nous ouvre, dans un flou savamment entretenu et puissamment expressif, la porte de l’univers poétique de Moëz Majed où ce sont des villes chères, une «meute chasseresse» (p.8) de «désirs immobiles» (Ibid.) «pendus aux fenêtres» (p.10), des amours, des émotions, des songes déchus (P. 27) des mélancolies et des douleurs, des attentes, des nuits et des jours, «des moments de quiétude» bercés par des corps ivres (p. 48) qui, comme la libellule égarée (p. 55), se laissent se transformer en une flopée de souvenirs enchevêtrés, épars, qu’emportent «les vents des steppes sourdes» (p. 52) enfonçant le poète dans son insurmontable nostalgie qui devient ce «poème inachevé» (p.28) de «toute une vie» (Ibid.), à la fois léger et grave, aux vers libres à volumétrie variable, qui s’étendent un peu ou se ramassent au gré de la fantaisie du poète ou selon le mouvement de son âme, de sa rêverie. Mais des vers souvent courts, et même très courts, se réduisant quelquefois à un seul vocable, sans nul souci de symétrie métrique et formelle, usant d’un petit espace de la page, nageant dans beaucoup de blanc typographique qui serait silence contemplatif des interprètes du mystère et de l’indicible, recueillement, prière muette pour «celui-là qu’on enterre/ sous une pluie d’automne» (p. 38), chuchotement intérieur sans bruit, une autre voix qui dit au lecteur ce que le poète ne dit pas par pudeur ou par peur de l’exubérance indécente, par retenue poétique et dont il relègue le sens à l’imagination du lecteur charmé au suprême et devenant complice.
Il y a en effet dans cette poésie tout aussi raffinée qu’élégante de Moëz Majed une exquise sobriété des vers et des strophes qui profite à une écriture lapidaire, elliptique, allusive et évasive, aérienne, procédant d’une «poétique du rare», sensiblement marquée par l’anaphore insistante, «musicalisante», la savoureuse inversion, l’atemporelle phrase infinitive, l’interrogation rhétorique et les ruptures de syntaxe, produisant tous ensemble une poéticité à régime optimal, tendre comme la soie du songe :
«Changent les temps/ changent les jours/ Changent les visages et/ changent les cœurs./ Mais qui sait donc ce qui transforme les orages en pleurs» (p. 29).
«Pleurer ce qui fut haine tenace/ toucher de sa lèvre humide l’éclair/ enterrer son orgueil un soir de grande douleur/ passer sans livrer bataille» (p. 43).
«Je suis venu aux portes de ta peau/ écouter le timbre de ton corps/ derrière tes lèvres/ closes» (p. 30).
«Est-il vraiment mort,/ celui-là qu’en enterre/ sous une pluie d’automne ? Avoir encore l’audace de pleurer» (p. 38).
Dans ce saisissant recueil de Moëz Majed, la grammaire ne risque pas du tout de passer inaperçue. Volontairement décousue par endroits, brisée quelquefois, elle s’impose aux yeux du lecteur qui y apercevrait la perturbatrice fonction de l’émotion, la volonté manifeste du poète de casser de temps à autre l’habituel ordre syntaxique plat et uniforme et de lui substituer un ordre nouveau qui s’émancipe un peu de la ligne sémantico-syntaxique logique et que commande non pas vraiment le sens, demeurant flottant ou incomplet, mais l’effet, c’est-à-dire cette émotion qui circule entre les mots et les syntagmes et qui trouble leur ordonnance ; ordonnance dans laquelle on souligne des «sauts» et des «trous», des ellipses, des anacoluthes, qui perturbent un peu la lisibilité sémantique, mais qui augmentent le coefficient de la poéticité et de l’enchantement :
« Ici, au pied du puissant ficus,/ respire une ombre éternelle/ et le vent…/ De ses amants, le plus farouche/ (p.7)
«Au ciel d’été,/ silencieuse et rosée/ la lune est ronde/ cœur abîmé» (p. 13)
Intéressant de noter aussi, qu’au niveau de l’énonciation poétique, le «Je» du poète se raréfie, se démantèle et se cache souvent en traversant les 4 sections qui se succèdent dans ce recueil («Là», «s’établir», «partir» et «se souvenir»). Dans plusieurs poèmes, s’il se dissimule, s’il n’a plus de présence scripturaire, c’est pour transparaître au travers d’un autre élément verbal lui servant de substitut et donnant une dimension universelle à l’idée, au souvenir, aux sentiments éprouvés par le poète lui-même. Ainsi, sans se dire explicitement, l’ombre du «Je» énonciatif se profile-t-elle, par exemple à la page 14, autour de la troisième personne du pluriel correspondant au sujet des trois vers de cette strophe interrogative : «Comment peuvent-ils mourir/ ceux qui s’endorment chaque soir/ sous un jasmin à Sidi Bou ?» (Vers qui, soit dit en passant, interfèrent à distance avec ce merveilleux distique de Georges Shéhadé figurant dans «Les Poésies» : «-Comment mourir/ Quand on peut encore rêver» (Gallimard, Nrf, 2001, p. 125).
Pour finir, remarquons que le surprenant texte en prose poétique dédié à la poète tunisienne Emna Louzyr ou, peut-être, composé par elle-même «Je pose ma main sur la poignée de la porte» et que Moëz Majed a jugé poétiquement productif de mettre à l’annexe de sa «Libellule» (pp. 59-61), loin de rompre l’enchantement que ce recueil produit sur nous, l’augmente et le prolonge. Écoutons : «J’aurais tant voulu garder mes mains sur tes hanches et danser encore et encore avec toi sur cette rengaine amoureuse. J’avais tant voulu plonger mes doigts dans ta longue chevelure noire et dense et y retenir le soir avant que l’obscurité ne s’en prenne à moi, à nous …» (p. 60).
Entre tous remarquable, ce recueil de Moëz Majed est à goûter avec plaisir au lever du jour, à l’accueil de la vie. Bravo, poète !
Moez Majed, «Libellule», poèmes en français, Dijon, éditions «Les presses du réel», collection «Al Dante», 2022, format de poche 12,0 cm × 17,0 cm × , 56 pages et annexe. ISBN 978-2-37896-330-9, EAN 9782378963309.
Notice — Né à Tunis en 1973 et diplômé de «L’Ecole Centrale» de Lille, Moëz Majed, qui est le fils du l’éminent poète tunisien feu Jaâffar Majed, est poète francophone et auteur de divers recueils de poèmes dont «L’Ombre…la lumière», «Les rêveries d’un cerisier en fleurs», «Chants de l’autre rive». Il est également éditeur, traducteur et essayiste. Il a publié avec Emna Louzyr, en 2021, «Tout un poème». Il est aussi le fondateur et le directeur du Festival International de la Poésie de Sidi Bou Saîd qui a atteint cette année sa huitième édition.