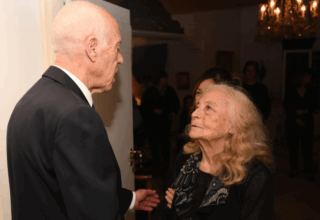Dans les premiers paragraphes d’un texte consacré au poète autrichien Georg Trakl et portant le titre « La parole dans le poème », Martin Heidegger écrit ceci : « Le dialogue authentique avec le Dit d’un poète n’appartient qu’à la poésie ; il est le dialogue poétique entre poètes. Possible est cependant, et même parfois indispensable, un entretien de la pensée avec la poésie… » Cette affirmation, prise parmi tant d’autres, donne le ton de l’attitude de retenue que la philosophie va désormais s’obliger à respecter dans son incursion sur le terrain de la poésie. Retenue qui contraste bien sûr avec la légèreté tout autant que l’assurance et parfois la condescendance auxquelles nous avions été accoutumés dans la façon dont beaucoup de philosophes nous entretenaient du sujet jusqu’à il y a peu.
Pourquoi Heidegger considère-t-il qu’il y a, à côté du dialogue entre poètes, un dialogue avec la pensée qui est possible et qui peut même être indispensable ? Parce que, dit-il, les deux ont un rapport remarquable, bien que différent, avec la parole. Et, ajoute-t-il, parce qu’il s’agit de faire en sorte que les mortels puissent apprendre « de nouveau à trouver séjour dans la parole ». Ce qui, on l’a compris, sous-entend que ces mêmes mortels que nous sommes ont désappris à séjourner dans la parole en tant que parole. Qu’entend-il cependant par le mot « parole » qui justifie pareil constat, somme toute surprenant ?
Dans le même recueil qui contient le texte évoqué à l’instant — Acheminement vers la parole — s’en trouve un autre dont le titre est : « La parole ». Et voilà comment s’y présente la réponse à la question que nous venons de poser : « Nous ne voulons pas ramener son essence à un concept afin que ce dernier livre, sur la parole, un avis universellement utilisable, une idée qui calme les esprits. Situer la parole n’est pas tant la porter que nous porter nous-mêmes au site de son être».
A la retenue qui nous interdit de ramener à nous, par l’outil du concept, l’essence désormais énoncée et pour ainsi dire empaquetée dans une formule, s’ajoute la pensée que pour « situer » la parole, il faut se porter vers elle. Ce qui signifie : se dépouiller de tous ses savoirs préconçus à son sujet et se présenter dans une posture d’humilité telle que puisse être accueilli tout ce qui, en elle, est susceptible de surprendre. Or cela est rendu possible pour le penseur quand il médite le poème : quand il se met en marche vers le « site » du dire poétique d’où surgit pour le poète, comme de sa source, « l’onde ».
Hölderlin : guide et prophète
Le poète devient ici le guide par qui nous réapprenons ce que la philosophie est peut-être bien ce par quoi ou à cause de quoi nous avons désappris, à savoir : séjourner dans le secret de la parole. Mais ce nouvel apprentissage passe donc par une approche nouvelle de la poésie où ce que nous avons à apprendre sur elle vient désormais d’elle. D’elle et non du prisme de nos savoirs constitués, ni de nos ambitions philosophiques à tout ramener au connu et à assigner à chaque chose la place qui lui est impartie.
De ce point de vue, il y a des poètes qui sont de bons guides, voire des guides par excellence, parce que leurs poèmes nous parlent de l’essence de la poésie. Et, pour Heidegger, il y en a un qui, pour ainsi dire, sort du lot : Friedrich Hölderlin ! Il est le poète de la poésie. « Hölderlin poématise l’essence de la poésie », écrit-il dans un autre texte : « Hölderlin et l’essence de la poésie ». Et il poursuit : « Mais en fondant de nouveau l’essence de la poésie, Hölderlin commence par déterminer ainsi un temps nouveau. C’est le temps des dieux enfuis et du dieu à venir »… Le guide semble endosser aussi l’habit du prophète !
Il ne s’agit pas d’ignorer ici que la lecture que fait Heidegger des poètes en général et de Hölderlin en particulier a suscité maintes réserves de la part des critiques littéraires. On lui a reproché de tirer vers sa pensée, vers ses positions philosophiques, le sens des textes poétiques dont il nous présentait une « élucidation ».
On ne peut nier pourtant qu’il ait inauguré une période nouvelle dans la façon d’approcher la poésie, même si beaucoup ont choisi d’ignorer délibérément ses conceptions. Quant aux reproches, ils ont bien sûr leur sens et au moins une part de pertinence, mais si tirer vers soi revient à recréer les conditions d’une redécouverte de la parole poétique, tout en faisant cesser cette domination qu’exerce sur la poésie, depuis sa naissance, le logos rationaliste, alors on est tenté de dire que cette façon de tirer vers soi est plus salutaire que bien des méthodes qui, sous couvert d’objectivité, se prétendent rigoureuses.
C’est un fait qu’à partir de Heidegger, à côté d’une méthodologie de lecture qui puise dans le réservoir des sciences humaines — linguistique, sémantique, psychologie, etc — va s’en développer une autre, qui s’inscrit dans le prolongement de l’approche qu’il a initiée. Ce qui ne va pas aller sans quelques écarts.
Voies heideggériennes : Gadamer et Ricœur…
Une première branche, dans les héritiers de Heidegger, est représentée par les deux grandes figures de la pensée herméneutique, à savoir Hans-Georg Gadamer et Paul Ricœur. Gadamer précise sa pensée sur le sujet dans un ouvrage tardif, où il se propose de commenter des poèmes recueillis dans l’Atemkristall de Paul Celan. Il s’agit de poèmes particulièrement difficiles à déchiffrer mais, justement, leur difficulté se prête à illustrer un point de vue fondamental de la pensée de Gadamer, à savoir que la compréhension des œuvres, comme aussi bien celle de l’altérité de l’autre homme, relève d’un jeu qui demeure ouvert. Le texte du poème devient ici le lieu d’une rencontre, qui n’a cependant jamais dit son dernier mot, même si elle exige du lecteur qu’il fasse patience afin d’habiter dans le poème. Il y a quelque chose d’impossible à combler par l’intelligence dans tout poème véritable. De sorte que toute compréhension, si juste et profonde qu’elle puisse être, n’interdit jamais qu’une autre compréhension fasse irruption, différente et néanmoins aussi juste et profonde. La puissance du texte réside précisément dans le pouvoir qu’il a de susciter cette multiplicité de lectures qui s’enrichissent sans nécessairement s’annuler. En un sens, on peut dire qu’est poétique tout texte qui ouvre l’espace de cette multiplicité infinie de lectures, restituant pour nous, à travers la personne du poète, l’idée d’une proximité de l’autre qui rime avec irréductible étrangeté.
On mesure ici, à nouveau, la distance prise par rapport à l’arrêt de mort prononcé à sa naissance par la philosophie contre la poésie en tant que discours qui dit le commencement. On peut dire en un sens que ce privilège lui est restitué, dans la mesure où le poème d’aujourd’hui, à l’instar du mythe d’autrefois, produit, non certes une explication du monde, mais une ouverture qui attise le désir de comprendre… à l’infini ! Il est vrai que, dans le cas de Gadamer, ce désir de comprendre passe par le thème de l’altérité. L’autre homme est toujours porteur d’un monde, qui ne m’est pas étranger, tout en restant insondable. Et il n’y a de monde que dans la rencontre de l’autre, dans l’expérience à la fois de l’opacité qu’il oppose et des perspectives d’intelligence qu’il ouvre. Or le poème est le lieu privilégié de cette expérience fondamentale.
Ricœur, lui, propose une approche où c’est plutôt le monde qu’est soi, ou le soi, qui devient l’enjeu de l’œuvre poétique. Pour lui, l’œuvre n’est précisément poétique que dans la mesure où, face à elle, je me découvre. Le poème est toujours un révélateur, et c’est soi-même qu’on découvre à son contact, dans l’épreuve du monde qu’il est lui-même. Ce qui distingue en effet l’œuvre qu’est le poème du simple discours, c’est qu’elle porte en elle un monde : le « monde du texte » ! Et c’est parce qu’il y a ce monde du texte qu’il m’est donné, moi lecteur, moi auditeur, de me perdre en lui et, à partir de là, et seulement à partir de là, de me retrouver. On ne se connait pas en dehors de ces retrouvailles, en lesquelles on est à la fois soi et un autre !
Là encore, la connaissance de soi n’est jamais achevée. Toute expérience d’une œuvre, en tant qu’elle est « poème », renouvelle pour moi l’expérience de ma propre découverte : elle élargit l’horizon intérieur, ouvre en moi de nouveaux territoires, provoque par le jeu de mes facettes un nouveau peuplement. De sorte que la question devient presqu’inévitable qui consiste à se demander si la dégradation du statut de la poésie ou sa répudiation ne relèvent pas d’une volonté inavouée de mettre un terme au vertige de la découverte de soi. Dans le sens où, en bannissant de sa vie le poème, on peut enfin s’en tenir à une identité plus ou moins définitive : car on aura tari les paysages nouveaux qui viennent chaque fois, dans le choc de la rencontre avec l’œuvre, bouleverser ou brouiller l’image stable que l’on se fait de soi. On notera enfin que la distinction entre poésie et prose perd ici toute pertinence, puisque ce qui fait d’un texte un poème, c’est son pouvoir d’ouvrir un monde devant son interprète, indépendamment de sa forme littéraire.
… Maldiney et Chrétien
Une autre piste post-heideggérienne, cette fois du côté de la phénoménologie, nous mène vers un auteur peu connu, mais dont la pensée fait l’objet d’une grande estime de la part de nombreux philosophes… Henri Maldiney est un penseur français dont la réflexion a marqué les esprits dans deux domaines: la maladie mentale, en s’intéressant aux travaux de psychiatres tels que Ludwig Binswanger, et l’art, en suivant de près les travaux de deux poètes en particulier : Francis Ponge et André du Bouchet. Or ce qui ressort de ses développements sur le thème de la poésie, c’est que cette dernière nous ramène au moment inaugural de la parole, qui est celui de la rencontre du mot et de la chose. Il y a, nous dit Maldiney, une faille entre la chose et sa « dicibilité première » : le poète retrouve cette faille et répète, pour ainsi dire, le geste qui consiste à la traverser. Ce qui suppose qu’il remonte du « sens lexical objectivé » du mot, c’est-à-dire du mot en tant que signe-outil, au nom ! Lequel nom correspond à sa « première demeure ».
Dans le poème, chaque mot retrouve son pouvoir de se donner son propre espace et sa propre temporalité. Il est libéré des chaînes grammaticales que lui impose la phrase prédicative qui affirme quelque chose de quelque chose. Ainsi affranchi, il renoue avec sa puissance de nomination, avec sa vocation à appeler les choses à la présence.
La poésie nous donne la possibilité de revivre ce moment de flottement qui précède la signification, ce moment de « vide » pendant lequel la chose se découvre selon une « tonalité affective ». Ce que, dans son langage, Maldiney, appelle le moment « pathique ». Le moment pathique s’oppose au moment « gnosique » qui, lui, renvoie au déjà connu du mot en tant que signifiant qui désigne quelque chose de particulier.
Par son retour au secret de la parole dans le moment de sa naissance, Maldiney est incontestablement heideggérien. Il l’est aussi par le fait qu’il s’installe dans la proximité des poètes, et que cette proximité amicale et attentive à leur parole n’a rien de passager. En revanche, on ne retrouve pas dans sa relation à la poésie cette dimension prophétique que Heidegger attribue à Hölderlin. Ce qui l’attache à eux, c’est leur façon de nous ramener par les mots au mystère des choses, à l’événement de leur premier surgissement. Il y a là comme un chemin initiatique qu’il s’agit de suivre avec eux et pour lequel ils jouent le rôle d’éclaireurs.
Mais il faut remarquer que cette expérience dans laquelle ils nous entraînent n’est sans doute pas dénuée d’une portée religieuse. Et c’est précisément ce qui a longtemps échappé à la philosophie dans sa manière d’appréhender la poésie. Car les récits mythologiques qui, très tôt, ont suscité la défiance sceptique des apprentis philosophes, tout en nous racontant des histoires incroyables, ne faisaient en réalité que laisser les mots déployer leur pouvoir d’évocation et de nomination. En un sens, la légende n’était qu’un prétexte : le commencement (arché) dont ils nous invitaient à faire mémoire était à la vérité celui des mots qui, dans le libre jeu que suscite la narration, s’emploient joyeusement à célébrer la naissance des choses en ce moment « pathique » dont nous parle Maldiney et dont nous disons qu’il est aussi religieux.
C’est pourquoi cette voie heideggérienne va pouvoir déboucher aussi sur une conception de la poésie qui va revivifier la tradition d’une certaine mystique, dans la mesure où l’expérience de la chose, en sa première manifestation, est pensée comme blessure du beau et celle de la parole comme réponse à un appel et comme chant de louange qui, bien que ciblé, n’exclut de sa gratitude ni le monde qui sert de support à la chose ni, encore moins, Celui par qui la chose est reçue comme don. Un penseur comme Jean-Louis Chrétien — qui fut à la fois philosophe et poète — illustre cette voie : il met à jour le fond religieux de l’expérience de la parole et rappelle ainsi l’enracinement de la poésie dans une relation fondamentale de l’homme avec Dieu.