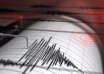Il arrive que le poète, délaissant un moment l’écriture poétique, prenne la plume pour écrire sur la poésie. Il arrive aussi que ce qu’il ait à dire à ce propos soit suffisamment consistant pour prendre la forme d’un livre, ou suffisamment pertinent pour que, même s’il couche ses idées en quelques vers, cela reste comme une référence dans le débat qui agite les théoriciens. Il arrive enfin que la position qu’il exprime ainsi en ce qui concerne la nature de l’activité à laquelle il s’adonne reçoive le nom d’ «art poétique». Nous avons eu l’occasion dans cette chronique d’évoquer ce fait, tout en signalant les différences de conception que laissaient apparaître ces manuels pratiques que sont les «arts poétiques».
Mais l’utilisation, de nos jours, du mot «poétique» renvoie à autre chose. Tout d’abord, ce mot a une extension plus large que celle de l’art poétique. La poétique traite assurément de la poésie, mais aussi de contes, de légendes, de théâtre, de roman… On peut considérer que son domaine est celui de la littérature, dans le sens de toute production —écrite ou orale— impliquant l’imagination, dont la finalité n’est pas utilitaire et qui a tendance à perdurer au sein de ce patrimoine commun qu’est pour toute société sa «culture». La poétique, ensuite, relève du discours théorique. Elle n’est pas prescriptive, mais descriptive. Elle ne prétend pas, à la différence de «l’art poétique», indiquer des façons de faire qui seraient plus judicieuses : elle se borne à relever des constantes et à les thématiser. La poétique est une théorie de la littérature.
Ce nom de poétique reprend le titre d’un ouvrage d’Aristote, qui a longtemps servi de référence à la réflexion sur le thème de la poésie. Et qui avait, du reste, cette dimension descriptive qui caractérise les travaux modernes se plaçant sous cette appellation. Mais il serait cependant très hasardeux de considérer que le traité d’Aristote n’est que descriptif. D’autant plus hasardeux que, comme le soulignent des commentateurs modernes, le discours aristotélicien sur l’art n’est pas dissociable de son discours sur l’éthique. Surtout quand il est question de tragédie. Se réclamer d’Aristote est donc légitime, mais à condition de ne pas occulter chez lui une dimension de sa pensée qui n’a pas fini de nous étonner. Nous pouvons renvoyer ici aux études de Pierre Aubenque et de Martha Nussbaum, qui ont mis en évidence l’importance du «héros tragique» —et donc de la poésie qui le célèbre— du point de vue de la morale d’Aristote. Toute «poïesis», toute activité de création qui vise le beau est impliquée dans l’action pratique, à travers laquelle l’homme accomplit son essence d’homme.
Une naissance marxiste
Une seconde remarque au sujet de ce lien avec le philosophe grec est la suivante : c’est de façon tardive que la poétique émerge en tant que cette discipline théorique dans la forme que nous lui connaissons. Si on écarte l’activité de réflexion et de traduction d’œuvres littéraires qui a marqué le romantisme allemand autour et à partir du cercle de l’Athenaum, avec les frères Schlegel et Novalis en particulier, les vrais débuts de la poétique se situent au début du siècle dernier, avec ce que l’on appelle le «formalisme russe», dont une des figures les plus connues est Roman Jakobson : un américano-russe qui terminera sa carrière aux Etats-Unis. Par conséquent, la référence à Aristote ne doit pas nous abuser. L’approche est développée dans le contexte du pouvoir soviétique, sous le contrôle de certains dogmes marxistes voulant par exemple que les références aux contextes historico-culturels des œuvres ne soient pas admises. Car elles renvoient aux «superstructures», qui sont considérées comme mensongères. Les «cultures», en quoi on croit pouvoir replacer les œuvres afin de mieux en appréhender le sens, ne sont du point de vue de la philosophie marxiste que la façon dont une société produit une représentation d’elle-même. Or cette représentation est foncièrement différente de sa vérité vraie, laquelle est exprimée à travers sa situation dans le jeu de la dialectique matérialiste.
Les théoriciens du formalisme russe vont donc s’intéresser aux structures des œuvres, de la même façon qu’en Suisse, et presqu’à la même époque, Ferdinand de Saussure soumettait le langage à la loi de ses structures. Il est vrai que l’approche qui insistait sur l’origine culturelle de l’œuvre avait ses dérives : elle pouvait noyer cette dernière dans le particularisme, pour ne pas dire le folklorisme, au point d’occulter ce qui en faisait proprement une œuvre littéraire. Le risque, à terme, était aussi que l’étude littéraire, face à des œuvres venues de traditions étrangères, se transforme en un exercice, sinon d’affirmation d’une supériorité, du moins de condescendance culturelle. Le formalisme va se présenter ainsi comme un antidote à de tels errements. Et cela en plaçant l’approche de l’œuvre à un niveau tel que tout jugement de valeur à son sujet devient hors de propos. Car l’examen prend ici une tournure scientifique, et requiert de la part de celui qui s’y engage une attitude de rigoureuse neutralité.
Mais il est tout à fait possible de considérer que le formalisme était lui-même une dérive à sa façon. Et qu’à séparer complètement une œuvre de son sol culturel, pour ne retenir que ce qu’elle présente de commun avec les autres œuvres —quant à sa structure—, on en arrivait à l’amputer de quelque chose d’essentiel, à savoir sa capacité de nous interpeller en tant que porte-parole d’une culture. Que la vision marxiste des choses ne voie pas cela d’un bon œil, c’est ce qui se laisse comprendre. Mais il n’est pas dit que cette vision doive s’imposer à nous.
On pourrait se demander comment il se fait que cette approche théorique de l’œuvre littéraire ait eu des prolongements —et quels prolongements !— en dehors du contexte soviétique et de ses dogmes marxistes. Peut-être, précisément, parce que le marxisme a trouvé dans les milieux intellectuels des pays d’Occident —et au-delà— un espace de pénétration. Même là où l’économie continuait de fonctionner selon le même modèle de domination «bourgeoise», la pensée marxiste animait une contre-culture plus ou moins subversive. Dès lors, ce qui s’accomplissait à Moscou et à Leningrad sous l’œil sourcilleux de la censure soviétique, des intellectuels le menaient de leur plein gré à Paris, à New York et ailleurs.
De la poétique à la sémiotique
A vrai dire, le marxisme n’était pas la seule motivation pouvant expliquer l’essor de la poétique. Il faut se souvenir que l’intellectuel occidental, nourri à un rationalisme militant dans sa guerre contre l’ordre ecclésiastique et ses survivances protéiformes, se trouvait au début du siècle dernier confronté à une masse d’informations venues du vaste monde. Lequel vaste monde était lui-même soumis à un ordre colonial. Certes, il pouvait se contenter de célébrer le triomphe de l’Occident et chanter les mérites d’une civilisation qui a su apporter au monde ses «Lumières» en même temps qu’elle étendait l’aire de son empire. Certains l’ont fait, et le font encore. Mais d’autres, plus nombreux sans doute, voyaient dans cette complicité avec la puissance politico-militaire de leurs pays respectifs une trahison de leur vocation d’intellectuel. Il leur semblait en tout cas que cette vocation serait beaucoup mieux honorée si, face à ce divers qui les assaillait en provenance des cultures lointaines, ils répondaient par ce qu’ils ont toujours su faire : retrouver ce qui donne au divers son unité. C’est ce qu’a fait Newton face au spectacle des lointaines régions de notre univers, puis d’autres après lui jusqu’à Einstein, et c’est ce qu’a fait la biologie dans son domaine à travers la découverte d’une multitude de lois qui gouvernent le vivant. Bien sûr, la méthode qui s’applique au domaine de la nature n’est pas la même que celle qui s’applique au domaine de la culture, où entre en scène la liberté humaine. Mais, outre que la liberté humaine est peut-être une illusion —c’est l’avis de Marx—, sa présence ne signifie pas que nous soyons obligés de subir un désordre indomptable partout où elle se manifeste. La preuve : la littérature présente, à l’intérieur d’une même culture, mais aussi d’une culture à une autre, des similitudes de structure qu’on ne saurait mettre sur le compte du hasard. Ce qui signifie donc que le monde de la culture a beau être celui de la liberté humaine, il n’en obéit pas moins à des formes de régularité. Or si ces formes existent, le travail de l’intellectuel consiste à les relever, à les analyser dans leur mode de manifestation, à en dégager le sens, à critiquer aussi certaines interprétations à leur sujet qui auraient péché par naïveté ou manque de précision…
En 1962 a été publié dans une revue française d’anthropologie —L’Homme—, un article dont l’objet était l’interprétation d’un poème de Baudelaire intitulé «Les chats». Ni le thème du poème ni le profil de son auteur n’expliquent le lien avec l’anthropologie. Mais cet article avait d’autres raisons de surprendre : il portait deux signatures illustres, à savoir celle de Roman Jakobson et celle de Claude Lévi-Strauss. Si la publication comporte sa part d’anecdotique, il ne faut pas manquer de relever cette alliance de la linguistique —Jakobson— et de l’ethnologie —Lévi-Strauss— au service d’une approche anthropologique de la poésie. La poétique s’inscrit précisément dans cette démarche. C’est ce qui fait qu’elle évolue naturellement vers une sémiotique. Dans la mesure où il s’agit en dernier ressort d’examiner de quelle façons diverses les hommes créent des signes et les utilisent. L’ambition plus ou moins avouée est de mettre en place une sorte d’entomologie des systèmes humains de signification, et d’observer à travers les productions littéraires de quelle façon ces systèmes se différencient sur certains aspects à partir de points d’unité qu’il s’agit également d’identifier et de cerner. La littérature devient ainsi affaire de «signes» (et le fait que chez nous une émission littéraire radiodiffusée s’appelle «Intersignes» est sans doute une expression de cette évolution).
L’épreuve des Tristes tropiques
Il est évident que, procédant de la sorte, l’intellectuel-scientifique ne peut plus s’accuser lui-même de céder, même inconsciemment, à quelque tentation de condescendance douteuse à l’égard de la production littéraire des lointaines peuplades du monde – comme d’ailleurs celle des bas-fonds des proches banlieues. Toute faiblesse à ce niveau est condamnée devant le tribunal scientifique, et vaut à son auteur un blâme pour non respect de la méthode. Ce qui est passible d’excommunication ! Il n’est pas interdit de croire que, face à une certaine pensée qui se complaît dans le sentiment de la supériorité occidentale, le spécialiste de poétique —en bon anthropologue— cultive quant à lui sa bonne conscience en se maintenant de façon positive dans une sorte d’opinion droite. Il préserve l’espace vertueux de sa neutralité, dont il s’érige en gardien du temple.
Explorer le terrain de la poétique moderne, c’est sans aucun doute faire connaissance avec les œuvres d’auteurs tels que Roland Barthes, Gérard Genette, Tzvetan Todorov ou Algirdas-Julien Greimas. Vaste entreprise, dont on ne veut pas laisser entendre qu’elle soit inutile, mais dont on voudrait dire seulement que la lecture de Tristes tropiques de Lévi-Strauss en livre la substance, en quelque sorte. Car c’est avec elle que nous sommes confrontés à une situation extrême – la rencontre avec les tribus amazoniennes -, grâce à laquelle nous apprenons à convertir, les uns après les autres, nos jugements sur l’autre en observations utiles concernant son mode d’existence et, par conséquent, en connaissance de l’homme ! Y compris et en particulier en tant que producteur de littérature.
Personne ne niera ici que Tristes Tropiques, c’est le modèle du livre grâce auquel on apprend une foule de choses sur la façon dont des hommes qui nous ressemblent très peu vivent malgré tout, et pleinement, leur humanité. Personne ne niera non plus que ce livre nous apprend à allier curiosité, non seulement à tolérance à l’égard de la différence d’autrui, dans ce qu’elle présente parfois de violent, mais aussi à bienveillance à l’égard des manifestations de la diversité des mœurs et du génie de l’homme en matière d’expression du réel.
Aristote : le défi d’être homme
Mais il nous semble en même temps qu’à cet enseignement manque quelque chose. Et que ce quelque chose, c’est la Poétique —celle d’Aristote— qui est en mesure de nous le donner. Car on peut étaler à l’infini les signes de la diversité de l’homme, et s’amuser même à provoquer les rencontres les plus inattendues en matière d’originalité, cela ne nous fournit pas cet élément de profondeur en quoi l’homme joue son humanité dans l’épreuve tragique. De la même façon, on peut s’atteler à décortiquer et examiner les structures communes des œuvres littéraires venant des quatre horizons de l’activité culturelle de l’homme, cela ne nous garantit pas qu’on s’y trouve en présence d’une œuvre en laquelle l’homme lance au visage du monde la vérité de son destin comme on lance un défi.
L’anthropologie envisage l’humanité de l’homme comme une donnée acquise d’un représentant du règne animal, que nous sommes. Mais pareille conception de l’humanité passe à côté de cette dimension en vertu de laquelle l’homme ne s’approprie son humanité que pour autant qu’il la met en jeu : ce pour quoi le héros tragique joue le rôle de modèle à imiter, d’objet de «mimesis» à travers son action. Du coup, elle passe également à côté de ce qui, dans la remise en jeu, nous interpelle quant à la vérité de notre propre humanité. A côté donc de ce qui attend de nous une réponse : non une connaissance qui reconstitue le puzzle des structures selon les bonnes vieilles coutumes du savant obsédé par le bon ordre des phénomènes, mais une réponse en laquelle nous interrogeons, dans le vertige critique du doute, notre façon d’assumer notre humanité… Tout en faisant écho à l’autre homme !
La poétique des savants, c’est cette poétique qui permet de se dérober au jeu du défi. Elle veut se confondre avec l’anthropologie, mais elle rate ce qui dans la voix du poète résonne comme un défi, adressé aussi bien à soi qu’aux autres, et sans lequel nous ne sommes plus des hommes. Ou alors seulement par prétention. Seulement sur le papier… des livres d’anthropologie.