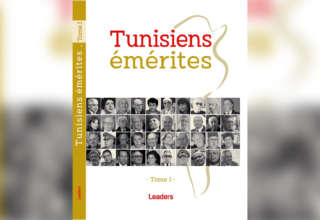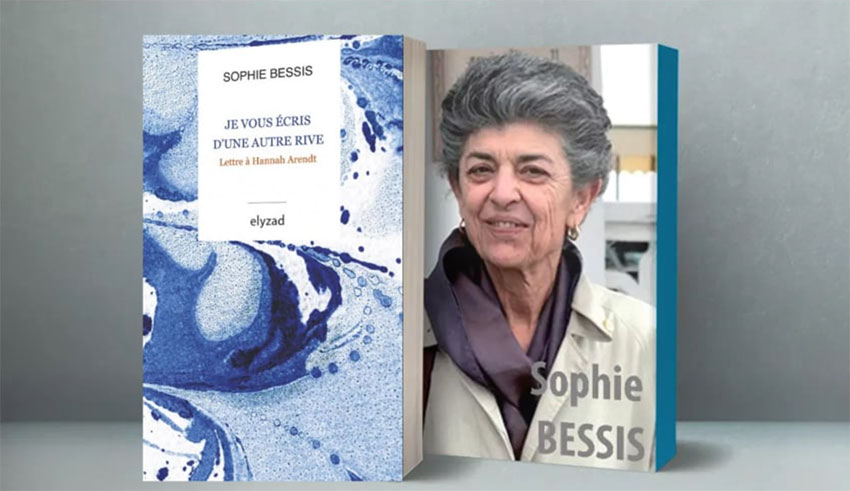
Il y a le livre savant, fouillé, érudit sans excès, qui nous ouvre des voies sur le chemin de notre passé dont on sait qu’il a été largement occulté, et il y a le livre qui déploie son texte sous le signe de la rencontre : rencontre de l’auteur avec le monde, avec certaines figures qui ont compté pour lui et qui l’ont accompagné tout au long des années, mais aussi rencontre du lecteur avec l’auteur lui-même… Et Dieu sait que, de rencontres, nous avons besoin par les temps qui courent : des rencontres qui ouvrent des horizons, qui libèrent d’un quotidien et qui, en nous mettant face à la vérité de l’autre, nous renvoient à la nôtre.
En publiant son dernier livre, Sophie Bessis est passé du premier genre au second. L’ouvrage est modeste par la taille, mais certainement pas par les sujets qu’il aborde. On peut en relever trois qui, personnellement, m’ont interpellé et qui démontrent sans doute la pertinence et la fécondité de la rencontre comme option éditoriale. Premièrement, la « tunisianité », par-delà l’exiguïté de ses représentations courantes et de son cachet nationaliste. Deuxièmement, la question palestinienne. Le dialogue avec Hannah Arendt sur ce sujet offre une approche libérée des rigidités idéologiques, d’une rare sévérité à l’égard du projet sioniste, mais sans complaisance avec l’attitude arabe. Troisièmement, notre monde, tel que livré à la machine capitaliste, qui broie les particularités humaines tout en blessant continuellement la nature… et dont l’actuelle pandémie du coronavirus pourrait être une réponse. Sans présager de la suite, on peut donc saluer l’initiative de l’éditeur Elyzad d’avoir lancé cette formule qui invite un auteur à écrire une lettre à une personnalité éminente de son choix : le premier né de cette idée nous montre qu’on peut en faire une belle lignée. Bien que l’exercice ne manque pas d’embûches. La réussite de cette expérience inaugurale tient peut-être à la relation particulière qui existe entre l’auteure et le personnage de Hannah Arendt : une relation où l’admiration et l’amitié se mêlent parfois à une critique qui prend des tons de révolte. Heureux mélange dont il ne s’agit pas de faire une recette, bien sûr. La pandémie, qui jette sur notre monde une ombre sinistre et qui condamne beaucoup d’entre nous à la solitude, n’aura pas fait que des ravages si elle nous réconciliait, non seulement avec la lecture, mais aussi avec une expérience du texte qui est aussi expérience de l’Autre sans être simple divertissement. Qui peut avoir partie liée avec ce que l’auteur, dans la toute dernière phrase de son texte, appelle « l’aurore ».
Le Juif « dés-orienté »
Mais, au risque de paraître trop élogieux — je réserve quelques critiques pour la suite —, il faut dire que l’écriture de Sophie Bessis est de celles qui donnent du plaisir à lire. La rigueur s’allie à l’élégance, sans jamais tomber dans un style artificiel, sans pécher par quelque narcissisme que ce soit. Ce n’est pas anodin comme remarque, quand on sait que l’auteure revendique avec force, en même temps, son appartenance à la Tunisie, à son « rocher de Carthage » et à son passé familial de « juivarabe ». Car nous, Tunisiens, ne savons pas toujours faire le meilleur usage de l’héritage qu’est la langue française. Nous avons besoin de matière littéraire qui nourrisse notre imagination et qui nous permette de nous approprier cette langue sans que ce soit sous le signe d’une désertion de notre monde. Ici, il est au contraire question d’attachement. De désir de retour, pour elle-même et pour tous ceux qui ont été amenés à quitter cette terre sous la pression des événements. Autrement dit, il y a là une manière de parler le français qui doit nous intéresser plus que d’autres. Et qu’on peut difficilement soupçonner en tout cas de porter en soi les germes de quelque « colonialité ». « C’est donc que le mélange est un héritage dont on peut faire un présent. Il ne se divise pas. Je l’ai pris entier, je veux tout, mon orient et mon occident, et c’est avec ce tout qu’il nous faut construire. » La phrase, en pages 66 et 67, sonne comme un éclat de voix. Elle exprime une revendication personnelle, mais se propose aussi, modestement, comme réponse possible au problème palestinien. Sophie Bessis, qui reprend à l’occasion sa casquette d’historienne, nous rappelle les faits qui ont marqué la création de l’Etat d’Israël. Le projet sioniste, qui a suscité dès le début les réserves de Hannah Arendt malgré le contexte de la seconde Guerre mondiale ; la politique de colonisation de la Palestine qui a puisé dans les populations juives des pays arabes (celles d’Europe avaient été en grande partie décimées) en ne reculant pas devant des actions terroristes déguisées pour hâter le mouvement des départs ; la complicité des pays arabes qui rêvaient d’une modernité sous le signe de la pureté « arabo-musulmane » ; la consonance occidentale que les Juifs d’Israël ont voulu donner à leur présence en Palestine et qui plonge ses racines dans des conceptions auxquelles Hannah Arendt n’était elle-même pas étrangère… Face à cela, nous dit Sophie Bessis, il s’agit aujourd’hui pour le Juif de se réconcilier avec son appartenance orientale et, au-delà, de se libérer d’un nationalisme que son statut d’ancienne victime n’empêche pas de faire évoluer vers du racisme. Bien sûr, cela suppose par ailleurs que les Arabes cessent de leur côté de faire de l’antisionisme un expédient pour une affirmation identitaire sans cesse exacerbée, et qu’ils explorent aussi d’autres manières de vivre leur modernité : des manières par rapport auxquelles l’Occident pourrait être présent autrement que sous la forme de ses produits de consommation, et où la diversité des minorités retrouverait une place nouvelle.
Un point de vue des Lumières ?
Cette solution n’est peut-être pas une panacée, mais on ne saurait lui dénier le pouvoir d’alléger les tensions si elle venait à être prise en considération par les décideurs. Peut-être convient-il d’ailleurs de ne pas chercher à en finir avec ce conflit une fois pour toutes. C’est ce que Sophie Bessis semble nous suggérer à la fin. L’acharnement à lui trouver une solution n’est pas forcément ce qu’on lui apporte de mieux. Il y a aujourd’hui des défis communs qui touchent à l’avenir, et que Hannah Arendt avait évoqués déjà en appelant à les envisager « pour que cette planète reste habitable pour l’humanité ». Ils requièrent de nous que nous dépassions les problèmes régionaux, ou notre tendance fâcheuse à trop régionaliser les problèmes : ce qui empêche souvent de dégager pour eux des issues salutaires. Qu’il nous soit permis ici d’exprimer notre accord avec cette approche de l’auteur, même si ce n’est pas vraiment notre rôle de donner un avis. Un point seulement nous semble se prêter à une remarque, et dont il serait d’ailleurs intéressant de voir quelle réponse Hannah Arendt y aurait apporté si, se levant d’entre les morts, elle avait pu prendre la plume à son tour. Elle qui a consacré sa thèse sur le thème de l’amour chez Saint Augustin, pouvait-elle souscrire à une vision qui voit dans le besoin de Dieu, tel qu’on en constate en effet les manifestations de nos jours, le signe sans ambiguïté aucune d’un retour des confrontations meurtrières des cultures ? De ce qui permet « qu’on recommence de commettre des crimes en son nom » ? Ce regard, que beaucoup d’événements tragiques sont certes venus conforter, en recueille-t-il pour autant toutes les garanties quant à la justesse de son appréciation ? Nous y voyons l’héritage des Lumières européennes, par lequel notre auteure tombe peut-être dans le travers qu’elle reproche à sa destinataire, à savoir celui de forcer le monde à s’insérer dans le prisme de l’Occident. Le retour du religieux peut alimenter des inquiétudes. Comment ne le ferait-il pas ? Les versions les plus ostensiblement inoffensives du religieux n’échappent elles-mêmes pas au soupçon, dès lors qu’elles continuent, même à leur insu, d’user du nom de Dieu au service de logiques identitaires. Mais l’enfermer complètement dans ses représentations anciennes, et lui dénier la capacité de se renouveler et d’être partie prenante dans la recherche des solutions à notre monde, peut aussi alimenter des inquiétudes… Il y a, entre la candeur coupable et la prudence du regard qui observe, une séparation ténue qu’on ne perd rien à connaître et à pratiquer, si on ne veut pas glisser dans la violence d’un jugement sommaire.
« Je vous écris d’une autre rive : Lettre à Hannah Arendt », 89 pages, éditions Elyzad, mars 2021