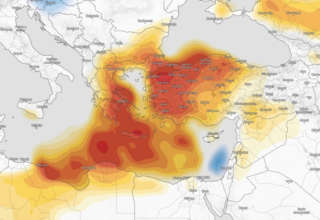Figure incontournable de l’herméneutique moderne, Hans-Georg Gadamer (1900-2002) nous a légué le commentaire d’un poème issu de l’œuvre de Paul Celan : Cristaux de souffle (Atemkristall, 1965). Le texte offre un double intérêt : premièrement, nous présenter la conception de Gadamer pour ainsi dire en action, à l’épreuve de cette chose énigmatique qu’est le poème. Deuxièmement, nous donner une idée de ce que provoque comme effet particulier la rencontre entre la théorie herméneutique et le texte poétique. Ce commentaire intéresse donc tous ceux que la recherche sur les chemins de la réflexion philosophique pousse à mieux connaître la pensée d’un auteur majeur du XXe siècle, qui fut disciple de Heidegger et, dans le même temps, celui qui s’en démarqua d’une façon dont on pourrait dire qu’elle est la plus « signifiante ». Mais il intéresse aussi ceux qui, au-delà de Gadamer, s’interrogent sur la façon dont l’art d’interpréter qu’est l’herméneutique aborde le poème : quels outils et quelles règles de savoir-faire se trouvent engagés ? Sachant que, aussi affutés et transformés qu’ils puissent être, ces outils et ces règles n’en portent pas moins la marque d’une tradition. Car il y a bien une tradition herméneutique dont, en un sens, Gadamer n’est qu’un représentant. Représentant tardif, représentant éminent, mais représentant !
Or ce qui ne manque pas de surprendre, c’est le titre que Gadamer donne à son commentaire : Qui suis-je et qui es-tu ? (Wer bin Ich, wer bist Du ?). L’indication est à prendre au sérieux. Elle nous annonce que, à la faveur du travail d’approche, ce qui va être en jeu dans l’interprétation du poème, c’est l’identité du poète. La lecture du poème va permettre de répondre à la question suivante : qui est l’auteur ? Qui es-tu, toi le poète qui parle derrière ces lignes que je lis ? Tout texte ne renseigne pas sur son auteur. Il en est qui ne disent absolument rien, tant ils sont impersonnels. D’autres, qui sont justement plus « personnels », nous donnent des indices — plus ou moins fiables — sur le profil de qui les a rédigés. De là à prétendre toucher pour ainsi dire du doigt l’identité de l’auteur dans sa vérité profonde, voilà qui semble relever d’une ambition excessive. Or Gadamer nous prévient d’emblée qu’avec le poème dont il entreprend le commentaire, c’est bien de cela qu’il s’agit. Et il va plus loin. Beaucoup plus loin même. Puisqu’il annonce aussi que ce n’est pas seulement l’identité de l’auteur du poème qui va se manifester : c’est également le « je » du lecteur-interprète ! Le texte va servir de révélateur de qui je suis, moi qui m’aventure sur cette terre étrange des mots du poème et de leur résonance.
Un point de vue romantique
Mais il se peut que la découverte de l’autre et la découverte de soi ne constituent pas deux événements distincts dans le travail d’interprétation. Il se peut que la vérité du poète dans son altérité ne se laisse découvrir à moi que pour autant que je me sois d’abord avancé dans sa direction et que, dans ce mouvement vers lui, je me sois révélé moi-même. A bien y réfléchir, on se rend compte d’ailleurs qu’il existe une certaine absurdité à vouloir faire l’épreuve de la vérité de l’autre, sans rien dévoiler de sa propre vérité ou même en n’en dévoilant qu’une partie. C’est dans le même mouvement que je me porte à la rencontre de l’autre dans son altérité et que je m’offre moi-même à sa connaissance. A l’inverse, plus je me réserve, plus je m’interdis l’accès au point de rencontre. Je peux alors m’imaginer que je connais quelque chose de l’autre, voire toutes sortes de choses, mais non pas « qui » il est.
Il n’en reste pas moins que le poème est le lieu d’une double manifestation : celle d’un je et celle d’un tu. On peut mettre l’accent sur l’un ou l’autre : faire de la découverte du « tu » le moment d’une révélation du « je » ou, en sens contraire, partir de la révélation du « je » pour envisager ce qui ouvre sur la singularité du « tu ». Dans les deux cas, le poème nous projette dans une expérience de connaissance d’ordre psychologique.
A vrai dire, l’herméneutique n’a pas attendu Gadamer et son commentaire du poème de Paul Celan pour nous mettre devant cette configuration des choses où l’interprétation du texte poétique débouche sur l’événement d’une rencontre, à l’occasion de laquelle l’âme de l’interprète se connaît elle-même tout en connaissant celle de l’auteur. Il faut rappeler que Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834), qui est considéré comme le fondateur de l’herméneutique moderne, avait justement défini sa conception de l’art d’interpréter comme une façon pour l’interprète de découvrir, dans l’œuvre de l’auteur, sa propre idée. A la faveur de la réduction du texte à la parole vive qui le sous-tend, explique-t-il, l’interprète reconnaît que ce qui se dit ne lui est pas étranger. Qu’au fond, il ne lui appartient pas moins. Le contact avec l’œuvre ne fait que le mettre face à une partie jusque-là inconnue de sa pensée à lui. Elle fait ainsi reculer les limites connues du soi. Car, à la différence de ce qui prévaut dans le monde physique, il n’y a pas ce qui est à l’autre ici et, là, ce qui est à moi. Dans le monde de l’esprit, ce qui appartient en propre à l’autre révèle au contraire un de mes territoires cachés. Dont il suffit que je reconnaisse l’écho en moi pour qu’il devienne mien. La propriété de l’autre ne marque donc pas les limites de ce qui m’appartient. L’exploration, pour peu qu’elle porte sur un texte à caractère poétique, élargit le domaine de ce qui, tout en étant commun, est propre à chacun.
En un sens, du point de vue de Schleiermacher, l’herméneutique ne sert à rien d’autre qu’à réaffirmer cette vérité, qui est par ailleurs la grande trouvaille de la philosophie romantique d’un Schelling : l’identité de soi se déclare dans la découverte de son appartenance à l’Esprit universel. L’épreuve de l’œuvre, et par elle de l’altérité de l’autre, m’apprend que la représentation que je me fais de moi-même ne suffit jamais à me contenir : elle est prise en défaut et, dans le moment précis de la défaillance, s’affirme la primauté de quelque chose de plus grand que moi au sein de ce qui constitue ma propre identité. Ce quelque chose de plus grand, c’est l’Esprit avec un grand E, qui anime le monde : tout le monde, dans sa dimension également animale, végétale et minérale, et pas seulement le monde des hommes dans la diversité de leurs cultures.
Ricœur : le monde du texte
Il est assez clair, donc, que Gadamer n’a pas tout à fait innové : cette façon de viser l’âme de l’auteur est une ancienne préoccupation de l’herméneutique, par rapport à laquelle les techniques philologiques et historiques de compréhension du texte et de son contexte ne sont qu’un moyen. Le moment final et décisif du processus de compréhension est psychologique : il s’accomplit lorsque l’âme de l’auteur s’offre à l’intelligence de l’interprète, parce que ce dernier saisit en quoi le projet de l’œuvre — dont le texte devant lui est l’expression — en découle de manière nécessaire. Et le fait que l’interprète comprenne en même temps que le projet en question est aussi le sien confère à l’acte de compréhension une force d’adhésion particulière, qui demeure foncièrement étrangère au processus de l’explication scientifique, laquelle s’occupe des phénomènes selon une approche simplement « objective ».
L’élément psychologique est très certainement ce qui fait que l’herméneutique ne se laisse pas ramener à une simple technique exégétique. On retrouve cette affirmation, encore plus présente peut-être, dans la pensée de Paul Ricœur (1913-2005), qui est l’autre grande figure de l’herméneutique moderne. Bien que le philosophe français se distingue des deux précédents en ce qu’il considère que le texte, dès lors qu’il est écrit et publié, acquiert une autonomie en vertu de laquelle il cesse d’être le reflet de son auteur. Ricœur se dégage ainsi de toutes les querelles liées à l’argument du subjectivisme opposé à la conception romantique du je. Argument selon lequel ce que l’interprète prétend découvrir au sujet de l’âme de l’auteur pourrait n’être rien d’autre que la projection sur ce dernier de sa propre subjectivité. Il invoque à ce propos l’autorité de Nietzsche pour rappeler que rien n’est plus étranger à l’homme que l’autre homme. En revanche, il maintient et renforce même l’idée que le texte de l’œuvre, ou du « poème » dans son sens large, est le détour nécessaire par lequel on se découvre soi-même. Pour lui, ce n’est pas le contact de l’auteur, en tant qu’altérité, qui donne lieu à une manifestation de soi : c’est l’épreuve du « monde » du texte ! Car toute œuvre digne de ce nom – et elle n’en est digne que parce qu’elle est poétique – porte en elle un monde : un monde qui élargit mon horizon. Qui me pousse à conquérir les possibles que je porte en moi, par lesquels seulement je suis vraiment qui je suis.
Contre l’option freudienne
On comprend d’ailleurs pourquoi Ricœur s’est tant intéressé à la psychanalyse, et pourquoi aussi il a consacré tant de travaux à en faire la critique. De son point de vue, la psychanalyse représente justement cette tentative de se connaître soi-même directement, sans le détour du « Poème ». La psychanalyse, en réalité, met en œuvre une sorte de technique d’interprétation qu’elle applique à l’individu. Son but est thérapeutique. Il s’agit de surmonter des états névrotiques qu’on pourrait qualifier de troubles de l’identité. Mais cette approche thérapeutique n’en comporte pas moins des positions théoriques générales. Elle prétend définir ce que c’est pour le je de se manifester dans sa vérité, que l’on soit ou non face à un cas de pathologie. Et la définition qu’elle met au point ne confère pas d’importance centrale à l’œuvre d’art en général, et au poème en particulier. Tout au plus y a-t-il ce que Freud appelle une « sublimation » du désir, par quoi l’artiste révélerait – mais en leur donnant une forme plus en accord avec les exigences éthiques et esthétiques dictées par la vie en société -, les pulsions inconscientes qui logent dans les profondeurs du moi. Ce thème est développé de façon spéciale dans un ouvrage, publié en 1905 : Trois essais sur la théorie sexuelle.
Mais, du point de vue de Ricœur, l’herméneutique psychanalytique, qui entend donc se passer de l’œuvre comme médiation nécessaire, débouche moins sur une manifestation du moi que sur sa dilution : dilution dans l’universalité de l’élément vital et sexuel censé nous gouverner de façon plus ou moins souterraine, et dans lequel nous sommes condamnés à rester comme englués. C’est en grande partie contre cette conception freudienne qu’il développe sa propre idée de l’herméneutique. Ricœur reconnaît à Freud le mérite d’avoir jeté un juste soupçon sur l’équivalence entre « moi » et « conscience de soi ». Toutefois, contre lui il affirme que se libérer de cette fausse équivalence ne s’accomplit pas à travers un retour vers cette instance présupposée qu’est « l’inconscient », mais bien plutôt à travers la réconciliation avec l’infini des possibles qui sont en l’âme humaine, et qu’ouvre pour cette dernière la mise en relation avec « l’œuvre ».
Bref, s’il fallait nous résumer au sujet de Ricœur, nous dirions que le vrai psychanalyste qui nous réconcilie avec la profondeur de notre moi, c’est… le poème. En tant que « monde du texte » dans lequel on se perd, pour seulement ensuite se retrouver dans une nouveauté insoupçonnée ! Mais, comme nous le signalions tantôt, ce n’est pas par le poème que nous pouvons connaître son auteur : lui nous demeure inconnu, soustrait pour ainsi dire à notre regard par l’écran de sa création, livré à la solitude de sa singularité dont il élargit certes l’horizon, sans toutefois nous la rendre jamais plus accessible. Mais la question ne manque pas de surgir : est-il bien vrai que la connaissance de l’auteur représente une entreprise illusoire ? Que penser du « qui es-tu ? » dans le titre du commentaire de Gadamer ? Est-ce l’objectif de quelqu’un qui fait fausse route ?
Une dimension oubliée
Nous sommes ici en un point de divergence entre deux monstres sacrés de la pensée philosophique, et il s’agit de se garder de toute immodestie en prétendant vouloir les départager. Ce qu’on peut faire, éventuellement, c’est essayer d’atténuer l’opposition entre eux. Comment ? En montrant d’abord que le « tu » du poète ne se donne à connaître chez Gadamer qu’en ouvrant un espace pour « plus ample connaissance », comme disait autrefois le langage des petites annonces à la rubrique des rencontres, mais dans un sens différent. Car rien n’est jamais acquis dans cette connaissance qui nous occupe : ce qui est connu donne lieu toujours en même temps à un projet de connaître. Autrement dit, plus l’auteur du poème est connu, plus il est à découvrir. L’étrangeté de son être croît à mesure qu’il nous devient familier. Par ailleurs, l’œuvre chez Ricœur a beau être autonome, lancée dans le monde où elle se donne son propre destin, elle n’en porte pas moins la marque de son auteur, ne serait-ce que par son absence, ou sa présence fantomale. Le monde du texte dans lequel je suis, moi lecteur-interprète, invité à me perdre, n’aurait peut-être pas cette puissance dépaysante, cette capacité à m’exiler, si ce n’est cette existence en creux de l’auteur qui, furtivement, ouvre grandes les portes de l’ailleurs. Oui, l’œuvre éclipse son géniteur dès lors qu’elle est publiée et qu’elle entame son voyage dans le temps, mais cette éclipse n’est pas pure et simple disparition : elle se fait sentir, comme une ombre qui est d’autant plus omniprésente qu’elle est discrète. De sorte qu’en s’engageant dans le monde de l’œuvre, il se peut bien que l’on soit, sans le savoir, en train de pister l’auteur qui se dérobe : en train de se perdre avec lui.
Ce que nous enseigne en tout cas la tradition herméneutique, c’est que, face au poème, l’interprète est interprété : que ce soit à travers la rencontre avec l’auteur ou à la faveur de la découverte du monde du texte. Sa compréhension est toujours double : elle porte sur le contenu du poème et, de façon inévitable, sur qui il est, lui lecteur. Quant au poète, s’il se donne à connaître, c’est sur le mode du retrait et d’une façon telle qu’aller à sa rencontre, c’est en quelque façon faire l’expérience d’une déportation hors de soi, d’un exil dont on ne revient jamais le même.
Pourtant, il nous semble que le poète peut nous entraîner sur un terrain qui n’est pas celui de la psychologie, mais celui de l’Histoire. En ce sens qu’au-delà des perspectives de découverte axées sur le « je » et sur le « tu », il y a dans le poème une dimension essentielle, oraculaire, qui entend peser sur la destinée des hommes et du monde. Cette dimension — un peu oubliée par les herméneutes — n’est pas séparable du dialogue qui existe entre les poètes, du jeu d’échos auquel ils prennent part, chacun à partir du timbre de sa propre voix. L’obscurité de leur langage ne vient pas seulement du fait que le poème est voué à nous entraîner sur des chemins où, en nous perdant, il nous est donné de nous retrouver. Il vient aussi du fait que, dans le temps de détresse, les poètes sont comme ces guerriers mis en alerte, et qui se parlent en langage crypté du haut des promontoires qu’ils occupent. Le fait que leur parole énigmatique nous attire dans leur sillage ne l’empêche pas d’être en même temps un cri de ralliement et une voix démultipliée dont la puissance veut changer la face du monde.