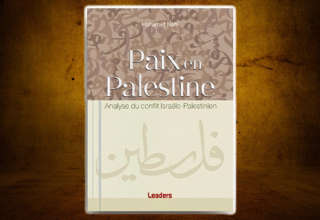Il règne aujourd’hui une sorte de consensus au sujet de la gravité de la menace qui pèse sur la diversité des langues parlées par les hommes sur la planète et, dans le même temps, au sujet de la bénédiction que représente cette diversité, comme le soulignent à notre attention, et depuis bien longtemps déjà, maints anthropologues. On doit pourtant se souvenir qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Et que le regard de celui qui parcourt les continents en s’émerveillant, tel un entomologiste, devant le génie des peuples à dire le monde et les choses de façon si variée, ce regard a son pendant dans celui qui se demande comment tous ces peuples de la planète vont pouvoir se comprendre et agir ensemble. Puisque telle est la volonté de l’Histoire que les peuples ne restent pas indéfiniment coupés les uns des autres : leurs destins se mêlent, de façon inéluctable !
Dans la Bible, l’épisode de la Tour de Babel suggère fortement que la diversité des langues n’est pas du côté de la bénédiction, mais de la malédiction. Ou en tout cas de la punition : les hommes ont entrepris la construction d’une ville et d’une tour «dont le sommet touche le ciel» ! Et plus rien ne les arrêterait dans ce qu’ils projettent. Il s’agit de faire en sorte qu’ils «ne se comprennent plus entre eux» !
Parler de punition au sujet de la réponse divine correspond cependant à une lecture, qui n’est pas la seule. On pourrait considérer, à l’opposé de cette interprétation, que la vraie malédiction est celle du projet humain lui-même, puisqu’il revient à combler l’espace entre terre et ciel. Donc à se priver de ciel ! Que l’on songe à la vie des New-yorkais : le peu de soleil qu’ils reçoivent en marchant le jour dans les rues de leur ville peut être une métaphore renvoyant au rétrécissement du monde qui résulte des projets humains d’atteindre le ciel. En ce sens, la multiplicité des langues serait ce qui permet aux hommes à la fois de rester fidèles à la terre et, à partir d’elle, de laisser advenir le feu du ciel dans leur existence…
Joutes oratoires et impérialisme linguistique
Mais le récit de la Bible évoque autre chose qui peut attirer notre attention, à savoir qu’il y aurait une langue unique, parlée par tous les hommes avant qu’ils ne soient dispersés à travers la terre en vertu de la décision divine. Ce thème est absent du Coran, où il est pourtant question de la Tour de Babel. Mais il a suscité bien des rêves en Occident au sujet de la possibilité de rétablir une langue universelle parmi les hommes. Sans doute que le latin a servi un moment de préfiguration de cette langue universelle. On y voyait la promesse de peuples désormais pacifiés dans leurs relations les uns avec les autres, à l’image de ce que fut l’empire romain à l’époque de César Auguste tel que décrit par le poète : «Du nord au midi, du couchant à l’aurore / Que, victorieux, flottent ses étendards / Aux déserts que le soleil dévore / Comme au pays du givre et du brouillard».
Ces vers de Horace, dits en latin, avaient vocation à résonner dans tout le territoire de l’empire, en apportant la double nouvelle que les malheurs de la guerre étaient conjurés et que c’est à la puissance du glaive impérial qu’on le devait. Mais un troisième message, plus implicite, était que c’est grâce à cette langue latine du poème, comprise désormais «du nord au midi et du couchant à l’aurore», que redevient possible et la vie paisible et tous les progrès de la civilisation qui vont avec. Il faut que triomphe une langue et que se taise l’éclat des autres pour qu’advienne la grande concorde. Tous les empires ont eu ce credo «politico-linguistique», le musulman ne faisant bien sûr pas exception… La sacralisation de la langue arabe, liée elle-même au dogme du Coran incréé, est une option théologique dont on ne saurait ignorer la portée pragmatique du point de vue des gouvernants de l’empire abbasside en particulier ! Et la poésie, celle dite officielle comme l’autre, est réquisitionnée pour les besoins de l’unification linguistique… D’aucuns diraient : «de la standardisation» ! Une poésie proche de l’éloquence, et dont l’expansion s’opérait autrefois au moyen de la joute oratoire, comme les jeux sportifs de nos jours avec leurs tournois qui opposent les villes aux villes et les provinces aux provinces. L’école, bien plus tard, prendrait la relève dans cette mission de propagation de la langue élue.
Mais les poètes ne furent pas tous des poètes au service d’empereurs et d’opérations d’impérialisme linguistique. Ce que personne ne conteste, d’ailleurs. En revanche, il est arrivé, et il arrive encore, que l’on considère qu’il n’existe en dehors de cette forme —plus ou moins officielle— du métier, qu’une poésie ou «primitive» ou «maudite». Or cette autre poésie, qu’on présenterait volontiers comme subalterne, est au contraire celle qui est liée à la langue, non du point de vue des possibilités de son expansion, mais du point de vue de sa création.
Les deux thèses de Humboldt
L’intérêt pour cette question se manifeste dès le 18e siècle, notamment avec Johann Gottfried von Herder (1744-1803), poète allemand et auteur d’un Traité sur l’origine des langues (1771) ainsi que d’autres ouvrages sur le même thème, où revient dans le même temps une réflexion sur le lien entre genèse des langues et poésie populaire. Ce courant sera accompagné à ses débuts par la revendication d’une culture nationale ancienne, qui préexiste au latin et à la romanité. Il y a un génie linguistique, que ce soit chez les Celtes ou les anciens Germains, font valoir les intellectuels dans les milieux souvent proches du romantisme. Affirmation qui, plus tard, sera largement utilisée par un certain nationalisme aux relents racistes… Mais assez rapidement, l’intérêt se déplace aussi en direction des autres peuples, en prenant une tournure anthropologique assez éloignée de toute agitation nationaliste. C’est les débuts de la linguistique comparée, dont une des figures les plus marquantes est celle de Wilhelm von Humboldt (1767-1835).
Les fondements de cette tendance anthropologique tournée vers les peuples tiers se trouvent exprimés en grande partie, de l’avis de beaucoup, dans l’introduction de Humboldt à son essai inachevé, et néanmoins considéré comme le plus important de son œuvre dans le domaine de la linguistique, à savoir celui qui est consacré à la langue javanaise dite «kavi». Y sont développées deux thèses essentielles. Un, la langue n’est pas un produit achevé mais une œuvre toujours en cours de construction ou de reconstruction : une «activité» ! Et, deux, le «monde» de chaque peuple est lui-même le produit de son activité linguistique : il n’existe pas en dehors de la langue qu’il utilise.
En d’autres termes, les grammairiens qui s’acharnent à décortiquer les langues pour en dégager des structures invariables ne font que prendre l’ombre pour la proie : le cadavre pour le corps vivant de la langue. D’autre part, le monde que l’on croit exister en dehors de nous, par dessus la diversité des peuples, et dont nous pensons que nous sommes en train d’en restituer l’expérience à travers les mots que nous proférons, est une illusion. Le monde ne préexiste pas à la langue : c’est seulement à la faveur de notre production langagière qu’il prend forme comme le monde qu’il est.
Cette dernière thèse sera d’ailleurs reprise par Hegel quand il expliquera que penser, c’est penser dans la langue. Ce qui ne manquera pas de poser un problème redoutable, dans la mesure où l’universalité à laquelle prétend le discours philosophique semble désormais devenir elle-même prisonnière ou en tout cas tributaire d’un cadre linguistique particulier. C’est pourquoi Hegel va nuancer sa position avec le temps. Dans le sens de l’affirmation d’une puissance commune, à l’œuvre dans toutes les langues, et qui est de l’ordre de la «logicité».
Les débuts de la réflexion sur l’origine des langues, dans leur diversité, sont donc propres au 18e siècle. Mais cela ne veut pas dire que rien n’a été dit sur le sujet auparavant, même si la perspective était différente. On trouve en particulier chez Platon, dans son Cratyle, une discussion qui a fait date pour les linguistes et qui consiste à se demander si les noms que nous donnons aux choses relèvent d’une convention arbitraire ou s’ils ne nous sont pas plutôt dictés par la nature des choses qu’ils désignent.
La chose et son «Me voilà !»
Ce qui est nouveau cependant, et qu’on trouve à partir de Herder, c’est l’idée que, en toute langue, la genèse des mots est liée à la production poétique. Autrement dit, à l’idée que dans sa première configuration, la langue est œuvre de poète. S’il y a convention, fixation d’un mot en tant qu’il renvoie invariablement à telle chose particulière, c’est l’usage ultérieur qui rend cela possible. Il faut dans un premier temps que la chose parle : qu’elle se détache de l’indistinction générale en disant : «Me voilà !». Le poète est celui dont l’oreille capte ce bruissement inaudible : il recueille la voix de la chose se déclarant. Le nom qu’il lui donne est en quelque sorte l’écho que provoque en lui le son reçu : un contrecoup sonore en son âme, qu’il prolonge par un autre que produit l’activité d’articulation de sa bouche ! Mais ce contrecoup sonore est désormais le nom par lequel il va appeler la chose : à la fois la nommer, de manière à ce qu’elle ne soit plus confondue avec autre chose, et la convoquer, afin qu’elle se rende présente et familière.
A ce stade, cependant, la chose ainsi appelée n’est ni prisonnière du nom qui lui est attribué ni obligée de se tenir présente. Elle garde son esprit sauvage, pour ainsi dire. Et l’appel du poète relève davantage du jeu que de la tentative d’arraisonnement. D’ailleurs, le contrecoup sonore qui sert de nom reste-t-il identique à lui-même d’une manifestation à l’autre de la chose ? Et l’appel qui lui est adressé ne donne-t-il pas lieu à des reprises variées, jusqu’à ce qu’elle finisse par se laisser apprivoiser à l’écho du même son : qu’elle y reconnaisse la juste équivalence à son «Me voilà !» ?
C’est ainsi seulement, au prix d’une assiduité, que le monde se peuple de choses, chacune ayant son visage propre, sans cesser de porter tout le mystère du monde dont elle est issue. Le poète n’en est pas l’ordonnateur pour avoir distribué des noms aux choses qui forment désormais la grande ronde des êtres. Car lui-même a été apprivoisé et requis dans son chant pour célébrer le monde : l’événement du monde !
De leur côté, les peuples, à leur naissance, ne sont pas autre chose que les premiers convives de cette célébration à laquelle préside le poète par son chant : ils font accueil aux choses qui forment le monde, tout en faisant fête aux mots par lesquels ces mêmes choses sont rendues présentes et répondent désormais à leur nom ! Ainsi, parlant la même langue, honorant le même monde, ils sont un même peuple !
En ce monde qu’ils honorent, pourtant, tout fait signe vers un lieu plus profond et plus ancien d’où chaque chose est tirée, à partir duquel tout est donné : terre mystérieuse de l’époque antébabélienne, par rapport à laquelle l’éveil de l’homme en tant que celui qui appelle les choses n’est encore qu’un projet.
C’est l’usage quotidien, et le regard de l’autre – celui de l’autre peuple – qui finissent par arracher les mots à la fragilité de leurs jeux de correspondances et qui figent la langue dans la forme d’un lexique constitué, ainsi que d’une grammaire. Dès lors, il revient au poète de faire mémoire —contre le courant dicté par l’affairement des hommes, mais aussi contre les rêves «romains» de langue universelle—, du moment inaugural. S’il le faut en déstructurant la langue et en brisant le sens “bien connu” des choses…